| 06/11/2020 |
Contre
le Roi pour le
Roi — la Fronde |
Esambe Josilonus
 ©2020 |
La médiévalité du Parlement à l'épreuve du
XVIIIe siècle— Essai |
Dans Contre le roi pour le roi— la Fronde (1648/52), j'ai montré que la tendance du Parlement de Paris, malgré des excitations circonstancielles, est défensive et conservatrice par nature.
Est-ce encore le cas au XVIIIe ? Ce Parlement "médiéval" ne bouillonne-t-il pas quand le Régent le "libère" ou, après, au milieu du siècle, ou encore plus tard, sous Louis XVI, quand toute la "société" glisse vers "la gauche" ? Son opposition systématique au gouvernement ne contribue-t-elle pas à désacraliser le Roi, affaiblir les ministres, agiter l'opinion, dévoiler les mystères de l'Etat, exciter cette Révolution qui, très vite, l'engloutira ?
Telle est, en effet, la vulgate [1]. La dénonciation gouvernementale des entreprises du Parlement sur l'Autorité a intoxiqué maints historiens qui le voient possédé, sinon d'un programme, du moins d'une ambition constitutionnelle, et d'une prétention toujours renouvelée à jouer un rôle de contre-pouvoir. Le Parlement de Paris, mauvais génie de la Monarchie, asservi par Louis XIV, délivré par Orléans (1715), harcèle Louis XV qui finit par le renfermer dans sa bouteille (Maupeou 1771) dont XVI le fait maladroitement sortir (1774), sans parvenir à l'y remettre (Lamoignon 1788). Enragé, il met le feu au royaume et disparait dans l'incendie.
Les rétrodictions s'enchaînent : puisque le siècle finit par des évènements mémorables, c'est qu'il y conduit ; puisque le Parlement s'oppose au gouvernement du roi, il sape la Monarchie ; puisque la Monarchie tombe, le Parlement est responsable.
Le futur dévore le passé. Aveuglés par les évènements de la fin du XVIIIe, nous ne voyons pas la continuité de ce siècle et des précédents. Le topos Lumières-Révolution [2] se laisse difficilement contourner, même en passant par l'Atlantique [3], chemin douteux. Il est impossible, en France, de ne pas lire ce siècle à l'envers, à partir de 1792 dont on cherche les prémisses et les causes : l'Histoire de France commence le 22 septembre 1792 et un calendrier implicite date l'avènement de Seize de l'an ‑17 et la mort de Quatorze de ‑78 ! On pense que tout événement ayant eu des conséquences sociales aussi importantes que la Révolution française doit avoir eu des causes sociales d’une importance égale (Doyle, 1982). Je me tiendrai donc le plus loin possible de 1789 et des années suivantes dont la complexité historiographique est insondable pour un Français, intoxiqué in utero.
Des anglo-saxons (Campbell etc.) nous ont appris que, en prenant le siècle à l'endroit, en le regardant à partir du passé et non de son avenir, il ne se réduit pas aux évènements qui l'achèvent. Restaurer les possibles, permet de distinguer le collapse de Louis XVI de la convulsion ultérieure, produit de cristallisations opérées par accidents dans le vide provoqué par ce collapse [4]. En mille ans, la monarchie française a connu d'innombrables explosions. Révolution dans le gouvernement ne signifie pas bouleversement social.
Sans être capable d'oblitérer absolument cette fin du siècle, je fixerai mon horizon à 1787/88, et je mettrai le Parlement du XVIIIe en ligne avec les précédents : l'ambiguïté du rôle de ces officiers essentiaux de la monarchie est normale et nécessaire. Le dérèglement de la balance provient du hiatus entre l'essence royale de la monarchie et son existence gouvernementale.
L'exposé se fera en trois temps.
- Le Parlement,
quoique intrinsèquement conservateur, a des
effets agitateurs (§1).
- Le Parlement patine, sa médiation ne marche plus (§2).
- Tout au long du siècle, le Parlement sent (sans vraiment le comprendre) que la Monarchie dont il est le balancier est devenue une apparence (§3).
I. Conservatisme et agitation
On rencontre au XVIIIe des disputes entre gouvernement et Parlement qui semblent mimiquer (ou caricaturer) les épisodes antérieurs à Quatorze. Celui-ci mort, le Parlement redevient instantanément ce qu'il a toujours été, avec le même langage, les mêmes préoccupations, aggravées par les excès de la fin du grand règne, financiers (dette), religieux (jansénistes) et dynastiques (légitimés). Les personnes ont changé, pas la compagnie.
Mais comment un
Parlement annihilé par Louis XIV renaîtrait-il
à l'identique, deux générations plus tard ? On sait aujourd'hui
que,
contrairement aux apparences, le jeu n'a pas cessé sous Quatorze [5] ;
qu'il s'est poursuivi sous Quinze et que la révolution Maupeou n'est
qu'un
épisode (fatal) de mismanagement. Mais,
le motif dans le tapis nous échappe
encore : le regard devra saisir à la fois la scène et le théâtre. L'invariance même du
Parlement le rend déphasé (cf. infra, §3).
A travers les siècles, les hommes et les circonstances, l'identité institutionnelle du Parlement provient de sa place et de son rôle dans la constitution de la monarchie royale (a).
Si le Parlement participe de (et à) l'agitation que connaît la deuxième moitié du XVIIIe, son impact ne résulte pas d'une radicalisation de sa doctrine ou de sa politique, mais de leur popularisation et de leur extension aux provinces et à tout le pays. L'effet d'échelle est multiplicatif (b).
a) Fidélité au monarque
En permettant à Orléans de contourner le testament du roi et de gagner la course à la Régence, le Parlement explicite une capacité "législative" dont il va user juridiquement au long du siècle, sans répugner aux voies de fait (publication des remontrances, condamnations d'édits enregistrés de force, grèves judiciaires, démissions collectives), à quoi le gouvernement répondra par des arrêts du Conseil, des lettres de jussion, des lits de justice expéditifs, des emprisonnements, des exils individuels ou généraux, et des tentatives réitérées de neutraliser les nuisances du Parlement en lui retirant l'enregistrement des lois qu'on transfèrerait au Grand Conseil, au Parlement Maupeou, à la Cour plénière et, in fine, aux Etats généraux.
Pourtant, le discours du Parlement reste le même. La plupart des "inventions" qui frappent l'historien dix-huitiémiste sont de vieilles routines que sa spécialisation l'empêche de percevoir. Les formes de langage donnent une impression de modernité trompeuse, avec une syntaxe plus fluide et des mots plus familiers ; l'exposé, prolixe, quittant les habits bibliques pour ceux du droit naturel, prend volontiers le public à témoin ; mais l'essentiel ne change pas. Déjà en 1615, par exemple, le Parlement se disait né avec l'Etat ; de sa propre initiative, il prenait un arrêt pour convoquer les Pairs ; le grand conseil cassait cet arrêt et lui interdisait de s'entremettre des affaires d'Etat ; le Parlement remontrait publiquement ; le chancelier serinait que le roi tient son royaume de Dieu...[6]
Le Parlement du XVIIIe n'est pas aussi belliqueux qu'il le paraît dans le suréclairage de la "lutte finale". S'il rencontre des crises aiguës, il connaît des moments pacifiques et des périodes relativement longues de coopération frictionnelle ordinaire avec le gouvernement (cf. Fayard, 1878, T3 pour un narratif). Une historiographie centrée sur les clashs donne l'impression d'une guerre permanente de 1715 à 1788. Or, l'examen de la nature et de la date des 157 cas publiés par Flammermont (1888) entre 1715 et 1788 [7], révèle que dix-huit années (25%) ne voient aucun incident notable et que, de 1720 à 1754, trente-quatre à la suite (47%) font beaucoup de bruit pour peu de chose, les batailles se limitant au front religieux, rallumé par le zèle de Beaumont, archevêque de Paris à partir de 1746, qui refuse les sacrements aux mourants suspectés de jansénisme.
Nous devrions aujourd'hui être assez indifférents à l'Unigenitus, à Rome et aux Jésuites, pour comprendre le caractère secondaire de ce combat d'arrière-garde qui ne pose pas de question "constitutionnelle". N'attribuons pas au Parlement en tant que tel les élaborations de Jansénistes qui, pour se défendre, contestent le Prince hostile et les bases de son autorité, comme le firent jadis les monarchomaques, Réformés ou Liguards. N'inventons pas un républicanisme (voire un complot) janséniste qui, aidé par la révolte "richériste" des curés (Préclin, 1929), tuerait la monarchie. Néanmoins, nombre d'avocats, plusieurs conseillers, inspirent ou défendent le parti, avec lequel le gallicanisme du Parlement occasionnellement se rencontre. Les Jansénistes font preuve de l'activisme propre aux fanatiques et, dans les conditions parfois tumultueuses des assemblées des chambres, arrivent parfois à faire adopter leur texte.
Gardien des traditions, y compris les pires (chevalier de la Barre [8] etc.), le Parlement partage la fébrilité religieuse qu'excitent les excès des "constitutionnaires" comme des "refusants" [9]. La condamnation et le bannissement des Jésuites par le Parlement (1761), puis par le roi (1764), leur suppression papale en 1773, ne ramènent pas le calme car, chassés par la porte, ils rentrent, déguisés, par la fenêtre.
Les hystéries
jumelles des convulsionnaires et des évêques constitutionnaires,
les miracles et gesticulations
d'un côté, les refus de sacrement et d'enterrement chrétien de l'autre,
le
conflit entre gallicans et ultramontains, placent le gouvernement dans
une
position intenable et interpellent fréquemment le Parlement, comme, sur
un
autre plan, la créativité à laquelle la contrainte financière [10]
pousse un contrôleur général,
toujours pressé par la nécessité, et toujours impuissant car les
dépenses ne
ressortent pas de lui (Claeys,
2011).
La durée et la frénésie des combats religieux, si l'on y ajoute la crédulité illuministe (Mesmer, Cagliostro, Rose-Croix... [11]), plongent les "Lumières" dans une singulière obscurité gothique ! Cette effervescence et cette acrimonie sont sans rapport avec les problèmes réels que, toutefois, elles enveniment.
Ce contexte imprègne le Parlement qui, cependant, s'il frémit, s'il fulmine, s'il exagère, garde la même assise. Il maintient ses positions, ses positions éternelles : liberté de l'Eglise de France et du Roi par rapport à Rome ; et, surtout, gouvernement par les Lois, une glose sans fin sur la leçon digna vox [12] : l'autorité du Monarque dépend de celle des Lois ; de même que la toute puissance de Dieu, celle du Monarque s'autolimite (avec l'aide du Parlement, part du Corpus Regis). Toutefois, ce contrôle de constitutionnalité (comme dit Saint-Bonnet 2010 de façon volontairement anachronique) ne s'exécute pas de façon réglée : le désordre est le moyen de l'ordre.
Bien que soumis à Dieu et éclairé par lui, le Roi est exposé, du fait qu'il est homme, à être trompé, et du fait qu'il est absolu, à abuser de son autorité. Sa volonté doit donc être, non pas combattue, mais canalisée par une institution établie à cet effet. Mais, en retour, comment "canaliser" les gardiens eux-mêmes ? Spontanément, le roi tend au tyran et les gardiens à l'usurpation. Chaque partie dénonce les intentions et l'inconduite de l'autre : le Parlement tance le roi au nom de ce qu'il voudra avoir voulu, et ce dernier le réprimande d'entreprendre sur l'autorité royale. Chacun est dans son rôle, les deux dans une opposition sans issue. Ce conflit irrésoluble ne va pas sans dérapages, toutefois il est nécessaire. Dans la tradition de la monarchie française, ce dilemme n'appelle pas de réponse (quoiqu'on en cherche). L'ordre par le désordre : le Roi n'ose manquer à son devoir par l'appréhension du Parlement, ny le Parlement par la crainte du Roy [13], ou ils en font semblant [14]. Au cœur de la crise de 1771, Mme d'Epinay le dira joliment : cette indécision même fait partie de la constitution monarchique [15].
Le bloc de "médiévalité" que constitue le Parlement porte un Roi qui règne par tradition. L'affrontement, non systématique, reste habituellement respectueux et formel, quoique la coutume autorise un ton vif. Aussi obstiné et autoritaire qu'on suppose Quinze, aussi maladroitement qu'il lui arrive de se comporter, il joue consciencieusement cette partie toujours recommencée. Il le fait, en général, avec une étonnante patience, preuve a contrario de la nécessité d'une telle institution pour le roi, qu'elle garde de l'opprobre de la tyrannie et de la volonté arbitraire [16].
Après des dizaines d'années d'escarmouches, quand Maupeou, poussé par l'urgence financière (Terray), promet à Quinze de sortir la couronne du greffe, même alors (1771), il est remarquable (et peu remarqué) que les Parlements ne sont pas supprimés mais recomposés. Maupeou "éteint" assez sauvagement les officiers en poste et conserve les Parlements. Dans les provinces, faute d'hommes idoines, les nouveaux conseillers sont souvent pris parmi les anciens et l'agitation recommence ! A Paris, si le baillage Maupeou enregistre automatiquement tout ce qu'on lui apporte, rien n'assure qu'il aurait continué : peu à peu, en se professionnalisant, l'institution n'aurait-elle pas repris sa vieille route ? La preuve n'est pas faite puisque Seize rétablit les anciens Parlements (1774) dont Brienne tentera lui aussi plus tard de le débarrasser (1788). Et encore alors, la cour plénière imaginée par Lamoignon n'est rien d'autre qu'un Parlement recréé et magnifié !
Bien que certains conseillers (et l'agitation permanente des jeunes [17]) irritent, et que les Remontrances réitérées exaspèrent, le Parlement est indispensable, faute de mieux, pour suppléer la nation ; représenter, face au roi, le Royaume qu'il a épousé (l'anneau du sacre) ; tenir lieu d'états généraux ou, avec sa garniture de Pairs et de grands officiers, esquisser cette chambre des Lords à laquelle, dans les années 1780, rêvera la noblesse "éclairée" qui entre en politique, en espérant utiliser le tiers contre le roi pour mettre en place un gouvernement aristocratique.
b) Effet d'échelle
Le Parlement dit tellement toujours la même chose qu'il a l'air de radoter [18]. L'audace de ses actes suit celle du gouvernement, pas son discours. Ne confondons pas émission et réception : les vieux mots reçoivent de nouveaux sens, la langue de bois peut prendre feu ! La pièce était la même, mais l'auditeur était changé (Tocqueville) [19]. En se vulgarisant, les idées se simplifient et se durcissent : yin et yang devient yin vs yang. La dialectique éternellement tricotée par le Parlement (Roi et Couronne, Roi et Royaume, Roi et Lois...) est tout à coup perçue comme une alternative et quelques-uns en font des conclusions.
Dans le registre institutionnel, les refrains, convenus, se fredonnent sans grande conséquence ; dans le jeu "social", les mécontents en font des chants de guerre. L'équilibre Parlement-Gouvernement, déjà perturbé par la confusion du second [20], devient impossible quand "la société" s'en mêle et prête au Parlement un potentiel subversif qui lui est étranger. Ses maximes conservatives séculaires, poussées au rouge par le public, lui paraissent de brûlantes promesses. Inévitablement, le Parlement décevra ces attentes inappropriées.
Il est vrai que le Parlement, trop souvent acculé (lits de justice, cassations, exils), a repoussé l'écran qui dissimule les mystères de l'Etat et en a appelé au public. Bien que le dialogue secret avec le gouvernement se poursuive via les Présidents de la Grand'Chambre, les gens du roi et d'autres canaux privés, les remontrances — quant au fond, les mêmes que celles adressées à François Ier— se font à présent coram populo. Elles sont imprimées (et parfois écrites dans ce but), ainsi que les arrêts pris contre le gouvernement et ses instances, de surcroît criés et affichés. Sur la scène publique, elles s'agglomèrent aux consultations des avocats, aux pamphlets, mandements d'évêques, prêches, nouvelles à la main, feuilles colportées, placards, vers malicieux, ordures de toutes sortes, qui, imprégnant l'esprit du lecteur (souvent un auditeur), conditionnent son interprétation des mots du Parlement : le contexte réécrit le texte et le même discours a une autre efficace [21].
Le bruit du Parlement de Paris est amplifié et parfois recouvert par celui des Parlements des provinces, à présent exaspérés par leur rivalité avec les hommes du roi, rivalité qui rejoue l'affrontement parisien, augmenté et modifié par les particularités historiques, le poids des personnalités et les effets locaux de clientèle.
La diversité des Parlement des provinces et de leur contexte n'empêche pas de généraliser. Quoique jaloux de leur propre souveraineté et enracinés dans leur terroir historique [22], ils n'ignorent pas Paris qui aspire et inspire les élites provinciales. Les lettres et les hommes circulent : des présidents à Paris sont faits premiers présidents en Province, des présidents de province résident habituellement à Paris, des délégations sont convoquées à Versailles ou viennent demander audience. Les Parlements des provinces, aussi souverains que celui de Paris, respectent son antériorité, l'immensité de son ressort, et sa dignité (Cour du Roi, Cour des pairs), renforcée par sa localisation dans la mégalopole, le nexus judiciaire (autres cours souveraines, procureurs, avocats etc.), et le contact direct (officiel et officieux) avec la haute noblesse, la cour et le gouvernement [23].
Les Parlements de Province, eux aussi, doivent enregistrer les actes royaux pour qu'ils deviennent légaux dans leur ressort. Ils l'ont longtemps fait sans trop rechigner, sauf lorsqu'ils nuisent à leurs intérêts personnels (paulette, semestres, créations d'offices etc.) ou à ceux de leur province.
Mais les efforts pour transformer la souveraineté en contrôle (infra) ébullitionnent les provinces et donnent matière à critique à leur Parlement car l'autorité empruntée, à la différence de l'originaire, s'expose à la contestation : il y aura eu surprise, dissimulation, négligence, incompétence, désobéissance, erreur, abus... Lorsque les arrêts du Conseil ne passent plus par celui-ci et sont rédigés au nom du Roi par les commis du ministre, comment les prendre pour la volonté divine de l'oint ?
Bien que les conditions et circonstances diffèrent dans chaque ressort, la communauté des entreprises sur les libertés fait surgir les prodromes d'une opinion publique qu'on qualifiera bientôt de nationale ou patriotique.
Les Princes, si actifs jadis, ne comptent plus ; un siècle plus tôt, ils se seraient insurgés, mais, privés de base de pouvoir indépendante, ils se limitent à quelques éclats (Orléans) ou se résignent aux manœuvres souterraines (Conti [24]). Au contraire, les Parlements des provinces, peu remuants pendant la Fronde (sauf Bordeaux et Aix [25]), s'embrasent maintenant [26]. Les Intendants et leurs subdélégués, les commandants en chef, les commissaires, les innombrables édits bursaux à enregistrer, les exacteurs et fusiliers fiscaux, les empiètements et les vexations, leur font imiter le Parlement de Paris dont ils reprennent les "éléments de langage" qu'ils poussent parfois à la caricature : ils remontrent, cassent, annulent, réitèrent, se suspendent etc. S'ils s'excitent davantage, c'est que les libertés de leur province les soutiennent et qu'ils n'ont pas, en face d'eux, le Roi en personne (lit de justice), mais son représentant : le gouverneur (devenu honoraire) ou le Commandant, et l'Intendant, contesté et sans force s'il n'a pas quelques régiments à sa portée, brutal et violent s'il en a. Tenus en longue laisse par le gouvernement (convocations, délégations, courriers), les Parlements ont une marge de manœuvre plus grande que celui de Paris. Certains ostraciseront leur Premier Président, décréteront leur Intendant ou leur gouverneur, et enverront leurs huissiers les saisir, les obligeant à s'entourer de gardes !
Cette activation de la périphérie n'est-elle pas un fait majeur ? La négociation Versailles-Paris, même problématique, se fait en face à face, alors que les transactions entre Versailles et les pays (au pluriel) passent par des jeux de miroir : si loin, le représentant de l'Autorité, comme les gens du roi au Parlement, ne reçoivent de Versailles que des instructions décalées et sommaires. S'adaptant à leur manière au contexte local et à ses variations, ils improvisent, et en font trop ou pas assez.
A partir de la seconde moitié du siècle, l'échauffement religieux et juridictionnel (refus de sacrements, affaire de l'Hôpital Général) conduit le Parlement de Paris aux Grandes remontrances (9 avril 1753), à la grève, punie d'exils individuels et du transfert de la Grand'Chambre à Pontoise, puis de son exil à Soissons. L'épisode se clôt par des lettres de rappel du 27 juillet 1754. Mais, déjà, des Parlements (notamment Aix et Rouen) se sont agités à propos du schisme et des évocations au Grand Conseil. Ce qui va les rassembler, c'est la Déclaration royale du 10 octobre 1755 : à propos d'une affaire anecdotique [27], elle proclame les arrêts du grand conseil exécutoires dans tout le royaume, en passant par dessus les cours souveraines.
Le grand conseil, dérivation judiciaire du Conseil du roi depuis Charles VIII (édit d’août 1497), revendique la supériorité sur les Parlements qui, de leur côté, ont toujours tenté de réduire ses attributions (cf. Campardon, 2000). La Déclaration de 1755, après d'autres, réaffirme que le Grand Conseil a pour ressort la totalité du royaume et que les Parlements n'ont aucun pouvoir sur lui : Voulons que les Arrêts, Ordonnances & Mandements par eux [Grand Conseil] rendus dans les matières qui leur sont attribuées, soient exécutés dans l'étendue de notre Royaume, ainsi que les Arrêts de nos Cours le sont dans les limites de leur ressort, sans que les [...] exécuteurs desdits Arrêts soient tenus, avant que que de faire lesdites exécutions, de les présenter à nos Cours ou autres Juges, & leur demander à cet effet aucune permission [28]. Alors que le ressort de chaque Parlement est limité, celui du Grand Conseil les engloberait tous. Les Parlements s'émeuvent, correspondent, et adoptent, à peu près en même temps, des Remontrances semblables [29].
Très vite, l'affaire de Besançon (cf. Swann, 1994) les fait converger, les solidarise et les unit dans une commune illégalité puisqu'un Parlement, souverain dans son ressort, n'a pas à connaître des affaires des autres. Après la dispersion forcée des conseillers de Franche-Comté, Rouen remontre dès le 5 mars 1759 ; Bordeaux, le 14 mars ; Grenoble, le 23 mars ; Paris, le 27 mars, le 30 mai, avec Itératives du 3 juillet ; Rennes, le 28 mars; Aix en Provence, le 1er Juin. La publication la même année de ces protestations prend pour titre : Recueil d'Arrêtés, Articles & Remontrances de différentes classes du Parlement, Au sujet de ce qui s'est passé au Parlement séant à Besançon (mon soulignement). Après Besançon, Toulouse a sa propre guerre (1763-67) et, surtout Rennes, dont l'affaire (1763-1774) ira très loin (Chalotais, Aiguillon).
Les Parlements, violés militairement, exilés, ou sévèrement tancés, s'appuient les uns les autres. Ils se déclarent concernés, contestent les sanctions qui tombent, soutiennent les protestations. Versailles interdit sèchement de s'occuper de ce qui leur est étranger et dont ils n'ont pas été saisi : ils excèdent les bornes de leurs fonctions lorsqu'ils entreprennent de les étendre à l'ordre universel du gouvernement dans les différentes parties du Royaume. C'est dans la personne seule du Roi qu'existe l'universalité, la plénitude et l'indivisibilité de l'autorité... Les lois ne leur donnent aucune voie juridique, et réprouvent celles qui ne le seraient pas, pour prendre connaissance de la vérité de ce qui se passe hors de leur ressort... [30].
Au contraire, rétorquent-ils, les Parlements de Paris, de Toulouse, de Rouen, de N et N... sont des branches, des classes, d'un seul et unique Parlement du royaume. L'Ordonnance de fraternité entre les Parlements de Paris et Toulouse (Charles VII, 1454) n'en fait-elle pas un même parlement... sans souffrir, pour causes des limites d'iceux parlemens, avoir entr'eux aucune différence [31] ? Se basant sur ce droit des conseillers d'un Parlement à siéger dans un autre, surinterprétant une déclaration circonstancielle du chancelier de l'Hôpital (1560) [32], les Parlements affectent de se considérer comme des déclinaisons géographiques d'un Parlement de France, d'abord unique à Paris, puis déconcentré au fur et à mesure du rattachement au royaume de provinces distantes pour ne pas éloigner les justiciables de leur tribunal d'appel. Cette unité (menacée à l'occasion par la prétention de Paris à la supériorité en tant que Cour des Pairs) [33] est la seule invention subversive de la seconde moitié du XVIIIe [34].
On se rappelle que, un siècle plus tôt (1648), l'union des Cours souveraines de Paris (Chambre St Louis) avait scandalisé la Reine Régente. L'Arrêt du Conseil qui condamnait cette assemblée dénonçait une forme de ligue & de parti dans l’Etat, une nouvelle puissance, un contre-pouvoir, donc une sédition.
Quinze cherche à faire peur en agitant ce spectre, en stigmatisant des prétentions solennellement proscrites et qui n'ont été depuis hasardées que dans des temps de trouble et de révolte, dont le Roi est bien assuré que son Parlement déteste l'époque et le souvenir...
Bien plus
encore que la Chambre St Louis, l'unité des classes, se
disant organique
et étendue au royaume entier, blesse la Majesté du roi qu'elle
concurrence dans
la représentation de l'universalité [35].
Le gouvernement qui tente vainement d'unifier le royaume a besoin de sa
division [36] !
II. Le crépuscule du Parlement
Nous verrons (infra §3) que notre Parlement médiéval est hors-jeu. Cela n'apparaît pas (ou pas clairement) aux contemporains car la "Monarchie administrative" est emboitée, encastrée, justifiée, autorisée, par la Monarchie monarchique qui reste l'univers de référence et la source de légitimité. Quand Maupeou tente d'adapter le Parlement, cette révolution dans la constitution de la monarchie française éveille le vieux fantôme des états généraux (a) qui, prenant des forces à chaque avanie financière ou réformatrice, remplace le Parlement comme image de l'intérêt public. En 1787, le Parlement abandonne (b).
a) L'erreur de Maupeou
Intrinsèquement, le Parlement aspire à une tranquillité prospère et ce corps au cuir épais s'inscrit dans l'éternité. Il ne se meut pas, il s'émeut quand la pression est trop forte. Il se risque alors à se faire le tuteur d'un roi toujours mineur ou à protéger sa propre existence (juridiction et privilèges) qui, dit-il, est indissociable de la Monarchie. En ce qui concerne la chose publique, le Parlement est essentiellement réactif.
Mais, lorsque tout s'accélère, courir à reculons, fait trébucher. Di Donato (1997 et 2014) suggère que la tendance despotique inhérente à un pouvoir absolu, désinhibée par le XVIIe, perd en efficacité (polycratie) et en légitimité, par une modification tacite de la forme de gouvernement, qui, par sa nature, ne pouvait être changée sans désarticuler le système entier. Le Roi, instrumentalisé par l'administration, affirme trop crument son autorité. Poussé à entrer en politique, il suscite des oppositions respectueuses, et aussi une pensée alternative ("philosophes") qui rejette la médiation patriarcale du Parlement et son usage des arcana juris.
Le Parlement et ses défenseurs intéressés (Le Paige etc.), malgré (et grâce à) leurs critiques, constituent l'ultime défense d'une monarchie affaiblie, tant par elle-même que par les circonstances, une tentative d'opposer un discours juridiquement plausible et politiquement réalisable aux thématiques soulevées par la pensée moderne. Le "continuisme" du Parlement, cette attitude organique de l'Antiquité, lui fait viser la conservation, le retour (ré-forme vs réforme). Quoique Donato s'aventure un peu trop loin [37], il a raison de souligner que, l'absolutisme monarchique étant la condition même du statut du Parlement dans l'Etat, il doit le défendre pour le combattre, le combattre pour le défendre.
Le coup Maupeou ôte au gouvernement la couverture du Parlement et de sa tradition : le despotisme est nu, les mystères de l'Etat sont dévoilés dans les salons, et même dans la rue. On en parle aux Halles ! Le Parlement, accusé par le Chancelier de vouloir enlever des mains dudit Seigneur Roi l'autorité souveraine, pour ne lui laisser que le nom de roi, et menacé d'impuissance, arrête (10 décembre 1770) que M. le Premier Président sera chargé de se retirer sur le champ par devers le Roi, pour le supplier de rétablir son honneur et la constitution de l'Etat... ou de recevoir l'offre unanime, qu'à l'exemple des anciens magistrats, les membres actuels de ladite Cour font audit Seigneur Roi de leur état et de leur tête, sacrifice volontaire, mais devenu indispensable...[38].
La tête, on leur laissera, mais leur état on prendra. Les conseillers, méchamment et spectaculairement chassés du Palais et exilés, se comportent en sénateurs romains, obéissent sans révolte, et ne protestent que de leur obéissance et de leur espoir qu'un jour le Roi sera mieux informé. L'effet public est considérable, à Paris et dans les provinces où les Parlements connaissent un traitement similaire : la violence disproportionnée exercée contre les personnes, comme l'évidence que, après s'être débarrassé de Choiseul et du Parlement, le "triumvirat" (d'Aiguillon, Terray, Maupeou) a maintenant le champ libre, notamment en matière financière, suscitent une protestation générale à laquelle se joignent les Princes du sang [39]. Les critiques et les pamphlets se déchaînent, avec la probable complicité du lieutenant-général de la police (Sartine), et l'assistance des presses clandestines du parti janséniste, exaspéré par les liens de Maupeou avec les Jésuites.
Remarquons cependant que la révolution Maupeou est relativement pacifique, d'un côté comme de l'autre. Si la Bastille se remplit, si des personnes sont molestées, si les espions persécutent, le sang coule peu. Ce n'est plus le temps des prises d'armes et pas encore celui des émeutes. Ce qui se passe est moins apparent et plus grave : les mystères de l'Etat emplissent la place publique. On soutient ou accuse ministres ou chats-fourrés, on s'interroge sur le rôle du Parlement dans la constitution de la Monarchie, on questionne celle-ci.
L'énorme masse de libelles spontanés et de contre-libelles payés [40], à laquelle d'innombrables avocats apportent leurs talents, vacants et inégaux, contient plus de vitupérations, voire d'insultes, que d'arguments ; quand il y en a, ils privilégient ad nauseam le registre pseudo-historique, puisqu'une tradition se prouve par le passé.
Quelques réflexions réalistes, cependant, nous éclairent. La fameuse Correspondance du chancelier Maupeou avec son cœur Sorhouet (1771, écrite par le fermier-général Augeard), au-delà des dénonciations et méchancetés de rigueur, analyse avec beaucoup de finesse et d'insolence la complicité entre Parlement et gouvernement que Maupeou a bêtement détruite : la propriété des sujets étant sacrée, depuis toujours, leur expropriation partielle par l'impôt exige leur assentiment (états généraux) ; pour sauter cette difficulté, les ministres inventèrent de faire croire aux peuples et au Parlement lui-même que celui-ci, représentant les états, pouvait négocier et consentir en leur nom. Le Parlement a cru à cette délégation flatteuse, et, tantôt sans barguigner, tantôt avec des protestations qui cédaient aux ordres [41], a entériné la multiplication des outrages fiscaux qu'il a rendus légaux. Maupeou, en détruisant cette fiction, rend ses droits à la Nation !
Augeard ironise : le Parlement, aveuglé par l'esprit de corps, n'a pas saisi sa chance ; il aurait dû remercier le roi de mettre fin à une usurpation qui pesait sur sa conscience ; et, enfin rendu au soin exclusif du judiciaire, se déclarer désormais incompétent pour enregistrer quoi que ce soit ! Privant ainsi de base légale les nouvelles lois fiscales, il empêchait les tribunaux de sanctionner les refus d'y obtempérer, et la Cour des Comptes de valider les sommes perçues. Il lui fallait faire observer au Roi que le consentement libre de la nation était le seul moyen qui pût concilier le besoin de ses finances avec la justice prescrite par le droit de la nature, autant que par celui de la nation ; que pour l’obtenir il falloit assembler les Etats-généraux, à qui seuls il appartenait de décider... [42].
Dans le même
sens, la Lettre
sur l'état actuel du crédit (1771) commente ce vers de Corneille, Et qui veut tout pouvoir, ne doit pas tout
oser (La mort de Pompée) : le Parlement, ses formalités, ses
protestations, donnaient aux prêteurs un sentiment de sécurité car la grande science est [...] d'avoir dans le
fait... une autorité illimitée, & de ne montrer jamais dans le
droit,
qu'une autorité tempérée par des Loix. Le despotisme n'inspire pas
confiance, et Maupeou a tué la poule aux œufs d'or [43].
Point d'impôts nouveaux, point d'emprunts possibles, il ne reste qu'à
s'en
remettre aux états généraux.
Les états, cette fiction enracinée dans les placites germaniques, servent de joker dans le jeu politique français où la Nation s'incarne dans le Roi. Elle ne se représente pas elle-même, ni en totalité, ni en ordres, ni en groupes. Toute association spontanée est illégale et criminelle. Toute fraction est faction, en dehors des corps constitués et des corporations ad hoc instituées. Même les assemblées périodiques du clergé sont convoquées par le roi, et la noblesse ne s'est réunie qu'en temps de troubles. Cela n'empêche pas les salons, les cafés et les correspondances d'assurer les échanges privés, les presses clandestines d'imprimer à tout va, et la cour de se faire l'écho (ou l'origine) des opinions et médisances. Parentèles, amitiés et clientèles sont des relais d'influence, des lobbys. Quand tout va mal, on dit si le roi savait..., quand tout va très mal, quand les circuits sont bloqués, on en appelle aux états (plus souvent souhaités que réunis), moins comme puissance délibérante (ils se bornent à émettre des vœux), que pour donner sa chance à une nouvelle configuration des rapports de force. Les ordres assemblés, les débats au sein de chacun, les négociations entre eux, le spectacle même de la "nation" au contact de son roi, défont —peuvent défaire— des positions constituées dans le secret des conseils et les couloirs de la cour. En particulier, ceux qui se sentent injustement exclus du pouvoir, des Princes, des Grands, des Nobles, espèrent s'appuyer sur le tiers pour instiller une dose d'aristocratie dans le gouvernement.
Si la dernière réunion des Etats (peu concluante) date de 1614, la noblesse les a réclamés pendant la Fronde (1649, 1651) [44] et en a obtenu la convocation (sans suite). A la mort de Quatorze, la querelle des Légitimés a ranimé le thème du contrat national et du recours aux états en cas de vacance du trône. L'Edit de 1717 lui-même admet que, si la famille régnante venait à s'éteindre, ce serait à la Nation de choisir son roi. Dans ce débat, reviennent les lois fondamentales et leur inviolabilité mystique, alimentées par l'histoire mythique qu'exploiteront le Paige (Lettres historiques, 1753) et, après le coup Maupeou, les jansénistes Maximes du droit public français (1772) et Blonde (Le Parlement justifié par l’impératrice de Russie). On mobilise la première race (Clovis et Dagobert...), et la seconde, avec notamment les champs de Mai de Charlemagne, et l'inespéré "édit de Pîtres" de Charles le chauve : Lex consensu populi fit et constitutione regis (25 juin 864) !
Rien d'étonnant à la circulation, parfois souterraine, parfois au grand jour, du thème des états, tant en faveur du Parlement, états au petit pied [45], que contre lui (usurpateur). La surprise viendra du Parlement : il finira par reconnaître que son zèle a excédé son pouvoir et par se rallier aux états, lui qui, malgré la filiation revendiquée, ne les apprécie pas et s'est toujours placé au-dessus d'eux [46].
b) Le renoncement
A l'été 1787, après l'éviction de Calonne et la dissolution de la calamiteuse assemblée des notables, Loménie de Brienne inflige au Parlement à la fois les assemblées provinciales, la subvention territoriale et le monstrueux droit du timbre [47]. Menacé d'enregistrement forcé, le Parlement use, non sans déchirement [48], du joker que la Cour des Aides lui tend depuis trente ans. Il dit au roi (26 juillet 1787) que la Nation seule, réunie dans ses États généraux, pouvait donner à un impôt perpétuel un consentement nécessaire ; que le Parlement n'avait pas le pouvoir de suppléer ce consentement, encore moins celui de l'attester quand rien ne le constatait ; et que, chargé par le Souverain d'annoncer sa volonté aux peuples, il n'avait jamais été chargé par ces derniers de les remplacer (mon soulignement).
Quand Maupeou, en dispersant le Parlement, mit fin à sa médiation patriarcale, il ne restait, logiquement, qu'à passer à l'immédiateté des états (cf. Augeard, supra). Mais, alors, les défenseurs du Parlement biaisent : dans sa Requête des états-généraux de France au roi (1772), Le Paige fait des états une figure de la Nation qui se plaint et dénonce. Il est si loin de vouloir les réunir qu'il propose de leur substituer une assemblée de sages provinciaux, un ordre de la patrie dont les conseils éclaireraient le roi.
Les conseillers châtiés, muets, obéissants, et rétifs aux états, n'ont rien dit et, après leur rappel par Louis XVI en 1774, sont revenus à l'habituel train-train. En 1787, l'impasse est totale. Les Edits de Brienne publiés malgré le Parlement, ce dernier les annule : A déclaré la distribution clandestine desdits édit et déclaration nulle et illégale, comme étant ladite distribution faite par suite d'une transcription sur les registres de la Cour, que ladite Cour a déclaré nulle et illégale par son arrêté du 7 de ce mois [49]. Le 15 août, il est exilé à Troyes (un triomphe) mais, dès septembre, le gouvernement retire les deux impôts (la Subvention territoriale et le Timbre) ; en échange, le Parlement proroge le second vingtième (10 septembre), ce qui lui vaut son retour à Paris.
L'auteur
anonyme (d'Eprémesnil ?) de Le coup manqué ou Le
retour de Troyes dénonce
la contradiction : puisque le Parlement a reconnu qu'autoriser
l'impôt est hors de son pouvoir et que ce droit
appartient aux états, il ne devait
pas accorder le vingtième. Qu'est-ce
qu'une prorogation d'impôt si ce n'est un nouvel impôt ?
Ou bien
le Parlement a été leurré, ou bien son système
n'était qu'une dispute de mots [50].
Il est vrai que le Parlement, malgré sa fière déclaration de juillet, hésite et que les états généraux sont encore à venir. Le gouvernement cherche une voie entre les deux. Quelques mois plus tard (mai 1788), Lamoignon, poussé par Brienne, tente de soustraire l'enregistrement des lois aux Parlements (cour plénière [51]) et, en attendant, il en suspend les fonctions.
Cette réforme est très rapidement abandonnée. Le recours aux états généraux, latent depuis Maupeou, finit par s'imposer. Les états ont une double dimension, "sociale" (assemblée des trois ordres) et spatiale (congrès du royaume) : l'universalité du peuple (i.e. sujets) et l'universalité des provinces.
Le 3 novembre 1789, les états,
devenus assemblée nationale, déclarent
la mise en vacance des Parlements
dont ils redoutent le fantôme de légitimité et l'habileté. L'initiateur
de la
proposition, Alexandre de Lameth, l'exprime clairement : La Constitution n'aurait rien de solide,
s'il subsistait des corps rivaux de l'Assemblée nationale [52]. La chambre des vacations du
Parlement de Paris enregistre par force le décret de l'Assemblée
nationale [53], les
Parlements de province cèdent en récriminant, sauf Rouen, Metz et
Rennes :
ils accusent l'Assemblée d'usurpation, elle les accuse du crime de lèse-nation.
Ultérieurement, les Parlements mèneront
une existence spectrale
dans l'émigration, en tant que légitimité "nationale" alternative,
susceptible d'annuler l'ensemble des décrets de l'Assemblée et
d'apporter une
sanction de droit public à la restauration de la Monarchie [54].
Davantage que les activités éventuelles des personnes, la crainte du corps explique le massacre de ceux des ci-devant
conseillers (et leur famille) qui n'avaient pas
cru devoir émigrer.
III. Un trop grand royaume
Quittons la scène pour le théâtre.
Sur la scène, le Parlement, face au Roi, continue à tenir le rôle pour lequel il est programmé. Mais le roi est pris au piège de son propre absolutisme (a). Le théâtre, c'est l'administration clandestine dont les métastases échappent à tout contrôle (b).
a) L'impossible territorialisation
L'existence de la monarchie déborde son essence royale et divine à laquelle congrue le Parlement. On parle de "monarchie administrative", expression significative quoique équivoque.
Paradoxalement, l' "absolutisme" de Quatorze a tué la monarchie : L'Etat, c'est Colbert (Dessert [55]) ! En se proclamant décideur universel, le grand roi habille de son autorité "absolue" ses ministres et leurs agents ; et, en leur ôtant toute apparence d'autonomie, il les incorpore à sa divinité [56].
Le Régent, Quinze et Seize, aussi absolus qu'incertains, hésitent perpétuellement. La cause s'en trouve, moins dans leur personnalité et leurs défauts auxquels se sont attachés tant d'historiens, que dans leur faiblesse structurale : le Roi tout-puissant est une figure dont abusent commissaires et commis, et que se disputent ministres et Parlement [57]. Alors que, jadis, ce dernier devait occasionnellement combattre la décision "tyrannique" d'une personne, il est affronté presqu'en permanence à une hydre despotique [58]. La vanité de ce combat le pousse aux "sorties de route". Un système tendanciellement conservatif (Roi-Parlement) devient dissipatif (administration-Parlement).
En particulier, le poids croissant de la fiscalité et de la finance dans les règlements et les lois, oblige le Parlement à s'opposer plus souvent. En dépit des multiples moyens clandestins qui permettent d'augmenter les impôts existants, ils ne rendent jamais assez, il faut en imaginer d'autres, il faut les faire consentir et autoriser légalement pour légitimer la coercition sur les redevables ou les créanciers [59]. La charge de blanchir le racket fiscal tombe sur un Parlement doublement réticent : personnellement, car les conseillers et leurs entours sont concernés ; institutionnellement, en tant que défenseur de l'intérêt public. En principe, les recrues fiscales, liées aux guerres, ont un caractère temporaire. Mais l'augmentation des dépenses (nouvelles formes de guerre et "complexe militaro-industriel") et la multiplication des conflits ruineux sous Quatorze ont donné au déficit un caractère structurel qui marque tout le XVIIIe. Les expédients, macro (Law) [60] et micro (manipulations), ne suffisent pas. Les périodes de paix diminuent les déficits sans éteindre la dette publique. Les recettes ne rattrapent jamais les dépenses. Celles-ci sont ordonnées par des ministres "quasi ducaux", en rivalité non arbitrée, à la fois trop puissants et inefficaces, rendus excessifs par leur concurrence et précarité. Celles-là sont la responsabilité du contrôleur général qui cherche vainement la solution d'une équation militaire [61], indifférente au pays, démobilisé par l'improductivité [62] de guerres peu compréhensibles et coûteuses, et par leur relative innocuité (pas d'invasion) : la guerre est comme un été pourri qui dure.
La masse du
menu peuple, écrabouillée d'impôts directs et
indirects, n'en pouvant mais, la capitation et le dixième introduits sous
l'autorité de Quatorze, les vingtièmes
de Quinze et autres projets (subvention
territoriale etc.), visent à tailler
les non taillables, Nobles et
privilégiés. Même si l'ignorance des revenus et patrimoines rend la
proportionnalité illusoire ; même si des accommodement
(abonnements) et
des négociations prennent place ; cette tendance fiscale à dévorer
les
exemptions attaque l'honneur et les biens des "privilégiés", les
exposant à l'arbitraire de l'administration et aux
brutalités de ses agents qui déjà, souvent, menacent
leur être même en contestant la noblesse
de tel ou tel
pour le soumettre à l'impôt. Un exemple, le droit de franc-fief exigé des roturiers pour les
terres nobles qu'ils possèdent : lorsque le particulier soutient
que,
étant noble, il ne doit rien, et qu'il
plaît au fermier de contester sa noblesse, c'est l'Intendant qui
juge, en sorte que le gentilhomme dépend du
jugement d'un seul homme pour jouir de l'état qui lui a été transmis
par ses
ancêtres [63] . Cette choquante subordination
à l'Intendant, aux directeurs, aux fermiers
et aux ministres, n'est évitée qu'à ceux qui touchent à la cour ou ont
des
protections. Encore ne sont-ils pas à l'abri de vexations de subalternes obtus. Ainsi, la noblesse
est privée de son état, et le roi de sa base naturelle, déjà
rongée par la
vie rurale, la concurrence de la haute bourgeoisie et, ici ou là, le
schisme
religieux. Est-il surprenant que, tandis que la population et la
richesse
croissent, la démographie et la fortune de la classe noble soient en
baisse, et
que tant de gentilshommes aspirent à une réformation (Nassiet,
2006 ;
Bourdin, 2010) ?
La monarchie s'est mise dans une impasse : Instead of asking how such a strong structure suddenly collapsed in 1789, we should be asking how such an apparently strong but actually rather limited set of power structures managed to put off or survive crises for so long (Campbell, 2005).
Retournons vers
l'intérieur l'idée de surexpansion impériale :
maintes puissances ont manqué des
moyens de leurs ambitions, ou de capacités pour exploiter leurs
victoires et
réussir le changement d'échelle. Pour comprendre pourquoi la monarchie
française, quoique la plus grande d'Europe, a sombré la première, il
suffit
de substituer "parce que" à "quoique".
Le Roî de France a trop de Royaumes. Il faudroit quela Monarchie fut plus petite ou que le Monarque fut plus grand. (Ange Goudar, 1765, L'espion chinois ou L'envoyé secret de la cour de Pékin : pour examiner l'état présent de l'Europe, T. 1 p 81)
L'entreprise de "centralisation" millénaire (elle-même un sous-produit des concurrences "féodales" plutôt qu'un projet stratégique) a fait du royaume un conglomérat immense, hétéroclite et incontrôlable. En Angleterre, la petite taille du pays et une longue série de révoltes tumultueuses ont laissé l'administration locale à la noblesse rurale (le compromis de la glorieuse révolution). En France, la gestion déléguée, "féodale" (Grands, Nobles, châtelains) ou "néo-féodale" (style Table de Chaulnes, 1711 [64]), soulève d'insolubles problèmes de cohésion et de subordination. Ce n'est pas uniquement sa mégalomanie qui a poussé Quatorze dans la voie de l'unification, inéluctable cul-de-sac. Le potentiel "totalisateur" des nouvelles formes de guerre met en concurrence non seulement des armées mais des organisations (cf. l'émergence stratégique de la Prusse).
Seulement, la gestion directe manque des moyens nécessaires : l'infrastructure (communications) et la superstructure (bureaucratie [65]). Comme nous le verrons (b), la multiplication des palliatifs (ministres, bureaux, commis, commissaires, délégués, agents, hommes de main) entraîne une polycratie dévorante et dépourvue de régulation. Cette machine, inapte à la transition étatique, pèse, matériellement et moralement, d'autant plus lourd sur les contemporains qu'elle est à la fois hypertrophiée et sous-développée, tentaculaire et fouisseuse. L'instabilité organique propre aux "sociétés" ante-industrielle tourne au chaos ; les efforts pour saisir le royaume déstabilisent à la fois le centre (polycratie) et les périphéries (opposition des élites locales). Ainsi, le succès (relatif) de la Monarchie française est la cause de l'échec (absolu).
Arthur Young, malgré ses préjugés, donne, mieux que la carte de Cassini, une idée de la géographie d'un royaume de dimension océanique : outre Paris et Versailles, un archipel de villes (la plupart médiocres), mal articulées et entourées de déserts ; une terre inégalement fertile dont de grandes parts sont stérilisées par les capitaineries des Grands (réserves de chasse) ; des châtelains inaptes à l'agriculture (même lorsque, rarement, ils se prétendent agronomes), réduits à la misère, ou restant dans leurs terres pour tirer le lièvre et faire des économies qu'ils dépenseront à la ville ; des paysans en haillons, sous-productifs, en raison tout à la fois, de l'émiettement des propriétés, de l'incertitude de leur tenure et de la crainte d'être tondus par le fisc ; de magnifiques routes royales, chefs d'œuvres techniques inutiles parce que sans circulation, construites à grands dégâts (corvée, expropriations, abus) et à grand frais, perpétuellement renouvelés puisqu'il faut les entretenir...
En dehors de leur occasionnelle fonction militaire, la plupart de ces glorieuses routes ne servent à rien, ni au commerce ni à la sociabilité. Elles expriment et symbolisent une ambition "territorialisatrice" qui, indépendamment de l'habileté et de la capacité des gouvernants, est aussi fatale qu'irréalisable.
La technologie (particulièrement, les moyens d'information et de communication) ne permet pas de fusionner tous ces ressorts divers, surtout à une échelle quasi continentale. Les hiérarchies naturelles du temps (noblesse) étant à la fois suspectes (ambitions) et perverties (achats), il faut recourir à des hiérarchies artificielles, parallèles, dans lesquelles les "ressources humaines" sont pilotées à la main dans des chaînes de sous-traitance (cf. Nières, 1999). On comprend que certains rêvent à la Chine et à sa pyramide bureaucratique réglée et nomenclaturée.
b)
L'autorité empruntée d'une administration clandestine
Les célèbres Remontrances de la Cour des Aides de Paris de 1771 [66], manifestation de solidarité avec le Parlement dispersé militairement, synthétisent et développent d'anciennes observations de la Cour [67], sous la plume et l'autorité de Malesherbes (Chrétien-Guillaume de Lamoignon), son Premier Président de 1750 à 1775. Elles seront reprises en grand, dans les Remontrances relatives aux impôts de 1775, adressées à Louis XVI, si convaincantes qu'il en fait disparaître la minute : vous ne désirez pas qu'il reste dans vos registres un monument propre à perpétuer le souvenir des malheurs que le Roi voudrait faire oublier [68].
Si Malesherbes, en tant qu'homme, inspire la sympathie, parfois à l'excès (Egret, 1956), c'est bien la Cour des Aides qui parle à travers lui. Instituée pour juger en dernier ressort le contentieux en matière fiscale, la Cour dénonce, de façon récurrente et de plus en plus fort, qu'on a fait taire toutes les Loix pour y substituer les principes variables de ce qu'on a voulu appeler l'administration (Remontrances du 22 septembre 1759). Cela éclaire les difficultés du Parlement : il combat pour les lois, alors qu'elles ne sont plus de saison.
La Cour des Aides analyse le système qui opère en matière fiscale. Schématiquement, les impôts directs sont répartis et collectés par les Intendants, et les indirects par les Fermiers généraux. Les uns et les autres nomment des commissaires et leur prêtent leur autorité ; ces commissaires emploient des agents qui recrutent des sous-agents jusqu'à l'échelon du village, tous payés sur le produit des impôts et des amendes. Aussi, à supposer même des chefs honnêtes et consciencieux, ces armées innombrables seront ignorantes et cupides. Idem en matière de contrebande (traites), de faux-saunage (gabelle) et de faux tabac.
Les innombrables contestations auxquelles donnent lieu exactions et saisies remontent au tribunal de l'Intendant qui, habituellement, soutient les agents sans lesquels il serait impuissant. S'il sent la matière dangereuse, il se fait délivrer un arrêt du Conseil du Roi. Imposture : cet arrêt n'est pas pris en Conseil mais, au nom du Conseil, par le contrôleur général et l'Intendant de Finances, et souvent par ce dernier seul. Et, quand nous [la Cour des Aides] avons fait voir clairement les petites passions subalternes qui avaient fait obtenir ces ordres, les petites vengeances, les petites protections, ne nous a-t-on pas dit que c'était manquer à la majesté royale, que de révoquer en doute qu'un ordre signé du roi fût réellement donné par lui-même ? (Remontrances de 1775).
Le commis agit au nom du subdélégué ; celui-ci, de l'Intendant ; ce dernier, du Contrôleur que couvre le nom du Roi. Chacun peut tout, et ne répond de rien : car le nom respectable dont il lui est permis de se servir, ferme la bouche à quiconque oserait se plaindre.
Même en faisant la part de l'exagération rhétorique et de la jalousie institutionnelle de la Cour, la distance et la granularité (action locale) rendent évident le tableau de cette "sous-traitance" généralisée. Elle coûte cher car chaque maillon intermédiaire prélève sa "marge".
Cet empilement trouve son origine et sa sanction dans le Conseil du roi. La monarchie "administrative" (les guillemets se passent désormais de commentaires) a gardé les formes de la monarchie judiciaire, et les décisions sont prises en tant qu'arrêts du roi, c’est-à-dire de décisions de justice en dernier ressort.
La plupart des arrêts rendus en finance au XVIIIe siècle l’ont été sans avoir fait l’objet d’une délibération préalable en Conseil. Cette situation, qui a suscité les remontrances de la Cour des aides, s’explique par le fait qu’il n’existait sous l’Ancien Régime aucun acte équivalent à nos arrêtés ministériels d’aujourd’hui : toute décision, même secondaire, prise par un service gouvernemental devait nécessairement faire l’objet d’un acte du roi, notamment sous la forme d’un arrêt du Conseil intitulé au nom du souverain... Cette opacité traduisait d’ailleurs un principe fondamental : celui de l’unité du Conseil. Même réparti en formations spécialisées, celui-ci ne faisait qu’un... (Barbiche, 2010). La fiction de l'absolutisme royal, d'un roi aux mille bras, exalte cette toxique unité des Conseils.
Examinons de
plus près les Remontrances de la Cour des Aides de
1775 (cf. Appendice) qui, reprenant
toutes les précédentes, exposent en pratique l'omniprésence et
l'omnipotence
d'un "Etat profond". Sans les développements pseudo-historiques dont
est coutumier le Parlement, sans citations juridiques, la Cour,
soulevant le
capot, met au jour les invraisemblables tuyauteries tentaculaires qui
pompent
la finance, partie pour le roi, partie pour les administrateurs,
leurs favoris, leurs alliés et leurs protecteurs.
Car, risque la Cour, ce système fonctionne grâce aux Puissants qu'il
épargne,
et au contraire intéresse. Les
représentants du peuple ont été anéantis, subornés ou subordonnés, les
représentations en faveur d'un collectif sanctionnées comme témérité
punissable ou association illicite. Restaient les Cours
souveraines :
on les a renvoyées à la justice contentieuse, en leur
interdisant de
parler pour le peuple.
Osant encore
davantage, la Cour oppose à l'alliance perverse
des administrateurs et des Puissants,
l'espoir d'une union du roi
et du peuple, le rétablissement de canaux directs, seul moyen de
reprendre le
contrôle de l'administration et d'annihiler son despotisme.
La pensée
politique occidentale stigmatise depuis l'Antiquité
le tyran qui remplace le bien public
par son intérêt propre : on doit le réprimander, le corriger, le
mettre en
tutelle ou l'éliminer. Il ne s'agit plus de cela, le problème à présent
est le despotisme qui résulte de la corruption
d'un système politique (Richter, 2002).
La Cour prend bien garde de ne pas confondre despotisme et puissance absolue. Elle plante d'abord un repoussoir : le despotisme oriental se caractérise par le pouvoir sans bornes des exécutants qui, transmis graduellement de haut en bas, se fait sentir jusqu'au dernier citoyen. Cela est possible car les peuples qui y sont sujets n'ont ni tribunaux, ni corps de lois, ni représentants, ni opinion publique.
Au
contraire, dans un pays
policé quoique soumis à une
puissance absolue, il ne doit y avoir aucun intérêt, ni général, ni
particulier,
qui ne soit défendu ; et tous les dépositaires de la puissance
souveraine
doivent être soumis à trois sortes de freins, celui des lois, celui du
recours
à l'autorité supérieure, celui de l'opinion publique.
La Cour poursuit : nous sommes une impossibilité, un pays policé qui souffre du despotisme. Comment les exécutants ont-ils franchi les barrières qui les retenaient ? Comment ceux qui prétendaient travailler pour l'autorité royale ont-il pu s'arroger sur tous les ordres de l'Etat un pouvoir exorbitant, et inutile au service de Votre Majesté ? La réponse, aussi simple qu'effrayante : depuis une centaine d'année (Colbert), s'est mis en place un système d'administration clandestine qui, tirant son autorité du roi, se cache de lui et, par l'obscurité dont il s'environne, échappe à tout recours. La clandestinité est le moyen de tous les arbitraires ; et aussi une fin, car elle procure l'impunité. Plus les exécuteurs deviennent puissants, plus ils desserrent les freins qui devraient les retenir.
Je qualifie ce
système de "polycratie sous couvert de
monarchie". Si, au niveau ministériel, il arrive que des politiques
différentes soient conduites par des réseaux concurrents, le royaume
dans son
détail est soumis à des réseaux parallèles, enveloppés dans l'autorité
absolue
du "monarque", grâce au Conseil
des Finances qui, les soustrayant aux poursuites, rend des arrêts
du roi en
leur faveur. Aussi — c'est essentiel— toute attaque contre eux
apparaît comme une attaque contre le Roi : Peut-être
serez-vous étonné, Sire, quand vous verrez jusqu'à quel point
on a abusé du prétexte de votre autorité contre cette autorité
elle-même...
Ce système agit à la faveur des ténèbres qui dissimulent les opérations et les opérateurs.
* Opérations : les règles des impôts indirects (fermes) ne sont rassemblées dans aucun code public. Au reste, leur complexité, leur variation selon les lieux, leur flou, ne permettraient pas de les formaliser. Chaque fermier ou directeur est seul à maîtriser la science occulte de sa branche. De même, les impôts directs : le montant de la taille et de ses suppléments, leur répartition en cascade (généralités, élections, paroisses), leur perception, sont opaques, et le contribuable n'a rien à opposer à l'arbitraire ; l'assiette des impôts personnels (capitation, vingtième) est incertaine car les exacteurs ne peuvent pas connaître la valeur des biens. Ce brouillard permet faveurs et défaveurs, chantage et corruption. Rien ne pousse à le dissiper car le contentieux ne relève pas de la Justice qui appellerait des règles fixes mais, directement ou indirectement (évocation, cassation), de l'arbitraire (intendant, conseil de finance).
* Opérateurs : le ministre (contrôleur général) décide par les Intendants de finance et opère, au centre par une multitude de commis inconnus et sans état, et dans les provinces par les Intendants ; les Intendants que leur précarité soumet au ministre, agissent par des subdélégués à leurs ordres qui envoient dans les paroisses une multitude de commissaires, préposés, agents ; de même, le fermier recrute une armée de percepteurs, d'inspecteurs, de commis, de gardes armés et d'employés de toutes sortes. Et ainsi de suite : à partir de la délégation originaire (le bail de la ferme ou la commission du Conseil de finance), la capacité d'action locale passe par des réseaux de sous-traitance (payés par le contribuable), où chaque niveau recrute ses sous-ordres qui, libres de leurs moyens, ont une obligation de résultat (prélever le maximum). A chaque étage, l'agent anonyme représente l'étage supérieur et lui emprunte son autorité. Sauf bavure (maltraiter un Puissant), il sera couvert par son "donneur d'ordres", et ainsi de suite en remontant jusqu'à l'Intendant ou au directeur de la ferme, et in fine jusqu'à la majesté du Conseil du roi.
Ces réseaux sont parallèles car la compétence de chacun se limite à un type d'impôt, et les espaces diffèrent. Tout en haut, tout se mêle, tout se perd, dans la nébuleuse du Contrôle général.
On sent l'impropriété de l'expression "monarchie administrative" : d'abord ce n'est plus une monarchie (gouvernement d'un seul) ; ensuite, il faudrait violenter la grammaire et écrire "monarchie administratives" car il n'y a pas une mais plusieurs "administrations" ; enfin, "administration" est ici un mot aussi incongru que "usine" dans le putting out system.
Le système que décrit la Cour des Aides ne se limite pas à la finance. Ce qu'on sait du fonctionnement pratique de sa branche jumelle, l'armée, montre la généralité d'une sous-traitance incontrôlée : du recrutement à la logistique, des chantiers navals aux fortifications, des munitions aux fournitures, tout repose sur ce principe qui implique relations personnelles, opacité, arbitraire et profits faciles. Et, sous couvert du terrifiant logement des troupes, les militaires lèvent des impôts sur les maisons quand ils ne sont pas les auxiliaires des exacteurs.
N'allons pas plus loin. Ce qui nous importe ici, c'est la position paradoxale du Roi. Elle explique l'embarras du Parlement : son éternelle leçon sur le Roi et les Lois, son jeu de bascule avec le Roi, flottent dans le vide quand le gouvernement ne se fait plus par des lois mais par des Arrêts du Conseil, rendus sous l'autorité du Roi par des ministres, des intendants ou des commis. Comme ils empruntent la forme d'une décision judiciaire, le Parlement remontre, casse, interdit, sans percevoir que la monarchie a disparu. Le Roi ne gouverne plus, il ne le pourrait pas. Il ne tient pas les leviers de la structure organisationnelle qui, à l'échelle du royaume, est au contact des choses (fiscales, militaires et autres). Et le ministre non plus. Et l'intendant non plus.
Conclusion
Le Songe d'un jeune parisien, un factum pro-Maupeou de 1771 (Code des Français, T2, pp 330 sq.), prête aux conseillers du Parlement, le comportement que, avec un autre langage, la Cour des Aides attribue aux administrateurs :
Au
milieu de
l'exercice du pouvoir souverain, ils s'inclinaient souvent et faisaient
de
grandes protestations d'obéissance, sans que j'imaginasse quel pouvait
en être
l'objet ; et je ne voyais rien qu'un nuage épais qui couvrait la
moitié de
la salle... Je distinguai, quoiqu'avec assez de peine, une tête qui
portait une
Couronne et cette couronne chancelait ; et c'était à cette tête
que s'adressaient
nos hommages et elle semblait se contenter des démonstrations de notre
respect,
et ne contrarier en aucune façon notre puissance... Ceci me
disais-je... c'est
le Witznon [Vishnou] des Indiens qui conserve l'air de la Divinité et
sous le
nom duquel les Bramines en exercent l'empire et les droits... [E]n
reconnaissant un supérieur dont nous nous sommes faits les égaux, nous
réussissons à tenir nos sujets dans la dépendance.
Disons, de façon cavalière, que le roi est un homme qu'on prend pour le Roi. L'Histoire et le mythe le veulent, le cérémonial et le système de la cour le garantit ; et chacun y est intéressé car le prince compte juste comme un zéro : n'ayant aucune valeur par lui-même, il en donne au nombre auquel on l'ajoute [69]. Un et zéro font dix !
Le roi reste le fontainier des grâces et, tout en haut, dans le nuage, il sert de clef de voûte à l'architecture proliférante des fonctions publiques exercées privativement : La monarchie qui les a sécrétés [les administrateurs] malgré ses velléités d'absolutisme ne peut rien sans eux et ils ne peuvent rien en dehors d'elle (Dessert). C'est pis qu'un emboitement réciproque ou un anneau de Moebius : "les ministres" n'ont pas d'existence collective, les administrations clandestines sont multiples et parallèles, l'Etat profond n'a pas de chef.
Les administrateurs, décidant par arrêts du Conseil, empruntent l'autorité d'un Roi qui, s'il n'a pas le pouvoir jouit de pouvoirs considérables. Ses caprices (guerres, maitresses, faveur, grâces) sont tout-puissants et non sans effets, mais le gouvernement lui échappe. On s'étonnera que je mette les guerres au rang des caprices alors qu'elles ont tant d'effets, stratégiques, humains, matériels, fiscaux... et administratifs. Pourtant, outre que la faveur l'emporte sur les capacités pour désigner (ou démettre) les généraux en chef, qu'est-ce d'autre, par exemple, que la révolution diplomatique que le secret du Roi opère dans le dos de ses ministres en s'alliant à l'Autriche [70] ? Les caprices peuvent être dangereux. Si le roi caresse sa femme (maitresse ou épouse), par ce charmant canal s'écoule le bouillon des cabales de cour auxquelles tout le monde prend part, des Princes du sang aux valets. C'est ainsi que se font et se défont les ministres. A tout prendre, il vaut mieux que le roi perde son temps à la chasse et s'absente du Conseil. Mais un puppett king n'est pas la solution car il n'existe pas de centre alternatif. Aussi, l'ambiguïté et la confusion caractérisent-elles la "monarchie administrative", cette dimension institutionnelle du processus territorial.
Défenseurs du gouvernement et opposants, également inconscients de cette évolution, pensent en arrière : les seconds retrouvent les vieilles lunes monarchomaques qui triompheront après 1789, les premiers la vieille doctrine du droit divin !
La nouvelle constitution ne remplace pas l'ancienne, elle s'est coulée dedans, piégeant le Parlement. Son invariance le rend étranger à son siècle. L'adhésion à la monarchie essentielle le limite à la médiation patriarcale entre le roi et le peuple, dont l'expression tourne au rabâchage : aucune innovation dans une doctrine "constitutionnelle" achevée et close, faute d'alternative pensable et avouable. L'appel aux états généraux est sa déclaration de faillite.

Appendice : le motif dans le tapis
Outre l'indispensable Recueil d'Auger (1779), les
Remontrances de la Cour des Aides du 5 juillet 1768 ont été publiées
dans Touzery 1994 et celles du 18 février 1771 dans Bidouze, 2010b. Les
Remontrances sur les impôts
de 1775 ne semblant pas l'avoir été, je les donne en annexe.
De ce texte long (30 000 mots) d'un seul tenant, sinueux et compliqué,
partie par précaution, partie à cause de la matière, j'extrais ici, et
mets en suite et forme, le millier de mots qui dessinent le motif dans
le tapis (les soulignements, divisions et intertitres sont miens) :
...[Dans]
le despotisme oriental [...], non-seulement le souverain jouit d'une
autorité
absolue et illimitée, mais chacun des
exécuteurs de ses ordres use aussi d'un pouvoir sans bornes...
genre de
despotisme qui, étant transmis graduellement des ministres de
différents
ordres, se fait sentir jusqu'au dernier citoyen... [Au contraire] dans
un pays
policé quoique soumis à une puissance absolue, il ne doit y avoir aucun
intérêt, ni général, ni particulier, qui ne soit défendu ; et tous
les
dépositaires de la puissance souveraine doivent être soumis à trois sortes de freins, celui des lois,
celui du recours à l'autorité supérieure, celui de l'opinion publique...
Nous devons faire connaître à VM [...
que] ceux qui prétendaient travailler pour l'autorité royale ont
réellement et
efficacement travaillé pour s'arroger sur tous les ordres de l'Etat un
pouvoir
exorbitant, et inutile au service de Votre Majesté. [C'est] un
gouvernement
bien plus funeste que le despotisme [... :] l'administration
clandestine
par laquelle, sous les yeux d'un souverain juste, et au milieu d'une
nation
éclairée, l'injustice [...] se commet notoirement. Des branches
entières
d'administration sont fondées sur des systèmes d'injustices, sans
qu'aucun
recours, ni au public ni à l'autorité supérieure, soit possible...
L'administration,
juge et partie
Les
Cours des Aides et les Tribunaux qui y ressortissent sont, par leur
institution, juges de tous les impôts ; mais la plus grande partie
de ces
affaires ont été évoquées, et sont renvoyées devant un seul commissaire
du
Conseil, qui est l'intendant de chaque province et, par appel, au
Conseil de
finance, un conseil qui réellement ne se tient ni en présence de VM, ni
sous
les yeux du chef de la justice, auquel n'assistent ni les conseillers
d'Etat, ni
les maîtres des requêtes, et qui n'est composé que d'un contrôleur
général et
d'un seul intendant des finances ; où par conséquent l'intendant
des
finances est presque toujours le seul juge car il est rare qu'un
contrôleur
général ait le temps de s'occuper des affaires contentieuses.
[Quant
à] celles qui ne sont pas encore évoquées, et où le recours à la
justice réglée
semble encore permis, [il est contourné] par l'usage introduit de
porter les
requêtes en cassation contre les arrêts des Cours des Aides, au [même]
Conseil
des finances.
[Ainsi] ces affaires n'étant portées à
aucun tribunal réglé, l'abus le plus constaté par la notoriété publique
ne
l'est par aucune pièce juridique.
On
est parvenu à rendre illusoires les réclamations [...]. On veut même
les rendre
impossibles. C'est pour y parvenir que la clandestinité a été
introduite. Il en
est de deux genres : l'une qui cherche à dérober aux yeux de la nation,
à ceux
de VM elle-même, les opérations de l'administration ; l'autre qui
cache au
public la personne des administrateurs... [i]
[Toutes les exactions, des fermes au vingtième en
passant par la
taille] sont non seulement des actes d'autorité arbitraire, mais aussi
des
actes clandestins dans leur exécution car jamais [leurs modes
opératoires] ne
sont imprimés ni annoncés publiquement... [ii] le plus souvent on ne
sait pas,
on ne peut pas même découvrir, à qui chaque abus d'autorité doit être
imputé.
Le
subdélégué d'un intendant est un homme sans qualité, sans pouvoir
légal, qui
n'a le droit de signer aucune ordonnance : aussi toutes celles
qu'il fait
rendre sont signées par l'intendant. [C'] est aussi ce qui se passe de
l'intendant au ministre, et du ministre à Votre Majesté elle-même.
L'intendant
évite autant qu'il peut de prononcer en son nom. Dans toutes les
affaires qui
pourraient le compromettre, il prend le parti de faire rendre un arrêt
du
conseil, ou de se faire autoriser par une lettre du ministre...
Pour
les intendants des finances qui sont placés entre les intendants des
provinces
et les ministres, ce sont des puissances tout-à-fait inconnues de tous
ceux qui
sont éloignés de la capitale et du séjour de la cour.
Enfin,
le ministre lui-même n'a aucun état dans le royaume, aucune autorité
directe.
C'est cependant en lui que réside toute la puissance, parce que c'est
lui qui
certifie la signature de Votre Majesté. Il
peut tout, et ne répond de rien : car le nom respectable dont il
lui est
permis de se servir, ferme la bouche à quiconque oserait se plaindre.
Le système de
l'administration
[L']
intendant a souvent un intérêt contraire à celui de sa province. En
effet,
[...il] a sans cesse besoin des grâces de la cour ; il ne peut les
obtenir que
par un ministre à qui souvent on est sûr de plaire en lui facilitant
les moyens
de tirer tout le parti possible des impôts... l'état précaire et
incertain de
ces magistrats les oblige à de grands égards pour tous les gens de leur
province qui ont du crédit à la cour.
[Quant
aux ministres, ils] ont attiré à eux, depuis un siècle, le détail de
tant
d'affaires de tous les genres, qu'il leur est impossible de les
expédier
eux-mêmes. Il s'est donc établi un nouveau genre de puissance
intermédiaire
[...,] c'est celle des commis, personnages absolument inconnus dans
l'Etat, et
qui cependant parlant et écrivant au nom des ministres, ont comme eux
un
pouvoir absolu, un pouvoir irrésistible...
Les
ministres, toujours attentifs à saisir les moyens de mettre leur
administration
à l'abri de tout examen, ont eu l'art de rendre suspects, et les corps
réclamants
et la réclamation elle-même... Le recours au roi contre ses ministres a
été
regardé comme un attentat à son autorité... Toute requête dans laquelle
les
intérêts d'une province ou ceux de la nation entière sont stipulés, est
regardée comme une témérité punissable, quand elle est signée d'un seul
particulier ; et comme une association illicite, quand elle est signée
de
plusieurs.
[On]
s'est souvenu dans toutes les occasions que les fonctions des juges
[Cours
souveraines] étaient restreintes à leur seul territoire et à la justice
contentieuse ; et on a mis les mêmes limites au droit de
représentation. Ainsi,
tous les abus possibles peuvent être commis dans l'administration sans
que le
roi en soit jamais instruit.
[Reste
le "cri public" mais il] ne fut pas encore aussi prompt ni aussi
énergique qu'il aurait dû l'être ; parce que la politique du despotisme
est
toujours d'avoir de grands ménagements pour ceux qui peuvent se faire
entendre.
Ergo :
impasse
[L']
'intérêt du roi est toujours d'éclairer la conduite de ses ministres,
et celui
des ministres est quelquefois de n'être pas éclairés.
[L']
'intérêt du roi étant contraire à celui des ministres, le peuple a le
même
intérêt que le roi ; mais tous les grands de l'Etat, tous les gens
considérés, tous ceux qui approchent du roi, ou qui sont à portée de se
faire
entendre de lui, ont les mêmes intérêts que les ministres... l'intérêt
des
ministres réuni à celui de tous les gens puissants, l'emporte presque
toujours
sur celui du roi réuni à celui du peuple... comment établir une
relation entre
le roi et la nation, qui ne soit pas interceptée par tous ceux dont un
roi est
entouré ?
Si
nous allions jusqu'à proposer d'admettre une réclamation publique
contre les
abus de l'administration, [...] tous les ennemis de la liberté
publique, et
surtout ceux qui ont le privilège de parler en votre nom, ne
diraient-ils pas
que ce sont les actions de VM elle-même qu'on veut soumettre à la
censure
publique ? On ignore toujours si les
actes d'autorité sortis du cabinet, ne sont pas pas son propre
ouvrage ;
et telle est depuis longtemps la politique des ministres, que leur
personne est
toujours à couvert, et que le nom de VM dont il est permis de se
revêtir, ou
une signature qui ressemble à la vôtre, et sur laquelle le respect ne
permet
pas d'élever aucun doute, ont mis dans la même classe les actes de
votre
volonté personnelle et ceux qui se prodiguent à votre insu ; en
sorte que
les citoyens opprimés craignent toujours de s'écarter du respect en se
plaignant de l'injustice et ne savent jamais si ce n'est pas manquer à
la
puissance suprême que de l'invoquer...

Références
a) contemporaines
- —, 1652, Observations véritables et désintéressées sur un écrit imprimé au Louvre intitulé 'les sentiments d'un fidèle sujet du roi', Paris
- —, 1652, [Machon Louis] Véritables maximes du gouvernement de la France justifiées par l'ordre des temps, depuis l'établissement de la Monarchie jusques à présent: servant de réponse au prétendu arrêt de cassation du Conseil du 18 jan 1652, Paris, ch. Vve Guillemot
- —, 1717, [Boulainvilliers], Mémoire pour la noblesse de France, contre les ducs et pairs
- —, 1752, Mémoire touchant l'origine & l'autorité du Parlement de France, appellé Judicium Francorum, In: Mémoires de Mézeray, Amsterdam, ch. Jean Fréderic Bernard, 1753, T2, à la lettre P, # Parlement de Paris, p 121 sq. : réécriture de [Machon Louis], 1652
- —, 1754, Lettres sur l'Autorité du Roi, du Conseil d'Etat et du Chancelier de France; Et la dépendance des Parlemens à leur égard, sans lieu d'impression
- —, 1756, Remontrances du Parlement de Grenoble, slnd
- —, 1759, Recueil d'Arrestés, Articles & Remontrances de différentes classes du Parlement, Au sujet de ce qui s'est passé au Parlement séant à Besançon
- —, 1763, Lettre d’un avocat du Parlement de Paris à un de ses confrères à Dijon [réponse au Mémoire contre la jurisdictio ]
- —, 1764, [Cantalauze, Michel], Dissertation sur l'origine et les fonctions essentielles du Parlement, sur la Pairie et le droit des Pairs, et sur les lois fondamentales de la monarchie française, Amsterdam
- —, 1765, Objets
des Remontrances du Parlement de Grenoble concernant les affaires de Pau
- —, 1771, Manifeste aux Normands, slnd
- —, 1771, Observations
sur l'écrit intitulé : Protestation des Princes, suivies des Protestations des Princes du
Sang Contre l'Edit de
Décembre 1770, les Lettres Patentes du 23 Janvier, l'Edit de Février
1771,
& contre tout ce qui s'en est ensuivi ou pourroit s'ensuivre
- —, 1771, Le Code des François, ou Recueil de toutes les pièces intéressantes publiées en France, relativement aux troubles des Parlements, Bruxelles, ch. Flon, [compilation pro Maupeou]
- —, 1771, [Beaumont?, Augeard ?], Lettre
sur l'état actuel du crédit
- —, 1771, [Blonde André], Le
Parlement
justifié par l'impératrice de Russie, ou Lettre
à M*** dans laquelle on répond aux différents écrits que M. le Ch. fait
distribuer dans Paris
- —,
1771 et 1772, [Augeard], Correspondance secrète
et familière du chancelier Maupeou
avec son cœur Sorhouet, In : [Mairobert], 1775
- —,
1772, [Le Paige], Requête des Etats
Généraux au Roi, Londres
- —,
1772, Les propos indiscrets
- —,
1774, [Mairobert], Journal historique de
la Révolution opérée dans la Constitution de la Monarchie Françoise,
par M. de
Maupeou, Chancelier de France, Londres
- —, 1775, [Mairobert], Maupeouana ou Correspondance secrète et familière du chancelier Maupeou avec son cœur Sorhouet, Tome 1 et 2, "imprimé à la Chancellerie", suivis des tomes 3 et 4 : Les efforts du patriotisme; ou recueil complet des Écrits publiés pendant le règne du Chancelier Maupeou— Pour démontrer l'absurdité du despotisme qu'il voulait établir, & pour maintenir dans toute sa splendeur la Monarchie Françoise — Ouvrage qui peut servir à l'histoire du siècle de Louis XV, pendant les années 1770, 1771, 1772, 1773 & 1774, Paris, "avec l'approbation unanime des bons & fidèles sujets de Sa Majesté Louis XVI"
- —,
1775, Sur les finances, ouvrage
posthume de Pierre André ****, fils d'un bon laboureur, [Londres]
- —,
1781, Collection complète des ouvrages
pour et contre M. Necker, [Utrecht], 3 vols
- —,
1787, Procès-verbal de ce qui s'est passé
au Lit de Justice, tenu par le Roi à Versailles, le
6 août 1787, Paris,
Imprimerie Royale
- —,
1787, [d'Eprémesnil ?], Le coup
manqué ou Le retour de Troyes
- —, 1787, Procès-verbal de ce
qui s'est passé au Lit de Justice, Tenu par le ROI à Versailles, le
Lundi 6
Août 1787, A Paris, Imprimerie Royale
- —, 1787, Réflexions d'un citoyen sur la séance royale, tenue le 19 novembre 1787, pour servir de supplément aux Remontrances du Parlement, Liège
- —, 1787, [Maury], Supplément aux remontrances du Parlement, — en réponse à la lettre d'un ami
- —, 1788, Mémoire des princes présenté au Roi
[repr. Auget de Montyon]
- —, 1790, [Ferrand], Nullité́ et despotisme de l'Assemblée prétendue nationale
- Artois, Comte d'-, 1788, Mémoire des princes présenté au Roi
- Augeard, Mémoires secrets de J. M. Augeard, Ed. Bavoux, 1866
- Auger [Dionis du Séjour ?], 1779, Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, ou Recueil de ce qui s'est passé de plus intéressant à la Cour des Aides depuis 1756 jusqu'au mois de juin 1775, [Bruxelles]
- Bachaumont, Mémoires secrets de Bachaumont, de 1762 à 1787, Ed. Ravenel, 1830, 4 vols
- Beaumarchais, 1773-4, Mémoires dans l'affaire Goezman, Ed. Sainte-Beuve, Paris, 1868
- Bésenval, Mémoires du Baron de Besenval, Ed Berville, Barrière, 1821, 2 vols
- Bosquet, 1762, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, ch. Le Boullenger
- Boulainvilliers, 1715 ou 1716, Mémoire sur la convocation d'une assemblée d'Etats Généraux, In : Mémoires présentés à Mgr le duc d'Orléans, régent de France, La Haye et Amsterdam, 1727, T1
- Buterne, 1763, Dictionnaire de législation, de jurisprudence et de finances sur toutes les fermes unies de France par Monsieur B***, Avignon, Chambeau
- d'Aguesseau. 1718, "Fragments sur l'histoire des Remontrances", in : Œuvres complètes du chancelier d'Aguesseau, Nouvelle édition, Pardessus, 1819, Tome 10
- d'Eprémesnil, 1771, Discours de M. d'Eprémesnil, au moment où il s'est remis entre les mains de M. d'Agout, slnd
- d'Eprémesnil, 1789, Discours et opinions, Ed. Servier, 1823
- de Bernis François-Joachim de Pierre, Mémoires et lettres (1715-1758), publiés d'après les manuscrits inédits, Frédéric Masson, Paris, Plon, 1878, 2 vols.
- Darigrand Edme-François, 1763, L'Anti-Financier, ou Relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les Fermiers-Généraux..., [Amsterdam]
- Fénelon, 1711, Plans de gouvernement pour être proposés au duc
de Bourgogne, OC,
1854, T6
- Ferrand
Antoine-François-Claude, Mémoires du
Comte Ferrand, Ed.
Broc, Société d'histoire contemporaine, 1897, Paris, Picard
- Galiani, Correspondance, Ed
Perey, Maugras, 1881
- Goudar, 1756, Testament politique de Louis Mandrin, Genève,
7ème Ed.
- Le Paige Louis
Adrien, 1753 et 1754, Lettres historiques
sur les fonctions essentielles du Parlement,
sur le droit des pairs, et sur les loix fondamentales du royaume,
Amsterdam, 2 vols
- Linguet Simon-Nicolas-Henri,
1788, La France plus qu'anglaise, [Bruxelles]
- Mably Gabriel Bonnot de -, 1765, Observations sur l’histoire de France, In : Collection complète des œuvres de l'abbé de Mably., Paris, an III, Tome 2 et 3
- Mercier Louis-Sébastien, 1781, Tableau de Paris, Hambourg, Virchaux, 2 vols
- Mercier Louis-Sébastien, 1798, Paris pendant la Révolution (1789-1798) ou le Nouveau Paris, Ed. Poulet-Malassis, Paris, 1862, 2 vols
- Moreau de Beaumont, 1787, Mémoires concernant les impositions et droits, Vol. 2 : France, Paris, ch. Desaint
- Mouffle d'Angerville Barthélemy-François-Joseph, 1781, Vie privée de Louis XV ; ou Principaux événemens, particularités et anecdotes de son regne, A Londres [Berne], chez John Peter Lyton, 4 vols.
- Necker Jacques, 1781, Compte rendu au roi, Imprimerie royale
- Necker Jacques, 1781, Mémoire au Roi sur l'établissement des administrations provinciales, Vienne, Trattnern
- Orléans, Duc d'-, 1756, RECLAMATION Présentée au Roi le 20 Février 1756 par M. le Duc d'Orléans au nom des Princes & des Pairs, Au sujet de la Défense qui leur avoit été faite par Sa Majesté de se rendre à l'invitation qu'ils avoient reçue d'aller prendre leur Séance au Parlement
- Panckouke, ed., 1784, Encyclopédie méthodique. Finances, Paris
- Picault Pierre, 1679, Traité des Parlements ou Etats-généraux, [A Cologne, Chez Pierre Marteau]
- Roussel, 1763, Richesse de l'Etat
- Senac de Meilhan Gabriel, 1787, Considérations sur les richesses et le luxe, Amsterdam
- Senac de Meilhan Gabriel, 1795, Du gouvernement, des mœurs, et des conditions en France, avant la Révolution, Hambourg, ch. Hoffmann
- Simonel Dominique, 1753, Dissertation sur l'origine, les droits, et les prérogatives des Pairs de France ; où l'on examine si le Parlement en Corps peut décréter un Pair de France, sans ordonner préalablement la Convocation des Pairs ; & si cette Convocation n'est nécessaire, que lorsqu'elle est requise par l'accusé, sans lieu d'impression
- Véri, abbé de-, Journal de l'abbé de Véri, publié par Jehan de Witte, 1928-29, 2 vols
- Voltaire, 1769, Histoire
du parlement de Paris, Amsterdam
- Young
Arthur, 1792, Voyages en France pendant
les années 1787, 1788, 1789, trad. Lesage, 1882
b) XIXe siècle et premier XXe
- Aubertin Charles, 1873, L'esprit public au XVIIIe siècle— Etude sur les mémoires et les correspondances politiques des contemporains - 1715 à 1789, Paris, Didier
- Bastard d'Estang, 1858, Les parlements de France : essai historique
sur leurs usages, leur organisation et leur autorité, Paris, 2 vols
- Bonneau
Jacques, 1910, Les Législations
françaises sur les tabacs sous l'ancien Régime, Paris, Sirey
- Cahen
Léon, 1913, Les querelles religieuses et
parlementaires sous Louis XV, Paris, Hachette
- Capon Gaston, Yve-Plessis Robert-Charles, 1907, Vie privée du prince de Conty, Louis-François de Bourbon (1717-1776), Paris, Schemit
- Carcassonne Elie, 1927, Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, Slatkine Reprints, Genève, 1978
- Caron Pierre, 1906, "La tentative de contre-révolution
de juin-juillet 1789", In: Revue d'histoire
moderne et contemporaine, tome 8, N°1, pp. 5-34, et N°9, pp. 649-678
- Carré Henri, 1892, "Les fêtes d'une réaction parlementaire (1774-1775)", La Révolution française : revue historique, Tome 23, Juil-Dec, pp 5-35
- Carré Henri, 1895, "Tactiques et idées de l'opposition parlementaire (1788-89)", La Révolution française : revue historique, Tome 29, Juil-Dec, pp 97-121
- Carré Henri, 1897, "Un précurseur inconscient de la Révolution : le conseiller Du Val d'Eprémesnil (1787-1788)", La Révolution française : revue historique, Tome 33, Juil-Dec, pp 405-437
- Carré Henri, 1907, "L'Assemblée constituante et la «Mise en vacances» des Parlements. (Novembre 1789-Janvier 1790)", In: Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 9, N°4, pp. 241-258 ; et N°5, pp. 325-347
- Carré Henri, 1911, Louis XV (1715-1774), Histoire de France (Lavisse), Tome VIII — 2ème partie
- Carré Henri, Sagnac, Lavisse, 1911, Louis XVI (1774-1789), Histoire de France (Lavisse), Tome IX
- Carré Henri, 1920, La noblesse de France et l'opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Champion
- Dedieu Joseph, 1928, "L'agonie du jansénisme (1715-1790)", In: Revue d'histoire de l'Église de France, tome 14, n°63, pp. 161- 214
- Desmaze Charles, 1859, Le Parlement de Paris : son organisation, ses premiers présidents et procureurs, Paris
- Droz
Joseph, 1839, Histoire du règne de
Louis XVI, pendant les années où l'on
pouvait prévenir ou diriger la
Révolution française,
Renouard, 2 vols
- Dufey Pierre-Joseph-Spiridion, 1826, Histoire, Actes et Remontrances des Parlements de France, Chambres des Comptes, Cours des Aides, et autres cours souveraines, depuis 1461 jusqu'à leur suppression, Paris, 2 vols
- Estignard Alexandre, 1892, Le parlement de Franche-Comté, de son installation à Besançon à sa suppression, 1674-1790, Paris, Besançon
- Fayard Ennamond, 1878, Aperçu historique sur le Parlement de Paris, 3 vols
- Flammermont Jules, 1883, Le chancelier Maupeou et les Parlements
- Flammermont Jules, 1888-98, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, T1 : 1715/53 ; T2 :1755-68 ; T3 : 1769-88, Imprimerie Nationale
- Fleischmann Hector, 1908, Les pamphlets libertins contre Marie-Antoinette, Paris
- Floquet Amable, 1842, Histoire du parlement de Normandie, vol. 6 et 7
- Funck-Brentano Frantz, 1908, Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France, Paris, Hachette
- Gaudry Joachim-Antoine-Joseph, 1864, Histoire du Barreau de Paris depuis son Origine jusqu'à 1830, Tome 2
- Glasson Ernest-Désiré, 1901, Le Parlement de Paris : son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu'à la Révolution, 2 vols, Slatkine Reprints, 1974
- Isambert et al., 1830, Recueil général des anciennes lois françaises, T.21 (1715-37), T.22 (1737-1774), T.23 (1774-76), T.24 (1776-77) ; idem 1827, (1785-89)
- Jobez Alphonse,
1866, La France sous
Louis XV (1715-1774),
Paris, Didier,
6 vols
- Marion Marcel, 1914, Histoire financière de la France depuis 1715, Tome 1, Paris
- Marion Marcel, 1923, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Picard
- Mathiez Albert, 1898-99, "Étude critique sur les journées des 5 & 6 octobre 1789", Revue historique, T. LVII, pp 241-281 ; LVIII, pp 258-294 ; LIX, pp 41-66
- Pizard Alfred, 1882, La France en 1789 : la société, le gouvernement, l'administration, Paris
- Préclin Edmond, 1929, Les jansénistes du XVIIIe siècle et la constitution civile du clergé: le développement du richérisme, sa propagation dans le bas clergé, 1713-1791, Paris
- Préclin Edmond, 1930, "Edmond Richer - Sa vie. Son ceuvre. Le richérisme", Revue d’histoire moderne, n°28, p 241 sq
- Raudot Claude-Marie, 1841, La France avant la Révolution — son état politique et social en 1787, Paris, Paulin
- Rocquain Félix, 1878, L'esprit révolutionnaire avant la Révolution 1715-1789, Paris, Plon
- Seilhac Victor de-, 1862, L'abbé Dubois, Paris, Amyot
- Tocqueville Alexis de-, 1856, L'ancien régime
et la révolution, OC 1866, T4 ; et T8, Chapitres
inédits de l'ouvrage destiné à
faire suite à L'ancien régime et la révolution
c) modernes
- Antoine Michel, 1958, "Les Conseils des Finances sous le règne de Louis XV", In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 5, N°3, pp. 161-200
- Antoine Michel, 1989, Louis XV, Fayard
- Antoine Michel, 1990, "Nostalgie de la Fronde et opposition parlementaire sous Louis XV", In: Cahier des Annales de Normandie, n°23, Recueil d'études en hommage à Lucien Musset, pp. 481-491
- Antoine Michel, 1992, "Sens et portée des réformes du chancelier de Maupeou", Revue historique, n° 583, p. 58 sq.
- Antoine Michel, 1993, "Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis XIV (1673-1715)", In: Bibliothèque de l'école des chartes, tome 151-1, pp. 87-122
- Arabeyre Patrick, 2000, "Aux racines de l’absolutisme : Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge...", Cahiers de recherches médiévales, N°7
- Aubert
Gauthier, Chaline Olivier (eds), 2010, Les
Parlements de Louis
XIV : Opposition, coopération, autonomisation, PU
Rennes
- Baker Keith Michael, 1987, "Politique et opinion publique sous l'Ancien Régime", In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 42ᵉ année, N°1, pp. 41-71
- Barbiche Bernard, 2010, "Les attributions judiciaires du Conseil du Roi", Histoire, économie & société, 29e année, N°3, pp. 9-17
- Bart Jean, 1999, "Le réveil des prétentions parlementaires à la mort de Louis XIV", In: Cahiers Saint Simon, n°27, Idées d'opposants au temps des Mémoires, pp. 29-36
- Belissa Marc, 2001, "Les stratégies de la Contre-Révolution. L’exemple du débat au Parlement anglais (1792-1794)", In : Martin Jean-Clément (dir.), La Contre-Révolution en Europe : XVIIIe-XIXe siècles, PU Rennes, pp. 163-173
- Bell David A, 1990, "Des stratégies d'opposition sous Louis XV : l'affaire des Avocats, 1730-3", In: Histoire, économie et société, 9ᵉ année, n°4. pp. 567-590
- Bell David A., 2009, "A la recherche d’un nouveau paradigme ? —response to a forum on “Twenty Years after the Bicentennial” appearing in French Historical Studies (32/4)", H-France Salon, 1/1, No.1
- Bercé Yves-Marie, 2000, "Le rôle des États généraux dans le gouvernement du royaume (XVIe et XVIIe s.)", In: Séances de l'AIBL, 144ᵉ année, N° 4, pp. 1221-1240
- Bianchi Serge, 2004, Des révoltes aux révolutions : Europe, Russie, Amérique (1770-1802). Essai d'interprétation, PU Rennes
- Biard Michel, "Paris/provinces. Le fil conducteur des pouvoirs, rouages et dysfonctionnements", In: Martin Jean-Clément (dir.), La Révolution à l'œuvre : Perspectives actuelles dans l'histoire de la Révolution française, PU Rennes, pp 57-76
- Bidouze Frédéric, 1996, "Le
parlement de Navarre et l’union des classes : doctrine et réalités", In: Poumarède, Les
Parlements de province
- Bidouze Frédéric, 2007, "Les remontrances parlementaires au XVIIIe siècle : tourner le dos à la 'table rase', entre archaïsme, adaptation et invention", In: Lumen : travaux choisis de la Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, vol. 26, pp. 109-125
- Bidouze Frédéric, 2010a, "La représentation parlementaire dans les pamphlets (1771-1791) : de la menace révolutionnaire à l’incarnation du despotisme contre-révolutionnaire", Actes du 57ème congrès de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées d'Etat (Paris, août 2006), p 1323 sq.
- Bidouze Frédéric, 2010b, "Les remontrances de Malesherbes (18 février 1771) : discours « national » de ralliement et discours parlementaire", In : Lemaître (dir.), Le monde parlementaire au XVIIIe siècle : L’invention d’un discours politique, PU Rennes
- Bidouze Frédéric, 2011, "Pour une autre histoire des Parlements au XVIIIe siècle : discours et représentations, une culture française du politique", In: Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 15, pp. 114-132
- Bidouze Frédéric, 2017, "Du repentir incarné de la Révolution française jusqu’à en mourir, J-J Duval d’Eprémesnil (1787-1794)", Colloque Le Repentir, Genèse (s) et actualité (s), Dakar
- Bluche François, 2000, Louis XV, Perrin
- Bottin Michel, 1986, "La réforme fiscale devant le Parlement de Paris : de l’extension du contrôle d’opportunité au recours aux Etats Généraux", Bicentenaire de la Révolution française, Université R. Descartes, Réformes ou Pré Révolution ?, Paris
- Bourdin Philippe, (Ed.), 2010, Les noblesses françaises dans l'Europe de la Révolution, PU Rennes
- Bouveresse Jacques, 2016, "Le règne de Louis XIV, ou la rupture définitive entre la société française et la monarchie", Les Annales de droit, N°10
- Brancourt Isabelle, 2005, Le Parlement de Paris au risque des archives — Le Parquet, le greffe, la cour, Université Panthéon-Sorbonne
- Campbell
Dr Peter, 2006, (Ed.), The origins of the French Revolution.
Palgrave
Macmillan
- Campardon
Émile, 2000, Grand Conseil et Conseil
Privé— Répertoire numérique des sous-séries V5 et V6, Introduction
- Campbell Peter R., 2005, " The Origins of the French Revolution in Focus", In: Campbell, ed, The Origins of the French Revolution
- Campbell
Peter R., 2009, "Redefining the French Revolution. New directions,
1989–2009 — response to a forum on “Twenty Years after the
Bicentennial” appearing in French Historical Studies (32/4)", H-France Salon, 1/1, No. 2
- Campbell
Peter R., 2012, "Crises 'politiques' et parlements : pour une
micro-histoire des crises parlementaires au XVIIIe siècle", Histoire,
économie & société, 31e
année, N°1, pp. 69-91
- Campbell
Peter R., 2013, "Rethinking the Origins of the French Revolution", In:
Peter McPhee, A Companion to the French
Revolution, Blackwell
- Chaline Olivier, 2006, "Les infortunes de la fidélité les partisans du pouvoir royal dans les parlements au XVIIIe siècle", Histoire, économie & société, n°3, 25e année, p 335-353
- Chaline Olivier, 2010a, "Une chronologie à
reconsidérer— conclusions", In: Aubert, Chaline (eds), pp.
305-310
- Chaline Olivier, 2010b, Cassations et évocations dans les remontrances des Parlements au XVIIIe siècle", Histoire, économie & société, 29e année, n°3, pp. 57-68
- Chappey
Jean-Luc, 2005, "Les
« anti-Lumières » et les oppositions intellectuelles à la
révolution",
In : Martin Jean-Clément (dir.), La Révolution
à
l'œuvre : Perspectives actuelles dans l'histoire de la Révolution
française, PU Rennes, pp. 165-180
- Claeys Thierry, 2011, "Le contrôleur général des finances : les faux-semblants d’un pouvoir", In : Dubet Anne, Luis Jean-Philippe (eds), Les financiers et la construction de l'État : France, Espagne (XVIIe-XIXe siècle), PU Rennes
- Clinquart Jean, 2004, "Ce que nous ignorons des fermes
générales", In : Histoire
institutionnelle, économique et financière : questions de méthode
(xviie-xviiie siècles) : Journée d'études, Ségur, 7 février
2002, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement
économique
- Cornand Suzanne, 2007, "La réaction patriotique à la crise de 1771", Dix-huitième siècle, N°39, pp. 189-200
- Cornette Joël, 2000, "L'histoire au travail. Le nouveau 'Siècle de Louis XIV' : un bilan historiographique depuis vingt ans (1980-2000)", In: Histoire, économie et société, 19ᵉ année, n°4, Louis XIV et la construction de l'État royal (1661-1672), pp. 561- 605
- Cossarutto Vincent, 2016, "Voltaire face aux théories parlementaires pendant la 'révolution' Maupeou (1771-1772)", Histoire, économie & société, 35e année, N°3, pp. 97-113
- Coste Laurent, 2016, "Des corps intermédiaires sous l’ancien régime : revendication ou réalité ?", Histoire, économie & société, 35e année, N°1, pp. 14-23
- d'Arvisenet Guy, 1955, L'office de conseiller à la Cour des Aides de Paris au XVIIIe siecle d'après les mémoires inédits de Louis-Achille Dionis du Séjour", Revue historique de droit français et étranger, Quatrième série, 33e année, pp 537 sq.
- Decroix Arnaud, 2011, "Les Parlements, la réforme fiscale et l'opinion publique dans les dernières décennies de l'ancien régime", Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 15, pp. 92-104
- Dessert Daniel, Journet Jean-Louis, 1975, "Le lobby Colbert : un royaume ou une affaire de famille ?", In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 30ᵉ année, N. 6, pp. 1303-1336
- Dessert Daniel, 2019, Colbert ou le mythe de l'absolutisme, Fayard
- Di Donato Francesco, 1997, "Constitutionnalisme et idéologie de robe. L'évolution de la théorie juridico-politique de Murard et Le Paige à Chanlaire et Mably", In: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 52ᵉ année, N°4, pp. 821-852
- Di Donato Francesco, 2003, "Le concept de « représentation» dans la doctrine juridico-politique de Louis-Adrien Lepaige", In : Le concept de représentation dans la pensée politique, PU Aix Marseille, pp. 53-73
- Di Donato Francesco, 2014, "De la justice politique à la politique de la justice : doctrines et pratiques conflictuelles de la souveraineté dans l’État moderne", In: Justice et État, XXIIIe Colloque international de l’AFHIP, Aix-en-Provence, sept. 2013
- Dousset Christine, 2011, "Marie-Antoinette : la reine refusée", les Cahiers de Framespa, revue d'histoire sociale, N°7, U. Toulouse-J. Jaurès
- Doyle William, 1982, "Les origines de la Révolution française : remise en cause", In: Annales historiques de la Révolution française, n°250, Hommage à Albert Soboul, pp. 627-631
- Durand Stéphane, 2016, "Monarchie absolue et assemblées d’États : le cas des États de Languedoc dans la monarchie de France (XVIIe-XVIIIe siècles)", Histoire, économie & société, 35e année, N°1, pp. 24-35
- Egret Jean, 1956, "Malesherbes, premier président de la Cour des Aides", In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 3, N°2, pp. 97-119
- Engrand Charles, 1996, "Les préoccupations politiques de Fénelon", In : Guinet Philippe, Deregnaucourt Gilles (dirs.), Fénelon, évêque et pasteur en son temps (1695-1715), Lille, Institut de recherches historiques du Septentrion
- Fauchois Yann, 1987, "Jansénisme et politique au XVIIIe siècle", In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 34, N°3, pp. 473-491
- Favier René, 2005, "Une province face à la contrebande dans la première moitié du XVIIIe siècle", Mandrin. Malfaiteur ou bandit au grand coeur ?, Musée dauphinois, pp.11-22
- Félix Joël, 1999, "Le secret des finances", In : id, Finances et politique au siècle des Lumières : Le ministère L’Averdy, 1763-1768, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, pp. 5-31
- Félix Joël, 2010, "Nécessité et obéissance : Le Parlement de Paris et la critique de la raison d’État, 1741-1763", In: Lemaître, Le monde parlementaire au XVIIIe siècle, pp. 39-56
- Feutry David, 2009, "Sauver les archives, défendre le roi : La remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury", In : Une histoire de la mémoire judiciaire, Paris, École nationale des chartes
- Feutry David, 2010a, "Évocations et cassations : l'attitude du parquet face aux décisions du Conseil du roi au XVIIIe siècle", Histoire, économie & société, 29e année, N°3, pp. 45-55
- Feutry David, 2010b, "Le parquet du parlement de Paris à la fin du règne de Louis XIV : une cohésion familiale et doctrinaire à l’épreuve des choix du roi", In Aubert, Chaline, eds, Les Parlements de Louis XIV, PU Rennes
- Feutry David, 2012, "La balance et le trébuchet : enjeux et perspectives de l’étude économique et financière du parlement de Paris dans le renouvellement de son historiographie", Histoire, économie & société, 31e année, N°1, pp. 93-104
- Feutry David, 2015, "L’historien, Sisyphe et les parlements", Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 122-3, pp. 185-192
- Figeac Michel, 2006, "Les magistrats en révolte en 1789 ou la fin du rêve politique de la monarchie des juges", Histoire, économie & société, 25e année, N°3, pp. 385-400
- Fitzsimmons Michael P., 1987, "Privilege and the Polity in France, 1786-1791", The American Historical Review, 92.2, pp. 269-295
- Furet François, Ozouf Mona, 1979, "Deux légitimations historiques de la société française au XVIIIe siècle : Mably et Boulainvilliers", In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 34ᵉ année, N° 3, pp. 438-450
- Grell Chantal, 1996, "Clovis, du Grand Siècle aux Lumières", In: Bibliothèque de l'école des chartes, tome 154-1, pp.173-218
- Grevet René, 2006, "L’affrontement entre les intendants des provinces et les Parlements : l’exemple du Dauphiné (1755-1761)", Assemblées et Parlements dans le monde du Moyen-âge à nos jours, 57e Conférence de l'ICHRPI, 2 vol., Paris, Comité d’histoire parlementaire et politique, Assemblée nationale, vol. 2, p. 805-818
- Grevet René, 2013, "Les intendants de la monarchie absolue face aux parlements : les enjeux d’une fragilisation politique (années 1750-1780)", In : Les parlementaires, acteurs de la vie provinciale : XVIIe et XVIIIe siècles, PU Rennes
- Gruder Vivian, 1982, "Les notables à la fin de l'Ancien Régime", In: Dix-huitième Siècle, n°14, Au tournant des Lumières : 1780-1820, pp. 45-56
- Guery Alain, 1978, "Les finances de la monarchie française sous l'Ancien Régime", In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 33ᵉ année, N° 2, pp. 216-239
- Guyotjeannin Olivier, 2005, "L'intégration des grandes
acquisitions territoriales de la royauté capétienne (XIIIe–début XIVe
siècle)", Vorträge und Forschungen,
vol. 63, p. 211-239
- Gusdorf Georges, 1976, Naissance de la conscience romantique au siècle des lumières, Tome VII de Les sciences humaines et la pensée occidentale, Paris, Payot
- Haddad Élie, 2016, "De la terre au sang : l’héritage de la noblesse (XVIe-XVIIIe siècle)", in Dubet, Léguer, hériter, La Découverte, pp. 19-32
- Hurt John J., 2002, Louis XIV and the parlements — The assertion of royal authority, Manchester UP
- Kadlec Lauriane, 2008, "Le droit d'enregistrement des Cours souveraines sous Louis XIII", Rev. hist. de droit. français et étranger, 86/l, janv-mars, pp. 39-68
- Kaplan Steven L., Milliot Vincent, 2009, "La police de Paris, une « révolution permanente » ? Du commissaire Lemaire au lieutenant de police Lenoir, les tribulations du Mémoire sur l’administration de la police (1770-1792)", In : Denys et al. (eds), Réformer la police : Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle,PU Rennes
- Krynen Jacques, 2002, "De la représentation à la dépossession du roi : les parlementaires «prêtres de la justice»", In: Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, tome 114, n°1, pp. 95-119
- Krynen Jacques, 2007, "Punir les juges ? 1667 : Pussort contre Lamoignon", In : À propos de la sanction, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole
- Larrère Catherine, 1999, "L'opposition à Louis XIV : Les données d'un problème", In: Cahiers Saint Simon, n°27, pp. 5-15
- Le Mao Caroline, 2006, "L'échec, le temps et l'histoire : réflexions autour de la Fronde parlementaire bordelaise", In: Histoire, économie & société, 25e année, N°3, pp 311-334
- Le Roy Ladurie Emmanuel, 1974, "Révoltes et contestations rurales en France de 1675 à 1788", In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 29ᵉ année, N°1, pp. 6-22
- Leferme-Falguières Frédérique, 2011, "Les rangs et préséances des princes étrangers et des princes légitimés", In: Cahiers Saint-Simon, n°39, Cérémonial, étiquette et politesse, pp. 73‑88
- Legay Marie-Laure, 2007, "Les défauts de paiement au XVIIIe siècle : défaillances ponctuelles et défaillances structurelles", In: Legay, (dir.), Les modalités de paiement de l’État moderne : Adaptation et blocage d’un système comptable, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, pp. 133-142
- Lemaître Alain, 2010, (dir.), Le monde parlementaire au XVIIIe siècle : L’invention d’un discours politique, PU Rennes
- Levinger Matthew, 1990, "La rhétorique protestataire du parlement de Rouen (1753-1763)", Annales E.S.C., 45ᵉ année, N° 3, pp. 589-613
- Maire Catherine, 1991, "L'Église et la nation. Du dépôt de la vérité au dépôt des lois : la trajectoire janséniste au XVIIIe siècle", In: Annales. Economies, sociétés, civilisations, 46ᵉ année, N°5, pp. 1177-1205
- Maire Catherine, 1999, "Louis-Adrien Le Paige entre Saint-Simon et Montesquieu", In: Cahiers Saint Simon, n°27, pp. 37-47
- Maire Catherine, 2010, "Le Paige et Montesquieu à l’épreuve du vocabulaire des enragés de Bourges", In: Lemaître Alain (dir.), Le monde parlementaire au XVIIIe siècle : L’invention d’un discours politique. PU Rennes, pp. 169-191
- Merlin-Kajman Hélène, 2001, "Civilité, civilisation, pouvoir", Droit & Philosophie, vol 3, p 49 sq.
- Miller Stephen, 2011, "La monarchie absolue pendant les deux dernières décennies de l’Ancien Régime : les assemblées provinciales de Necker, Calonne et Loménie de Brienne", Liame, 23
- Montenach Anne, 2016, "Conflit, territoire et économie de la frontière : la contrebande dans les Alpes dauphinoises au XVIIIe siècle", Revue de géographie alpine, 104-1
- Mousnier Roland, 1951-52, "Les idées politiques de Fénelon", Revue XVIIe siècle, p. 190-206
- Nassiet Michel, 2006, "Les effectifs de la noblesse en France sous l’ancien régime", In: Figeac, Dumanowski, (eds), Noblesse française et noblesse polonaise
- Nières Claude, 1999, "Les obstacles provinciaux au centralisme et à l'uniformisation en France au XVIIIe siècle", In : Dupuy Roger (dir.), Pouvoir local et Révolution, 1780-1850 : La frontière intérieure, PU Rennes
- Péronnet Michel, 1988, "L'Assemblée du Clergé de France tenue en 1788", In: Annales historiques de la Révolution française, n°273, pp. 227-246
- Platonova Natalia, "Le visa des papiers royaux en France au début du XVIIIe siècle, In: Legay, (ed.), Les modalités de paiement de l’État moderne : Adaptation et blocage d’un système comptable, Paris : Institut de la gestion publique et du développement économique, pp. p. 179-205
- Poumarède Jacques, Thomas Jack, (eds), 1996, Les Parlements de province : Pouvoirs, justice et société du xve au xviie siècle, Toulouse : Presses universitaires du Midi
- Pujol Stéphane, 2011, "Histoire, morale et politique chez Mably", In: Muriel Brot, Les philosophes et l’histoire au XVIIIe siècle, Hermann
- Regad
Caroline, 2017, "L’affaire des légitimés (1714-1723) au regard du droit
constitutionnel"
- Richter
Melvin, 2002, "Le concept de despotisme et l'abus des mots", In: Dix-huitième Siècle, n°34, Christianisme
et Lumières, pp. 373-388
- Rogister
John, 2011, "La résonance des Parlements de l'ancien régime au XIXe
siècle",
In: Parlement[s], Revue d'histoire
politique, n° 15, pp. 105-113
- Roza Stéphanie, 2014, "L’abbé de Mably, entre modérantisme et radicalité", Tangence, N°106, pp. 29-50
- Rosenfeld
Sophia, 2009, "Thinking about Feeling, 1789–1799", French
Historical Studies, Vol. 32, No.
4, pp. 697-706
- Saint-Bonnet François, 2010, "Louis XIV, les parlements et la souveraineté", In : Aubert, Chaline (eds), 2010
- Saint-Bonnet François, 2011, "Le 'constitutionnalisme' des parlementaires et la justice politique — Les équivoques des lits de justice du XVIIIe siècle", Parlement[s], Revue d'histoire politique, n° 15, pp. 16-30
- Servanton Mathieu, 2015, "Négocier avec les parlements durant les Frondes provinciales", In: Servanton, Valade, Négocier le pouvoir : XVIe-XXe siècles, Université Bordeaux Montaigne
- Servanton Mathieu, 2017, Factions et robes rouges : parlements et politique provinciale de Richelieu à la Fronde (1624-1654), Thèse, Université Montaigne-Bordeaux III
- Shank John B., 2009, "Is It Really Over? The French Revolution Twenty Years after the Bicentennial", French Historical Studies, 32.4, pp. 527-530
- Slimani Ahmed, 2004, La modernité du concept de nation au XVIIIe siècle (1715-1789) : Apports des thèses parlementaires et des idées politiques du temps, PU Aix-Marseille
- Spang
Rebecca L. , 2009, "Self, Field, Myth: What We Will Have Been —
response
to a forum on “Twenty Years after the Bicentennial” appearing in French
Historical Studies (32/4)", H-France
Salon, 1/1, No. 3
- Swann
Julian, 1994, "Parlements and political crisis in France under Louis
XV:
The Besancon Affair, 1757-1761", Historical
Journal, 37/4, pp. 803-828
- Swann
Julian, 2010a, "Coopération, opposition ou autonomie ? Le
parlement
de Dijon, les états de Bourgogne et Louis XIV", In: Aubert, Chaline
(eds),
pp. 117-132
- Swann
Julian, 2010b, "Repenser les parlements au XVIIIe siècle: du concept de 'l’opposition
parlementaire' à
celui de 'culture juridique des conflits politiques' ", In: Lemaître,
Le monde parlementaire au XVIIIe siècle PU Rennes, pp. 17-38
- Swann
Julian, 2011, "Un monarque qui veut 'régner par les lois' : le
Parlement de
Paris et le roi dans la France de Louis XV", Parlement[s],
Revue d'histoire politique, n° 15, pp. 44-58
- Tholozan Olivier, 1999, Henri de Boulainvilliers : L’anti-absolutisme aristocratique légitimé par l’histoire, PU Aix-Marseille
- Touzery Mireille, 1994, L’invention de l’impôt sur le revenu : La taille tarifée 1715-1789, Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique
- Van
Kley Dale, 1990, "Du parti janséniste au parti patriote : l’ultime
sécularisation
d'une tradition religieuse a l’époque du chancelier Maupeou 1770-1775",
Chroniques de Port-Royal, (39), 115-30
- Van
Kley Dale, 1996, trad. 2002, Les origines
religieuses de la révolution française,
- Venturino
Diego, 1999, "Boulainvilliers versus Louis XIV ?", In: Cahiers
Saint Simon, n°27, pp. 49-59
- Vidoni Nicolas, 2009, "Les « officiers de police » à
Paris (milieu
XVIIe-XVIIIe siècle)", Rives
méditerranéennes
- Wagner Michael, 2001, "Lutte contre la
Révolution, impérialisme et balance des pouvoirs : les élites
britanniques
et la guerre contre la France révolutionnaire", In : Martin
Jean-Clément
(dir.), La Contre-Révolution en Europe :
XVIIIe-XIXe siècles, PU Rennes, pp 175-182
- Warlomont
René, 1969, "Une tentative d'union des Parlements en France (1791)", Revue
historique de droit français et étranger, 47,
pp 294-301
- Wolikow Claudine, 2001, "Finances et politique au siècle des Lumières – Le ministère L’Averdy, 1763‑1768", Annales historiques de la Révolution française, 325
- Woodbridge John, 1985, "La conspiration du prince de Conti (1755-57)", In: Dix-huitième Siècle, n°17, Le protestantisme français, pp. 97-109
Notes
[1] Levinger (1990) synthétisait ainsi le débat historiographique : Au cours des cent dernières années les historiens qui ont traité la question des parlements se sont pour la plupart ralliés soit à l'une soit à l'autre de ces deux opinions. Certains ont présenté l'opposition parlementaire comme fondamentalement conservatrice, un utile correctif au despotisme ministériel. Mais plus nombreux furent ceux qui se rangèrent du côté de ceux qui critiquèrent les parlements en 1788 dénonçant ces magistrats comme des aristocrates si obsédés par la défense de leurs privilèges qu'ils bloquèrent toute possibilité de réforme politique dans la France prérévolutionnaire.
Pour sa part, il conclut que l'effet des actes et discours des Parlements a consisté à ouvrir de nouvelles possibilités (p 609-10) : L’opposition parlementaire a préparé la voie à la Révolution française : en laissant supposer que l’autorité suprême résidait dans la Nation plus que dans le Roi, les Parlements ont commencé à rendre concevable l’idée d’un système politique sans monarque... Cependant il serait trompeur de donner à penser que les magistrats des parlements aient proposé une doctrine de la souveraineté nationale. Durant cette période, l'idée de nation souveraine était une assertion théorique... Le résultat le plus important de l'opposition des parlements fut non pas de remplacer une doctrine politique ancienne par une nouvelle, mais plutôt d'ouvrir de nouvelles possibilités dans la politique française...
[2] Lien dont l'évidence (c'est la faute à Voltaire) dissimule l'origine problématique : les révolutionnaires ont fabriqué le mythe des Lumières pour habiller de "raison" leur contingence et se donner des ancêtres. Dès 1795, Sénac écrivait :...c'est quand la Révolution a été entamée, qu'on a cherché dans Mably, dans Rousseau des armes pour soutenir le système vers lequel entraînait l'effervescence de quelques esprits hardis. Mais ce ne sont point les auteurs que j'ai cités, qui ont enflammé les têtes (p 125).
[3] Spang, 2009 : In other words, if we take the message of Atlantic history seriously, then the “French” Revolution may cease to exist (and so, too, might the Haitian). Or, rather, while both would still be meaningful for intellectual and political historians of the nineteenth and twentieth centuries—who could ask : “how did this Atlantic or global phenomenon come to be understood chiefly as an event in French history?”
[4] Campbell, 2005 : Is our focus the end of the old regime or is it the origins of the Revolution ? They are not the same ; we must not slip into the assumption that because the regime collapsed into revolution the collapse was caused by “revolutionaries” doing the pushing, nor that the collapse would necessarily lead to revolution... (p 2) ...revolution as a process : it is a developing process of the disintegration of existing powers and subsequent competition to fill the vacuum, in which the participants themselves gain awareness and develop strategies they might previously have thought impracticable. Thus, what are usually regarded as precipitants or triggers of “revolution” are an integral part of the process and can have a vital transformative effect (p 9-10).
[5] On cite toujours d'Aguesseau (ca 1718) : Un ministre, respectable d'ailleurs, ... voulut rompre jusqu'à ces faibles liens qui pouvaient encore embarrasser plutôt qu'arrêter l'autorité du roi. C'est ce qui fut exécuté par la déclaration du 24 fév. 1673 par laquelle les parlements furent réduits à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances qu'après avoir prouvé leur soumission par l'enregistrement pur et simple des lois qui leur seraient adressées. Il serait inutile de parler ici des célèbres remontrances que le parlement de Paris fit en cette occasion et qui furent regardées alors comme le dernier cri de la liberté mourante. En effet, depuis cette déclaration, les remontrances furent non seulement différées mais par là même abolies. On n'en trouve plus aucun exemple jusqu'à la mort du feu roi et pendant le reste de son règne... l'enregistrement de tous les édits et de toutes les déclarations est devenu tellement de style que les conseillers au parlement ne prenaient pas même la peine d'opiner sur ce sujet (OC, T 10, p 14-15).
Glasson, 1901, à la suite : Pendant quarante-deux ans, l'enregistrement des ordonnances devint une simple formalité matérielle (T1, p 414)... A vrai dire, le Parlement n'attachait plus aucune importance à un droit qu'il ne pouvait plus exercer librement... (p 436).
Antoine, 1993, dénonce vivement cette légende : d'une part, les Parlements provinciaux ont remontré par toutes sortes de moyens suivis d'effets ; d'autre part, les cours supérieures de Paris, si elles s'abstinrent de s'exprimer par remontrances à partir de 1673, le firent largement par le canal de mémoires présentés aux ministres et traités par eux de même manière que des remontrances.
On peut douter d'Antoine mais Brancourt qui n'est pas suspecte suggère (2005, p 352-3) que le rôle du Parlement s'est internalisé via l'activité des conseillers auprès du roi dans le cadre de ce qu'on est tenté de qualifier de "grande osmose louis-quatorzienne" : Le contraste a souvent été souligné entre le « silence » imposé à la grande robe au cours des quarante années précédentes et le « réveil » de la magistrature consécutif à l’installation de la Régence. C’est faire peut-être léger cas de l’influence de la plume et des juristes dans l’évolution de la monarchie sous le Grand Roi ; c’est négliger aussi la transmission discrète des conceptions de la magistrature sous le couvert de la monarchie administrative, à l’intérieur même d’un Conseil du Roi justement dominé par la robe... Certes, la classique confrontation avec le pouvoir par remontrances, assemblées et députations interposées, s’était immobilisée sous le coup de la déclaration de 1673, mais en des méandres plus subtils sans doute, plus prudents sûrement, le cours de l’opinion des officiers s’écoulait discrètement jusqu’au Conseil. On perçoit nettement, en ce sens, le rôle particulier des premiers présidents, d’une part, du procureur général d’autre part. De toutes façons, dès 1703, les potentialités d’insoumission du Parlement, pourtant inutilement rabaissé en «cour supérieure», se révélèrent à l’occasion des affaires politico-religieuses.
Cela n'empêche pas Bart, 1999, de suivre la vieille tradition et d'écrire : Estimant ce règlement [1667, 1673] contraire à leur dignité, les cours, non plus «souveraines» mais «supérieures», ont boudé ce droit de remontrances devenu autant inefficace qu'étriqué.
[6] Je souligne les mots clés dans le récit de Fayard, 1876, Tome II, p 34-8 :
[le Parlement] avait dit au roi : "Votre Parlement de Paris, Sire, né avec l'Etat, tient la place du conseil des princes et des barons qui de toute ancienneté était près de la personne des rois"... Quatre jours après la dissolution des Etats généraux, le 28 mars,... le Parlement, toutes les chambres assemblées, convoqua, sous le bon plaisir du roi, les princes et les pairs pour délibérer sur les mesures à prendre... la reine fit casser par le grand Conseil l'arrêt du 28 mars... L'arrêt du grand Conseil déclarait que les magistrats avaient outre-passé le pouvoir qui leur était attribué par les lois de leur institution et leur faisait défense de s'entremettre à l'avenir des affaires d'Etat, sinon quand il leur serait commandé... Le Parlement... rédigea des remontrances le 9 avril 1615 ... les premières qu'on ait rendues publiques... le chancelier dit "Que la France était une monarchie où le roi seul commandait, tenant son royaume souverainement de Dieu"...
[7]
Cf. données en annexe (pdf).
En prenant pour corpus la recension de Flammermont des quelque 150 points chauds (inégalement chauds) des rapports Parlement- gouvernement, je retiens les périodes pour lesquelles le nombre d'évènements (lits de justice, remontrances, représentations) est supérieur à la moyenne 1715-88 augmentée de 2 fois l'écart-type (s). Notez que ces évènements ne sont pas ponctuels mais constituent des paquets, chaque remontrance étant suivie de réponse, de nouveaux arrêtés ou députations ou convocations, chacune entrainant de nouvelles réactions.
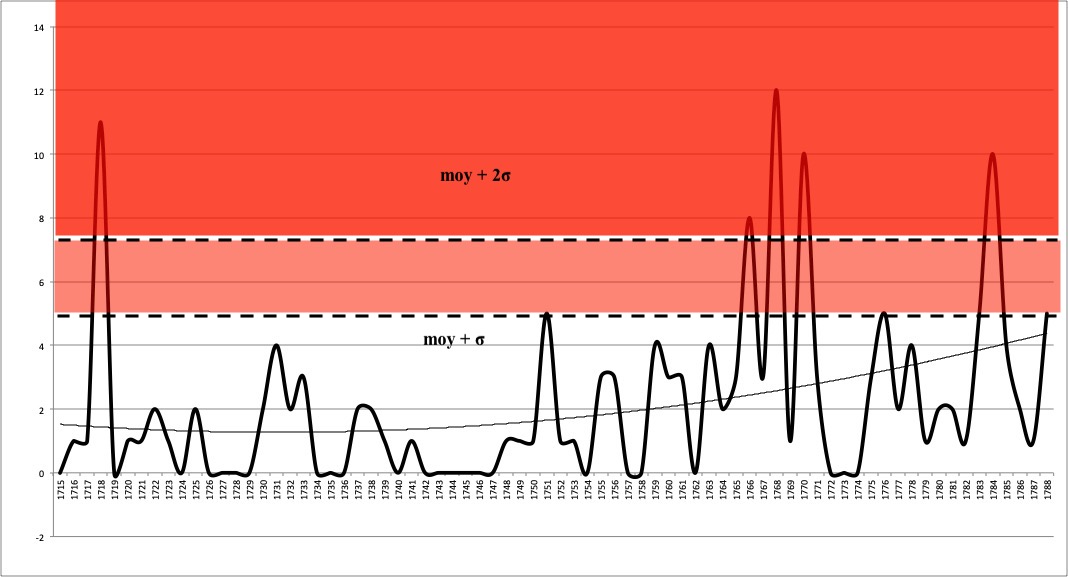 cliquez
l'image pour l'agrandir
cliquez
l'image pour l'agrandir
Certaines catégories d'incidents sont chroniques : 40% relatifs aux finances (édits bursaux, emprunts, manipulations, monnaie), 15% aux conflits de juridiction (notamment avec le Grand Conseil), 9% aux questions de police générale et 8% à la discipline du Parlement ; ceux qui sont les plus spectaculaires sont temporaires : 13% affaires ecclésiastiques (Unigenitus, refus des sacrements et autres abus), 8% à l'unité des parlements, et 5% aux princes et à la cour des pairs.
[8] Tout le monde connaît cette malheureuse histoire qui, avec l'affaire Callas, a valu à Voltaire une réputation de défenseur des droits de l'homme, et, inversement, a alimenté la légende noire des bœufs-tigres du Parlement, de Berquin à l'Encyclopédie... En 1765, à Abbeville, des coups de couteau dans un crucifix sont imputés au jeune de la Barre, victime de rivalités locales. Il est condamné sans preuve aux pires châtiments pour blasphème et sacrilège. En appel, le Parlement de Paris confirme la sentence. Le garçon est exécuté.
[9] Le Paige (1712-1802), le prolifique défenseur des droits du Parlement (Lettres historiques etc.), est convulsionnariste et aspire au martyre !
Maire, 1991, note le lien curieux entre
eschatologie
janséniste (conversion des Juifs, figurisme) et théorie
politique : Il existe une logique janséniste qui de
l'intérieur même de la religion opère le passage du religieux au
politique... Comme l'Eglise des figuristes, la nation
existe d'une manière autonome au-dessus de son principal représentant.
De même
que les figuristes sont les "dépositaires de la vérité" à l'intérieur
de l'Eglise qui ne peut périr, de même le Parlement est le défenseur
des
principes de la perpétuité de la monarchie de "droit divin"... Comme l'Eglise des figuristes qui existe au-dessus
de tous ceux qui prétendent la représenter, l'Etat transcende la propre
personne du roi qui n'est que le chef chargé assurer sa perpétuité...
Dans cet imaginaire politique et religieux
le Parlement... devient en quelque sorte la figure de Port-Royal...
Dépositaire
et interprète des lois, gardien de la conscience de la royauté, c'est à
lui
qu'il revient de rappeler au monarque aveuglé, l'intérêt de l'Etat et
de lui
dire la vérité sans ambages quoi qu'il dusse lui en coûter (figurisme
politique)... [Pour Lepaige] A
l'inverse de la situation anglaise, le Parlement français n'a pas
d'autorité
propre et ne cherche pas en acquérir. Sa position est intrinsèquement
contradictoire. 'Il représente et ne représente pas la Nation'. Il
défend les
intérêts de cette dernière mais jamais jusqu'à prétendre empiéter sur
la
souveraineté royale à laquelle il réaffirme toujours sa parfaite
obéissance.
[10] Les estimations, quoique incertaines, donnent un ordre de grandeur.
A la mort de Louis XIV en 1715, les recettes fiscales se montent à 69 millions de livres pour 146 millions de charges, et la dette publique à 2,3-2,4 milliards, environ 80% du "PIB".
En 1787, la dette publique atteindrait à nouveau 80% du "PIB" (4 milliards de livres pour un "PIB" autour de 5 milliards), et son service absorbe 42 % des recettes de l'État. Celles-ci sont autour de 500 millions pour plus de 630 millions de dépenses.
80% PIB de dette publique ne nous font pas peur aujourd'hui ! mais, malgré le recours à la Hollande et à l'Angleterre, le système financier est inefficient ; les finances du roi sont complexes, confuses, hétéroclites, et opaques.
Un épais brouillard statistique recouvre toutes les données, de la démographie (on croit que la France se dépeuple alors qu'elle croît) au cadastre, en passant par les revenus. Le primitivisme agraire de la fiscalité cherche la richesse dans les biens fonds, l'aperçoit à peine dans l'industrie et le commerce, et l'ignore dans la finance !
[11] Gusdorf, 1976, p 21 : L'appellation Siècle des Lumières est si bien entrée dans les mœurs qu'il serait sans doute impossible à l'historien de s'en passer. Cette désignation, réservée d'ordinaire à une partie seulement de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ne possède pas, même dans la zone ainsi délimitée, un sens précis, car la même époque pourrait apparaître à un autre regard comme le Siècle de l'Illuminisme, triomphant avec Hemsterhuis et le cercle de Munster, Jacobi et le Sturm und Drang, les exorcismes de Bavières, Mesmer et la fièvre magnétique, Cagliostro, etc.
[12] Théodose in Codex, 1, 14, 4 : Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri : adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas (c'est un propos digne de majesté de celui qui règne, que le prince se déclare lui-même soumis à la loi ; car notre autorité elle-même dépend de celle du droit).
[13] Un curieux texte édité en 1679 (Traité des Parlements ou Etats-généraux) divulgue ce mystère de l'Etat dont les acteurs ne sont qu'à demi conscients. L'impression clandestine (A Cologne, Chez Pierre Marteau) fait comprendre que le nom de l'auteur (Pierre Picault) est factice. Il pense que les hommes sont méchants, corrompus et voués aux appétits charnels. Les rois aussi, et leurs ministres et favoris, malveillants. Cela nécessite que "quelque chose" les contrebalance, les effraie et, à l'extrémité, les mette à mort ou les remplace.
Mais ce "quelque
chose" est aussi une menace, car inévitablement composé d'hommes
mauvais qui eux aussi n'aspirent qu'au charnel.
Ce "quelque chose" qui limite
le
roi doit donc lui-même être limité. Et le texte (qui tourne souvent au
galimatias) contient cette extraordinaire formule : La
raison pour laquelle le Roy abuse de son autorité, est qu'il n'y a
personne au-dessus de luy pour le reprendre, ny pour l'obliger à se
corriger.
Si donc il y avoit une puissance établie par les lois qui eust droit de
le
corriger, son luxe et son ambition ne pourroient pas produire de si
pernicieux
effets par la crainte de cette puissance supérieure. Mais il ne faut
pas que
cette puissance soit absoluë en tout, vû que ce seroit retomber dans le
mesme
inconvénient. Il faut donc qu'elle soit
souverainne en un point, et sujette en un autre [mon
soulignement], afin que ces deux
puissances se contrebalançant et dépendant l'une de l'autre, le Roi
n'ose
manquer à son devoir par l'appréhension du Parlement, ny le Parlement
par la
crainte du Roy...
Le Parlement est profitable aux rois car, en rassurant un peuple rendu méfiant par leur mauvaise conduite, il leur conserve l'autorité suprême et leur permet d'agir selon leur caprice.
Il faut ainsi que le Parlement ait peu d'autorité certaine. Mais afin de tenir le Roy et ses favoris en haleine, il est bon qu'ils [les membres du Parlement] ayent beaucoup de puissance indistincte, et que le peuple croye qu'ils peuvent punir et faire mourir le Roy. De là paroist la raison de ce que l'on s'estonne si souvent, que les Parlemens ignorent qu'elle est l'étendue de leur autorité... Les Rois ne doivent jamais remuer la question de l'étendue de la puissance du Parlement, et il seroit bon qu'ils ne l'irritassent point..
[14] Augeard, après le coup Maupeou : grâce au Parlement, Il [le roi] avait à la fois le crédit d'une puissance limitée, & le pouvoir d'une puissance absolue... il était despote de fait, & Monarque de droit... Tel était notre état.
[15] Un siècle après "Picault", en pleine crise Maupeou, lettre de Mme d'Epinay à l’abbé Galiani (11 avril 1771) : il est certain que depuis l’établissement de la monarchie françoise, cette discussion d’autorité, ou plutôt de pouvoir, existe entre le roi et le parlement. Cette indécision même fait partie de la constitution monarchique ; car si on décide la question en faveur du roi, toutes les conséquences qui en résultent le rendent absolument despote. Si on la décide en faveur du Parlement, le roi à peu de chose près, n’a pas plus d’autorité, que le roi d’Angleterre ; ainsi, de manière ou d’autre, en décidant la question, on change la constitution de l’État (Corresp. de Galiani, ed. 1881, T1, p 374).
Donato, 2014, p 202, commente : On peut constater et montrer que toute la vie politique de l’État que l’on appelle 'absolu' est dominée par cette confrontation continuelle, souvent très âpre, qui conditionne l’ensemble des actes juridiques produits par les pouvoirs et les institutions politiques, à partir de la loi du roi. Cette dernière, bien qu’elle soit présentée comme l’acte unilatéral d’un pouvoir suprême et a legibus solutus, est en réalité l’objet d’un processus très articulé et compliqué de négociations qui se joue à plusieurs niveaux. Et plus loin : L’histoire de la monarchie absolue, on l’a bien vu, est donc, de ce point de vue, l’histoire d’un échec : celle de la tentative d’expulser la juridiction hors de la sphère politique ou, du moins, de limiter l’ingérence politique de la magistrature.
[16] Judicium Francorum (in Mezerai, 1753, T2, p 137-8) : Le Roi a-t-il besoin de l'examen, du consentement, & de l'enregistrement du Parlement pour acquérir à ses volontés la force de Loi ou n'en a-t-il pas besoin ? S'il n'en a pas besoin et qu'il jouisse d'une pleine puissance de faire exécuter ses Lois sans le consentement de ses Sujets représentés par le Parlement qui représente lui-même tous les Etats du Royaume, pourquoi SM lui envoye-t-elle ces sortes d'Actes qui manifestent sa volonté?... [c'est l'une des additions aux Véritables maximes de Machon, 1652, que recopie le Judicium Francorum.].
[17] Les jeunes sont d'autant plus nombreux et agités que les Parlements, et tout particulièrement celui de Paris, sont la grande école où se forme sur le tas le haut personnel gouvernemental. La plupart des jeunes conseillers ne font que passer. Peu nombreux sont ceux qui suivent le long cursus, deviennent Présidents, puis entrent à la Grand'Chambre, le cœur du Parlement.
[18] Antoine (1989) dont la défense et illustration de Quinze n'aiment pas le Parlement, suggère qu'il ne fait que ressasser le passé. Son gallicanisme serait obsolète, le pape ne songeant plus à dominer le temporel. Il ne cesserait de s'opposer aux réformes que le sage gouvernement introduit. Le Parlement resterait à jamais nostalgique de la Fronde et du programme de la Chambre St Louis (Antoine, 1990). Ce faisant, il divulgue un noyau rationnel subversif dont les mécontents se saisissent.
[19] Lors donc que le parlement de Paris s'exprimait ainsi au sujet des impôts, il ne faisait que suivre une habitude ancienne et générale. La pièce était la même, mais l'auditeur était changé; et le bruit, au lieu de s'arrêter comme d'ordinaire à la limite des classes que leurs privilèges rendaient peu sensibles à l'impôt, était cette fois si éclatant et si répété, qu'il pénétrait jusqu'au sein de de celles qui en souffraient le plus, et commençait à les remplir de fureur (Chapitres inédits de l'ouvrage destiné à faire suite au livre l'Ancien régime et la Révolution, OC, 1866, T. VIII, p 88).
[20] Nous l'examinerons en détails infra. Notons pour l'instant avec Mercier (Nouveau Paris) : On peut dire qu'en 1788, il y avait cinq à six rois en France. La reine était un roi, le gros Monsieur était un roi, tous se disputaient l'autorité du roi dans la nomination aux charges, aux places, aux emplois, aux bénéfices, aux traitements. Tous ces gens-là, s'embarrassaient fort peu du roi et de la royauté...(Mercier, 1798, chap. 4, Avilissement du Monarque, T1 de l'éd. 1862, p 39).
[21] Il faudrait en savoir davantage sur la diffusion et la réception de tous ces textes. Le bourgeois et, a fortiori, le menu peuple s'intéresse au spectacle, surtout lorsqu'il est dramatique, et aux "friandises" (pamphlets, chansons, graffitis). On peut douter qu'il goûte aux libelles lorsqu'ils ont la forme de longues dissertations historico-juridiques. La formule des lettres successives est plus attrayante.
[22] Les Parlements des provinces réunies au royaume à un moment ou l'autre (Conseils souverains dans les plus récentes annexions), se considèrent comme les représentants de leur "nation" : Parlement de Rouen ou de Normandie ? de Rennes ou de Bretagne ? de Dijon ou de Bourgogne, de Grenoble ou du Dauphiné... ? Lorsque n'existe plus que le souvenir des états provinciaux (Comté, Normandie, Dauphiné...), le Parlement s'en fait héritier.
Au contraire, dans les pays encore d'états (Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Artois...), ceux-ci incarnent aussi l'identité "nationale", ce qui, joint à leur compétence fiscale, les met en concurrence avec leur Parlement.
De même, entre Parlements, existent de nombreux conflits de ressort et de juridiction.
Le cas extrême est celui du minuscule Parlement de Pau. D'une part, il perçoit la Navarre comme unie personnellement à la France et extérieure au royaume (L’avantage que nous avons d’être gouvernés par le même roi ne nous assujettit pas à une cour étrangère pour l’administration et la législation). D'autre part, depuis sa réunion à la chambre des comptes (1691), il revendique le ressort de celle-ci qui est douze fois supérieur au sien ! Préoccupé de sa propre existence, il participe peu au mouvement général, et multiplie les procès avec les parlements de Bordeaux et de Toulouse (Bidouze, 1996).
[23] Chaline, 2006 : Là réside la grande différence entre Paris et la province : la possibilité, même pour des conseillers d’avoir un contact ministériel, d’appartenir à une clientèle (Grand ou ministre), voire l’ambition de devenir soi-même ministre...
[24] Regrettons que le Prince de Conti (1717-1776) n'ait pas encore trouvé son biographe. L'ouvrage de Capon et Yve-Plessis, Vie privée du Prince de Conty, 1907, est décevant.
Conti, grand-prieur de l'Ordre de Malte (1749), "ministre privé" de 1747 à 56 (responsable du secret du roi), aurait eu, comme tant d'autres, des visées sur l'illusoire trône de Pologne.
Est-ce dû à l'alliance autrichienne ? il est exclu (ou s'exclut) de la cour. A la tête de l'opposition aristocratique, à partir de la guerre des billets de confession (1753, Pontoise), il défend le Parlement et ses droits "constitutionnels", ainsi que ceux des Pairs. Au début de la guerre de 7 ans (1756-1763), il aurait animé une conspiration anglo-protestante en 1755-57 (Woodbridge, 1985).
Si Conti n'est pas le Condé de cette non Fronde, il participe à la lutte contre Maupeou et agite les Princes qui boudent le lit de justice inaugurant le Parlement Maupeou, le 13 avril 1771. Les Princes, après avoir protesté, se voient signifier le mécontentement du roi et se retirent benoitement de la Cour, pesant cependant par leur absence (d'où les efforts de Maupeou pour les faire revenir afin de désespérer les exilés et leur faire liquider leur charge).
Les Princes n'ont plus de gouvernements où s'agiter, plus d'armées privées, et surtout pas de cible avouable. Maupeou n'est pas Mazarin, un roi règne, et les bourgeois de Paris encaissent les exactions financières.
Que Conti soit animé par Le Paige
(auquel il procure
l'impunité en le faisant bailli du Temple — cet étonnant anachronisme)
ou
que, au contraire, il l'utilise comme intendant
politique (Carcassonne), son action est liée à celle du Parti.
La mort de Conti en 1776 marque la fin d'une époque. Le Paige se retire de la scène et devient seigneur de Bures (aujourd'hui Bures/Yvette dans l'Essonne) que lui a légué Madame de Revol, veuve d'un Président au Parlement. L'agitateur à l'ancienne laisse la place aux nouveaux trublions et sort de l'Histoire : quand la Révolution le surprit, déjà vieux et presque infirme, il échappa à ses rigueurs. Ses propriétés mêmes et jusqu'à tous ces titres féodaux, si odieux alors, échappèrent à la dévastation. Cet homme de bien mourut le 24 mai 1802 ((Jules Lair, 1876, Histoire de la seigneurie et de la paroisse de Bures, p 43).
[25] L'opposition armée du Parlement à Paris est adossée à la révolte du gras peuple mais ailleurs il ne se passe pas grand chose sauf à Bordeaux, Aix et moindrement Toulouse qui n'agissent pas ensemble. Ce sont des Frondes spécifiques, nées à l’occasion de la Fronde parisienne, qui en épousèrent en partie le rythme, mais s’en distinguèrent par les caractéristiques particulières des affrontements factionnels et politiques locaux (Servanton, 2017, p 547).
Au total, l'implication parlementaire dans la Fronde s'écrit au singulier : c'est à Paris seulement que le Parlement est affronté à la grande question du pouvoir du fait de sa centralité (Servanton, 2015). Plus tard, les tentacules du "centre" se répandant partout, la plupart des Parlements seront impliqués dans un même jeu.
[26] Là où il y en a eu, les oppositions parlementaires de la Fronde étaient militarisées : en robes rouges, le pistolet au ceinturon.
Au XVIIIe la violence reste limitée et suit des formes légales. Parlement et gouvernement semblent être passés du baroque au néo-classique, ce qui alimente l'impression que le XVIIIe est différent. Les magistrats remplacent la guerre et la rébellion par le carnaval et les pleurs : les moyens changent, pas la fin. Si les Parlements des provinces, inexpérimentés et parfois enragés, mettent les libelles en remontrances, celui de Paris reste sur ses rails : le roi et les lois.
[27] Sans entrer dans les détails, empruntons à Flammermont (T2, p 12 sq.) le début du cas : un officier de cavalerie ayant une affaire avec un sieur Billard, conseiller honoraire au Grand Conseil, saisit le Châtelet qui instrumente. Billard prétend ne pouvoir être jugé que par le Grand Conseil qui, par arrêt du 28 juin 1755, annule la procédure du Châtelet et lui ordonne de transmettre les pièces à son propre greffe. Le Parlement, à la requête du demandeur, se saisit du dossier et réclame aussi les pièces que, sur arrêt du Conseil d'Etat à l'appui du Grand Conseil, le greffier du Châtelet a déjà transmises.
Le 2 octobre, le
Parlement arrêta qu'il serait fait au Roi des remontrances sur les
entreprises
des gens du Grand Conseil et fit défense aux greffiers et aux autres
officiers,
tant du Châtelet de Paris que des bailliages et sénéchaussées et autres
juges
du ressort de la Cour, de déférer à l'avenir aux ordres qui leur
seraient
donnés et aux poursuites qui seraient faites contre eux par les gens du
Grand
Conseil. Cet arrêt fut aussitôt publié, imprimé, affiché et crié dans
Paris et
dans tout l'immense ressort du Parlement.
S'ensuivent des arrêts contradictoires également publiés et criés, et de longues remontrances circonstanciées du Parlement le 27 Novembre 1755 affirmant toutes ses prétentions : ... Telle est, Sire, la constitution de votre monarchie. Quel corps né depuis l'Etat, et dans l'Etat, oserait troubler cette admirable et ancienne économie ? Quel tribunal entreprendrait de disputer à votre parlement le rang et les fonctions qu'il remplit dans cet ordre majestueux, qui remonte aux siècles les plus reculés ; de s'insinuer en quelque sorte entre le Prince et sa cour, entre l'Etat et le tribunal de la nation ?...Ce sont, Sire, vous aurez peine à le croire, ce sont les prétentions qu'élèvent aujourd'hui les gens du Grand Conseil, ce nouveau genre de tribunal inconnu dans la Monarchie pendant plus de mille ans...
La Déclaration est la réponse.
[28] Déclaration du roi, concernant l'exécution dans l'étendue du Royaume des Arrêts, Ordonnances & Mandements rendus par le Grand Conseil. Donnée à Fontainebleau le 10 Octobre I755 :...Cette Ordonnance (de Charles VIII) ne laissait pas lieu de douter que la Juridiction de notre Grand Conseil ne s'étendît dans toutes les Provinces de notre Royaume, & que les Officiers qui le composent ne fussent en droit de l'exercer avec la même autorité qu'ont les Cours dans l'étendue de leur ressort. Nonobstant une loi si claire & si précise, nos Cours ne voulaient point reconnaître l'autorité de notre Grand Conseil, & entreprenaient d'empêcher l'exécution de ses Arrêts, en assujettissant ceux qui étaient chargés de les mettre à exécution à la nécessité de leur en demander la permission, ou aux Juges de leurs ressorts.
...Pour faire
cesser cette entreprise contre la Juridiction de notre Grand Conseil,
le Roi
Henri Second ordonna, par un Edit du mois de Septembre 1555, que les
Huissiers,
Sergents ou autres exécuteurs des Arrêts, Décrets, Commissions,
Exécutoires
& autres Provisions qui seraient décernées par notre Grand Conseil,
ne
seraient tenus les présenter à nos dites Cours ni autres Juges, ne leur
demander
aucune permission, ains qu'ils les exécuteraient ainsi qu'il leur
serait
mandé...
Cet Edit a
toujours eu son exécution depuis qu'il a été donné... cependant au
préjudice
d'une possession aussi ancienne & aussi constante, notre Cour de
Parlement
a rendu le deux de ce mois un Arrêt qui défend aux Officiers des
Bailliages
& Sénéchaussées, & autres Juges de son ressort, de déférer à
l'avenir
aux ordres qui leur seront donnés, & aux poursuites qui seraient
faites
contre eux par les Gens de notre Grand Conseil, leur enjoignant
d'informer
notre dite Cour desdits Ordres & poursuites, à l'effet d'y être par
notre
dite Cour statué ce qu'il appartiendra ; & il est ordonné que
cet
Arrêt sera imprimé, lu & publié, & envoyé dans les Bailliages
& Sénéchaussées...
Le fondement de
cet Arrêt est la prétention renouvelée, que les Officiers de notre
Grand
Conseil n'ont aucune Juridiction ni droit de ressort...
Si le pouvoir de
notre Grand Conseil est borné à rendre des Arrêts dans les matières
dont nous
lui avons attribué spécialement la connaissance, il est en droit de les
faire
exécuter, dans tout le Royaume, & sur tous tous nos Sujets avec la
même
autorité qu'ont nos Cours dans les matières ordinaires. Il peut même,
suivant
l''Edit de mille cinq cent cinquante-cinq prononcer des peines contre
ceux qui
auront apporté des empêchements à l'exécution de ses Arrêts...
Voulons que les
Arrêts, Ordonnances & Mandements par eux [Grand Conseil] rendus
dans les
matières qui leur sont attribuées, soient exécutés dans l'étendue de
notre Royaume,
ainsi que les Arrêts de nos Cours le sont dans les limites de leur
ressort,
sans que les Huissiers, sergents &: autres Exécuteurs desdits
Arrêts,
Ordonnances & Mandements, soient tenus, avant que
que de faire lesdites exécutions, de les
présenter à nos Cours ou autres Juges, & leur demander à cet effet
aucune
permission.
[29] En 1768, nouvel épisode de ce conflit multiséculaire :
EDIT portant
règlement pour la police et discipline du grand conseil, janvier
1768 (Isambert, 1830, Tome 22, pp. 471sq) :...
une compagnie qui nous est et sera toujours d'autant plus
recommandable,
qu'elle a été établie conformément aux vœux des états-généraux de notre
royaume, pour former un corps, cour et collège qui fût ambulatoire à
notre
suite, et non limité d'aucun ressort, pour, avec le chancelier de
France, son
seul et véritable chef, et les maîtres des requêtes ordinaires de notre
hôtel,
exercer notre autorité souveraine par tous les pays de notre
obéissance, telle
que nos cours l'exercent dans leurs limites et ressorts...
Et
pour le rapprocher de plus en plus de
notre conseil, dont il est une émanation, il nous a paru convenable d'y
ajouter
la connoissance de tout ce qui peut concerner l'exécution des arrêts de
notre
conseil, ou des incidents qui ne sont pas de nature à y être instruits,
ainsi
que plusieurs affaires que de grandes et importantes considérations
nous
auroient porté ou nous porteroient par la suite, à faire instruire ou
juger
sous nos yeux...
Voulons au surplus, que les arrêts rendus en notredit grand conseil, dans les affaires qui lui sont attribuées, aient dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, la même exécution que ceux de notre conseil, et ceux de nos cours.
Et en retour, longues et acrimonieuses
Remontrances
(19-20 mars 1768) qui dénoncent l'arbitraire qu'entrainera l'exaltation
du
Grand Conseil (Flammermont, II, pp 853sq) :... on
vient de saisir enfin l'occasion la moins faite en elle-même pour
exciter des troubles, et, par une forme artificieusement conçue, on a
su la
rendre l'occasion nécessaire et infaillible d'un trouble universel.
Telles
sont, Sire, les lettres en forme d'édit du mois de janvier dernier,
qui, sous
l'annonce d'un simple règlement pour la police de l'assemblée ci-devant
connue
sous le nom de Grand Conseil, ont pour but réel de former une
commission
extraordinaire et permanente, décorée de prérogatives capables de
l'élever
au-dessus de toutes les Cours.
... Au surplus,
Sire, le système particulier du nouvel édit est subordonné à cette
disposition
générale qui accorde à cette assemblée l'exercice de l'autorité
souveraine par
tous les pays de votre obéissance.
...tout ce qui
peut concerner l'exécution des arrêts du Conseil et les affaires que de
grandes
et importantes considérations auraient portées ou porteraient par la
suite à
faire instruire ou juger sous les yeux de V. M., sera renvoyé à cette
nouvelle
chambre de justice. Quel vague, quel arbitraire dans ces énonciations!
Quel
germe fécond d'abus et d'entreprises de tout genre et de toute espèce,
également
funestes à la tranquillité des sujets de V. M.! Quoi, Sire, un arrêt du
Conseil, un de ces actes qu'on obtient tous les jours sur un simple
exposé, un
de ces actes dont la rédaction est confiée à tant de mains différentes
et qu'on
voit aujourd'hui se multiplier à l'infini, un de ces actes enfin que
l'expérience démontre qu'on surprend si aisément, non seulement à la
religion
de V. M., non seulement à la vigilance de vos ministres, mais encore à
l'erreur
et à l'inattention ou à la coupable complaisance de leurs préposés les
plus
subalternes, ce serait un de ces actes qui déciderait du sort et de la
fortune
d'un citoyen qui, tranquille au fond d'une des provinces les plus
éloignées de
la capitale, avait peut-être ignoré jusqu'ici qu'il eût jamais existé
un Grand
Conseil !
...n'est-il pas évident, Sire, que le Grand Conseil ne présente plus aux yeux justement effrayés de vos sujets qu'une assemblée de juges commis, une commission perpétuelle et permanente ?...
[30] Réponse du Roi (du 8 avril) aux Remontrances du Parlement de Paris :
Le Roi n'avait
pas lieu de s'attendre à des Remontrances de son Parlement de Paris sur
une
affaire qui lui est étrangère et qui ne regarde que le Parlement de
Besançon...
Les Officiers de
son Parlement de Paris doivent sentir qu'ils excèdent les bornes de
leurs
fonctions lorsqu'ils entreprennent de les étendre à l'ordre universel
du
gouvernement dans les différentes parties du Royaume. C'est dans la
personne
seule du Roi qu'existe l'universalité, la plénitude et l'indivisibilité
de
l'autorité ; mais son service est nécessairement divisé entre ses
officiers, suivant la nature de leurs différentes fonctions et
relativement aux
départements et aux bornes que l'autorité Royale leur a marqués et
qu'ils ne
peuvent transgresser sans troubler l'ordre, l'harmonie et la
tranquillité de
l'Etat...
Le Roi ne
dissimulera pas l'attention que quelques termes échappés dans les
Remontrances
se sont attiré de sa part comme pouvant être pris dans un sens que son
Parlement désavouerait sans doute lui-même. On y parle du droit de la
Nation
comme s'il était distingué des lois dont le Roi est la source et le
principe...
Le Parlement de
Besançon y est qualifié Parlement séant à Besançon. Voudrait-on donner à entendre que les différents Parlements
ne sont qu'un seul et même Corps dont les parties sont distribuées dans
les
différentes provinces du Royaume et demeurent unies entr'elles ?
Ce
serait... donner lieu de renouveler des prétentions solennellement
proscrites et
qui n'ont été depuis hasardées que dans des temps de trouble et de
révolte,
dont le Roi est bien assuré que son Parlement déteste l'époque et le
souvenir...
SM est mieux
instruite que les Officiers de son Parlement de Paris ne peuvent et ne
doivent
l'être de la situation du Parlement de Besançon...
Les Officiers du
Parlement de Paris ne s'exposeraient pas à ces erreurs s'ils se
renfermaient
dans ce qui leur appartient. Les lois ne leur donnent aucune voie
juridique et
réprouvent celles qui ne le seraient pas, pour prendre connaissance de
la
vérité de ce qui se passe hors de leur ressort...
Qu'ils soient
attentifs à s'y renfermer...
[31] LETTRES touchant la fraternité des officiers du parlement de Toulouse avec ceux du parlement de Paris, Mehun-sur-Yèvre, 14 novembre 1454.
CHARLES, etc.
Comme pour le bien de justice, et relever nos subjets des vexations et
travaux,
nous ayons ordonné nostre parlement être tenu pour notre cour
souveraine, tant
à Paris comme à Toulouse, par nos amez et féaux les présidens et
conseillers
par nous instituez et ordonnez pour ce faire en chacun desdits lieux de
Paris
et de Toulouse, lesquels y ont de nous telle puissance et authorité les
uns
comme les autres; et parce, doivent iceux présidens et conseillers de
chacun
desdits parlements, estre tenus et réputez unis et recueillis et
honorez les
uns les autres, et comme faisant un même
parlement [mon soulignement], et
néantmoins pour les termes et limites par nous donnez et ordonnez et
constituez
à iceux parlemens, en pourroient avoir entr'eux différence telle, que
quand
aucuns de nos présidens ou conseillers de l'un de nosdits parlemens
voudroit ou
viendroit en l'autre, comme ceux de notre parlement de Toulouse, pour
leurs
affaires particulières, ou autrement, se trouveroient à Paris, que ceux
de
notre parlement de Paris fissent difficulté de les recevoir avec eux,
et de
leur bailler et donner lieu et voix, et notredit parlement de Toulouse,
à ceux
de notre parlement de Paris qui se trouveroient à Toulouse, ce que ne
voulons
aucunement souffrir ne tolérer:
Sçavoir faisons,
que nous voulans nosdits présidens et conseillers de chacun de nosdits
parlemens, et de chacun d'eux estre tenus et réputez tous
uns, et y demourer en notre service en bonne union et
fraternité, sans souffrir, pour causes
des limites d'iceux parlemens, avoir entr'eux aucune différence... (Isambert,
T. 9, p 257-8).
[32] Harangue au Parlement, touchant la réformation des tribunaux, et la convocation des Etats-Généraux [états d'Orléans, ouverts le 13 décembre 1560 et clos le 31 janvier 1561. Ils viennent après le tumulte d'Amboise, sa repression et les premiers édits de pacification. L'Hospital est chancelier depuis 1er mai 1560].
Il s'agit, parmi d'autres, de l'édit des Pareatis qui vise à rendre directement exécutoire l'arrêt d'une Cour dans le ressort d'une autre ; d'où la phrase sur l'unité des Parlements.
L'éditeur (Dufey, 1824-25, OC de Michel L'Hospital chancelier de France, Paris, Boulland) commente (pp 359-60) : Il [le chancelier] résolut de se rendre lui-même auprès de cette cour, et vint y exposer les motifs des divers édits, le 7 septembre 1560. Le premier était relatif aux évocations, et tendait à faire cesser l'abus des ordonnances de Pareatis. On aurait peine à se persuader aujourd'hui qu'un jugement, ou un arrêt, n'était alors exécutoire que dans le ressort de la juridiction du tribunal qui l'avait rendu. Ainsi, un arrêt du parlement de Paris ne pouvait être exécuté dans le ressort du parlement de Dijon ou de tout autre que par une autorisation de ce parlement et cet acte d'autorisation s'appelait ordonnance de Pareatis.
L'Hôpital, après avoir présenté toute une série d'édits, en arrive à celui-ci :
...Il y a l'édict
des Pareatis, qui n'a esté faict pour
la court de céans, laquelle ne pesche in eo genere ;
mais y a trois ou quatre parlements ez
quelz on faict procèz de Pareatis à
Thoulouse, Bretagne, Normandie et Grenoble... Non-seulement lesdicts
procèz se
font contre les parents, mais contre les officiers exécuteurs,
quelquefois
contre ceulx qui exécutent pour le roy.
On y a veu des sergents travaillez, semble qu'ils ne soient à ung maistre; et si ung roy pouvoit, comme autrefois, administrer la justice souveraine par ung seul parlement, il le feroit. Les diverz parlements ne sont que diverses classes du parlement du roy. Est estrange que les uns empeschent l'exécution des aultres...[mon soulignement].
[33] Par exemple, en 1764, le Parlement de Paris, en tant que Cour des pairs, casse des procédures faites par le Parlement de Toulouse contre le duc de Fitz-James, Pair de France. Réclamations des Parlements. En particulier, celui de Rouen expose énergiquement les conséquences du système des classes (10 août 1764 et arrêté des 16-19 août 1765) : égalité de ces diverses classes et droit de chacune d'elles à juger les pairs (Floquet, T. 6, pp 518 sq.).
[34]
Flammermont, 1883, p 136, récapitule les effets de la croissance
intensive et
extensive des tensions qui apparaissent dans la 1ère moitié du siècle
et
s'affirment à partir des années 1750. Ce sont ces nouvelles pratiques
qui
comptent, bien davantage que leurs justifications : Miromesnil
est obligé de convenir que le système des classes et de
l'unité de la magistrature était une nouveauté, que les cessations de
service
et les démissions combinées étaient un abus intolérable, un acte de
forfaiture,
que jamais les cours n'avaient eu le droit de défendre d'exécuter les
édits
enregistrés d'office du très exprès commandement du roi, et que c'était
une
monstruosité de voir des magistrats empêcher l'exercice de l'autorité
dont ils
tenaient leurs propres pouvoirs...
[35] Un autre exemple (Flammermont, 1888, T. 3, p 156), pris dans la Séance royale pour l'enlèvement des Registres du Parlement des arrêts, arrêtés et pièces de procédure concernant l'affaire du Duc d'Aiguillon (3 sept 1770). Le chancelier Maupeou déclare :
S. M. vous
défend, sous peine de désobéissance, toutes délibérations sur ces
objets. Elle
vous défend pareillement de vous occuper de tout ce qui n'intéressera
pas votre
ressort. Elle vous prévient qu'Elle regardera toute correspondance avec
les
autres parlements comme une confédération criminelle contre son
autorité et
contre sa personne.
Elle donne ordre à son Premier Président et à tout autre président et officier de son parlement, qui présiderait en son absence, de rompre toute assemblée où il serait fait aucune proposition tendante à délibérer sur les objets sur lesquels Elle vous a imposé silence, ainsi que sur tout envoi qui vous serait fait par les autres parlements.
[36] L'unité du Royaume ne s'accommode pas de la multiplicité des Parlements. C'est ce que soutiendra, en 1788, Lamoignon en tentant de donner l'exclusivité de l'enregistrement à sa nouvelle cour plénière (Flammermont, T. 3, pp 763-64) : De l'unité de ce conseil suprême doivent nécessairement résulter, Messieurs, des avantages inestimables pour une grande monarchie. Déjà les diverses coutumes qui régissent les différentes provinces, et même souvent les différentes villes de chaque province, ont fait un chaos de la législation française. Il entre dans les vues législatives de S. M. de simplifier ces coutumes diverses et d'en réduire le nombre, avec tous les ménagements que méritent d'anciennes lois, lesquelles sont liées aux mœurs locales.
Mais si, à cette
diversité de lois particulières, il fallait ajouter encore dans
l'exécution des
lois générales de nouvelles différences, causées dans chaque ressort,
tantôt
par le refus, tantôt par les clauses de l'enregistrement, il n'y aurait
plus ni
unité de législation, ni ensemble dans la Monarchie...
avant la création
des cours dans les provinces, dont la première époque est du xive siècle, il n'existait
encore que
le Parlement de Paris, qui enregistrait les lois pour tout le Royaume.
Ce
premier parlement formait alors la Cour plénière dans les occasions
importantes, et cette cour plénière était composée comme le Roi la
compose
aujourd'hui.
Inversement, les Parlements "unis" s'opposent à ce conseil plénier au nom de la défense des nations locales ! A Paris, l'avocat général s'exclame... (ibid., p 766) : ...Une cour unique en France, une cour dont le pouvoir s'étendra d'un bout à l'autre du Royaume ? Comment les membres qui la composeront pourront-ils connaître les intérêts de chaque province?
Slimani, 2004, cite l’avocat et futur député du tiers état du Dauphiné Pison du Galland : la Cour plénière couperait le cordon ombilical entre les provinces et le roi. Pison écrit : Une législation uniforme peut convenir à une cité, à un gouvernement peu étendu. Mais des peuples divers, qui n’ont ni les mêmes besoins, ni le même caractère, ne peuvent être gouvernés par les mêmes lois (Examen impartial des nouveaux édits transcrits militairement sur les registres des cours souveraines de Provence, le 8 mai 1788, s.l., 1788). Slimani commente : La France, royaume toujours « merveilleusement divers », produit un agrégat de peuples, de nations, encore unis sous un roi. Cette situation tranche paradoxalement avec l’évolution politique et philosophique d’une représentation nationale en construction.
[37] Pour Donato, le Parlement viserait à exercer le pouvoir au nom du roi, tout en reportant la responsabilité politique sur le gouvernement.
La révolution réaliserait, contre le Parlement, la transformation de l'Etat de Justice en Etat administratif que tentait la Monarchie depuis longtemps (Donato, 2014).
Cohérent dans le cadre d'une analyse à long terme de l'Etat, ce point de vue substantive "la révolution" et projette ses effets sur ses causes dans une démarche logique et non historique : à la médiation du Parlement, les "absolutistes" opposent la liaison mystique roi-sujets et les "révolutionnaires" l'immédiateté de la souveraineté populaire.
[38] —10 décembre 1770 : ce jour, la Cour adopta l'arrêté suivant :
Considérant que
les dispositions de l'édit publié audit lit de justice attaquent
tellement les
formes essentielles du Gouvernement, que de leur exécution il résulte
que les
droits les plus sacrés qui assurent l'honneur et constituent la
propriété des
sujets peuvent recevoir des atteintes irréparables, sans obstacle et
sans
réclamation ;
Considérant en
outre que, par le préambule dudit édit, tous les membres de la
magistrature
sont présentés comme des criminels envers l'État et la personne du
Roi ;
dont le crime, par le discours de M. le Chancelier, est défini :
le projet
d'enlever des mains dudit Seigneur Roi l'autorité souveraine, pour ne
lui
laisser que le nom de roi. Qu'après de pareilles inculpations, les
membres de
la Cour ne mériteraient pas même l'indulgence dudit Seigneur Roi, dont
la
justice devrait être armée contre eux ; d'où il résulte, contre
les
magistrats qui la composent, une incapacité absolue de faire exécuter,
par les
sujets dudit Seigneur Roi, des lois dont eux-mêmes devraient éprouver
la
rigueur ;
A arrêté ladite
Cour que M. le Premier Président sera chargé de se retirer sur le champ
par
devers le Roi, pour le supplier de rétablir son honneur et la
constitution de
l'Etat que l'édit a attaqué et de lui rendre des fonctions aussi
intéressantes
pour sa personne sacrée que pour l'État, ou de recevoir l'offre
unanime, qu'à
l'exemple des anciens magistrats, les membres actuels de ladite Cour
font audit
Seigneur Roi de leur état et de leur tête, sacrifice volontaire, mais
devenu
indispensable par l'impuissance où est ladite Cour de pouvoir, avec
honneur,
exécuter ledit édit et remplir aucune de ses fonctions (Flammermont,
T. 3, p 170).
— Représentations du 16 janvier 1771 : votre parlement, Sire, croit devoir
remettre sous les yeux de V. M. les principes constants qu'il a
toujours fait
profession de soutenir.
Votre parlement,
Sire, a toujours tenu et ne cessera de tenir pour maxime inviolable,
que V. M.
ne tient sa puissance que de Dieu, que toute autorité dans l'ordre
politique
émane de cette puissance, que les magistrats ne sont que vos officiers
et que
l'autorité qu'ils exercent n'est que l'autorité de V. M. Elle-même,
qu'enfin le
droit de faire des Lois appartient à vous seul, sans dépendance et sans
partage.
Mais, Sire, vous ne penserez point que ce soit porter atteinte à ces principes inébranlables que de vous représenter que les rois, vos augustes prédécesseurs, ont reconnu dans tous les temps qu'il était nécessaire, pour la conservation des droits de la Royauté et pour le bien de l'État, que les lois fussent vérifiées dans leur parlement et que la nécessité de cette vérification tient à la constitution de l'État, qui ne peut être changée, ni altérée (ibid., pp 177-8 )
(id, pp 181-2) : Après une courte délibération sur ces [ultimes] lettres de jussion, le Parlement adopta l'arrêté suivant (18 janvier), qui peut être regardé comme son testament :
La Cour,
considérant qu'elle a épuisé tous les moyens possibles pour parvenir à
se faire
entendre du Roi et qu'il ne lui reste d'espérance, dans un moment aussi
critique, que celle que lui inspire la confiance qu'elle a, et qu'elle
ne
perdra jamais, dans la justice, la bonté et la sagesse dudit Seigneur
Roi ;
que ces qualités, quelque éminentes qu'elles soient dans un souverain,
si cher
à ses peuples, peuvent ne pas le mettre à l'abri des surprises
passagères, mais
ne permettent pas de penser que les impressions fâcheuses, qui sont
l'effet de
ces surprises puissent être durables.
A arrêté qu'elle
attendra, avec la résignation la plus respectueuse et la soumission la
plus
entière, les événements, tels qu’ils puissent être, dont elle se trouve
menacée ; convaincue ladite Cour que tous les membres qui la
composent,
dans quelque situation qu'ils se trouvent réduits, conserveront
toujours le
même attachement inviolable pour la personne dudit Seigneur Roi, pour
son
service, pour le bien de ses sujets et pour la conservation des lois
essentielles de l'État.
Puis, c'est la fameuse nuit du 19-20 et la "prise" du Palais par les mousquetaires.
[39]
Inspirée ou rédigée par le Paige pour le compte de Conti, les PROTESTATIONS DES PRINCES DU
SANG Contre l'Edit de
Décembre 1770, les Lettres Patentes du 23 Janvier, l'Edit de Février
1771,
& contre tout ce qui s'en est enſuivi ou pourroit s'ensuivre ;
Signifiées & déposées au Greffe du Parlement, & lues en
présence de MM.
du Conseil siégeant au Palais le 12 Avril 1771, datées de Paris 4
Avril de
l'an 1771, sont signées :
- Louis-Philippes d'Orléans.
- L. P. J. d'Orléans (Louis Philippe Joseph, son fils).
- L. J. de Bourbon (Louis V Joseph de Bourbon-Condé)
- L. H. J. de Bourbon (Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince de Condé)
- Louis de Bourbon (Louis de Bourbon-Condé, abbé de Saint-Germain-des-Prés (1737), comte de Clermont)
- L. F. de Bourbon (Louis-François de Bourbon, prince de Conti).
Le texte commence ainsi :
Nous, soussignés,
considérant que la Monarchie Françoise ne s'est soutenue avec l'éclat,
la
splendeur & la force dont elle jouit depuis tant de siècles, que
par
l'observation des Loix primitives qui lui sont inhérentes, qui en
forment le
droit & en font l'essence...
Que le droit des François, un des plus utiles au Monarque & des plus prétieux à ses Sujets, est d'avoir des Corps de Citoyens perpétuels & inamovibles, avoués dans tous les tems par les Rois & par la Nation, qui, sous quelque forme & dénomination qu'ils aient existé concentroient en eux le droit général de chacun des Sujets d'invoquer les Loix, de réclamer leurs droits & de recourir au Prince...
Considérant que pour la sureté de notre honneur, de notre vie, & de nos biens, nous ne pouvons reconnoître une Cour des Pairs dont nous, Princes du Sang, sommes Membres nés, & dont nous sommes uniquement justiciables par les prérogatives de notre naissance, que dans un Tribunal fixe composé de Membres inamovibles, qui ne puisse être destitués que dans les cas prévus, & dans les formes prescrites par les Loix du Royaume....
NOUS DÉCLARONS par ces Présentes, qu'en renouvellant en tant que de besoin, la Protestation que nous avons faite d'avance entre les mains de Sa Majesté dans notre Lettre du 19 Mars dernier : Nous, comme Gentilhommes, protestons pour la conservation des droits de la Noblesse ; comme Pairs de France nés, pour celle des droits des Pairs & des Pairies ; & comme Princes du Sang, pour les droits essentiels de toute la Nation, les nôtres, ceux de notre postérité, & pour le maintien des Loix qui les assurent...
[40] Les factums gouvernementaux sont recueillis et publiés dans Le Code des François, ou Recueil de toutes les pièces intéressantes publiées en France, relativement aux troubles des Parlements, 1771, 2 tomes, à Bruxelles, ch. Flon.
Les écrits opposés attendront la disgrâce de Maupeou pour être rassemblés et édités (sans nom d'imprimeur) : Maupeouana ou Recueil complet des écrits patriotiques publ. pendant le règne du chancelier Maupeou, pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il voulait établir et pour maintenir dans toute sa splendeur la Monarchie Française, à Paris avec l'approbation unanime des bons et fidèles sujets de Sa Majesté Louis XVI.
[41] Cette mécanique a été joliment décrite par Dubois (1717) pour montrer la commodité des Parlements par rapport aux Etats généraux dont la convocation avait alors des partisans dans les Conseils, et tentait même le Régent, amoureux de l'extraordinaire (Seilhac, 1862, qui donne en note XXVII de son second tome, le remarquable mémoire de Dubois à Orléans qui, souvent cité, mérite d'être lu) :
MÉMOIRE DE L'ABBÉ DUBOIS SUR LES ÉTATS
GÉNÉRAUX... Un Roi n'est rien sans ses sujets; et
quoiqu'un monarque en soit le chef, l'idée qu'il tient d'eux tout ce
qu'il est
et tout ce qu'il possède, l'appareil des députés du peuple, la
permission de
parler devant le Roi, de lui présenter des cahiers de doléances, ont je
ne sais
quoi de triste qu'un Roi doit toujours éloigner de sa personne...
... Le Roi
établit une loi ou crée des impôts. La loi déjà discutée dans son
conseil émane
de la plénitude de son autorité et il l'envoie à ses parlements pour la
faire
exécuter. Qui pourrait s'opposer alors à l'exécution de la volonté du
Roi ?
Les Parlements ! Ils ne peuvent faire que des remontrances ;
encore
est-ce une grâce qu'ils doivent à Votre Altesse Royale ; le feu
Roi,
extrêmement jaloux de son pouvoir, leur ayant sévèrement défendu d'en
faire.
Encore, si, toutes leurs remontrances finies, il ne plaît pas au Roi de
retirer
ou de modifier la loi, ils la doivent enregistrer; et si, au contraire,
le
Parlement la refuse encore, le monarque lui envoie des ordres
ultérieurs pour
le forcer d'enregistrer : alors paraissent de nouvelles
remontrances qui
sentent la faction. Les Parlements ne manquent pas de faire entendre
qu'ils
représentent les peuples, qu'ils sont les soutiens de l'Etat, les
gardiens des
loix, les défenseurs de la Patrie avec bien d'autres raisons de cette
espèce : à quoi l'autorité répond par un ordre d'enregistrer,
ajoutant que
les officiers du Parlement ne sont que les officiers du Roi, et non les
représentants de la France. Petit à petit le feu s'allume au Parlement,
les
factions s'y forment et s'agitent ; alors, il est d'usage de tenir
un lit
de justice pour conduire au point qu'il faut messieurs du Parlement.
S'ils se
soumettent, on est obéi, et c'est tout ce que peut vouloir le plus
grand roi du
monde ; s'ils résistent encore, au retour dans leurs chambres, on
exile
les plus mutins, les chefs des factions, ou bien on exile à Pontoise
tout le
corps du Parlement. Alors on suscite contre lui la noblesse ou le
clergé, ses
ennemis naturels, on fait chanter des chansons ; on fait courir
des poésies
légères et fugitives, opérations dont nous connaissons bien aujourd'hui
la
marche et les résultats, n'occasionnant que des émotions légères qui
n'ont
aucun grave inconvénient ; et le Parlement n'est pas moins exilé
pour
avoir été désobéissant. On prend les jeunes conseillers qui dominent
dans ce
corps, par famine ; et l'ordre des choses leur commande
impérieusement de
revenir à leurs foyers, à leurs femmes entretenues, à leurs véritables
épouses.
On enregistre, ou on obéit et l'on revient dans la capitale. Voilà,
Monseigneur, toute la mécanique de ces circonstances qu'il serait bien
dangereux de changer.
A présent Votre Altesse Royale connaît-elle des moyens plus efficaces pour s'opposer aux entreprises d'une assemblée qui seroit véritablement nationale et qui résisteroit à ses volontés ? Le monarque pourroit-il dire à la nation comme au Parlement : Vous n'êtes pas la nation ? Pourroit-il dire aux représentants de ses sujets qu'ils ne les représentent pas ? Un Roi de France pourroit-il exiler la nation pour la faire obéir, comme il exile les Parlements ? Pourroit-il faire la guerre à la France en cas de refus de nouveaux impôts ? Le Roi est assuré de ses troupes contre les Parlements, le seroit-il contre la France assemblée ? On frapperoit donc le soldat, l'officier, le général, sans frapper contre leurs compatriotes, leurs amis, leurs parents ou leurs frères ? N'oublions jamais que le dernier malheur des rois est de ne pas jouir de l'obéissance aveugle du soldat ; que compromettre ce genre d'autorité, qui est la seule ressource des rois, c'est s'exposer aux plus grands dangers, c'est véritablement la partie douteuse du monarque qu'il ne faut pas montrer au peuple, même dans les plus grands maux de l'Etat...
[42] Dans ses Mémoires secrets, publiés longtemps après sa mort, comme il l'exigeait, Augeard dit que, aussi ignorant que tout le monde du droit public du royaume avant la crise parlementaire, celle-ci l'a poussé à s'interroger. Il tient sa compréhension du premier président Malesherbes, auteur des fameuses remontrances de la Cour des aides, qui l'a poussé à lire et à réfléchir.
En 1771 (Correspondance secrète et familière du chancelier Maupeou avec son cœur Sorhouet), il écrit :
"Lettre VII, Recherches sur le droit
national
d’accorder l'impôt usurpé par les Parlements sur la Nation" :
[C'est Maupeou qui est supposé s'expliquer] :...le
gouvernement a beaucoup aidé les cours chargées de la vérification
des impôts dans ce mystère d'iniquité. Les ministres savoient très bien
ce
qu’ils faisoient. On a représenté surtout au parlement de Paris que
François I,
en établissant d’une manière stable la vénalité des offices, les avoit
rendus
inamovibles ; qu’étant un corps toujours subsistant dans l’état,
objet du
respect des peuples, ils pouvoient en quelque sorte se regarder comme
ses
interprètes, comme ses lieutenants ; que d’ailleurs les états de
Blois
avoient décidé formellement que les cours de parlement pouvoient se
considérer
comme des états généraux en raccourci... On leur a fait sentir de plus
les
inconvénients de l’assemblée des états... On les a flattés en
paraissant leur
témoigner plus de considération, en écoutant quelques remontrances,
&
faisant droit sur leurs demandes. On les a amadoués en combinant avec
eux les
édits dont on désirait la vérification...
De tout ceci, il
est facile de conclure que pendant plus de neuf cents ans les rois ne
pouvoient
lever aucun impôt sur leurs peuples ; qu’ils ont cru avoir
beaucoup gagné
de pouvoir en obtenir par le consentement des états généraux ; que
cette
forme a eu lieu pendant trois cents ans : que les ministres ont
trouvé, à
cause des doléances de ces assemblées, qu’elles étoient trop gênantes
pour eux.
Ils se sont adressés aux parlements, sous prétexte qu'ils étoient comme
des
états au petit pied, & en raccourci, qui pouvoient provisoirement
restreindre, modifier, & même rejeter les édits. Aujourd'hui les
ministres
trouvent qu’il est encore trop gênant de s'adresser aux parlements. Que
resteroit-il donc à la nation? Des fers, si mon amour pour la patrie ne
lui
rendoit ses états généraux...
"Lettre XI— De M. de Sorhouet à M. ***, ancien conseiller au grand conseil [S. est supposé justifier Maupeou] : Le biais que les cours devoient prendre, n’étoit pas celui d’attiser le feu de la sédition. La marche qu'elles avoient à suivre étoit plus simple & moins dangereuse. Elles devoient renoncer généreusement à une autorité imaginaire pour conserver la véritable, la seule qui leur pût appartenir ; renvoyer l’édit au roi, & au lieu de remontrances inutiles, lui écrire respectueusement pour le remercier de l’honneur que sa majesté vouloit bien leur faire, en les chargeant d’un point important de son administration ; honneur qu’elles ne pouvoient accepter ; qu’elles refuseroient constamment, parce qu'il n’étoit point de leur compétence... ils osoient lui faire observer que son édit attaquoit la loi la plus sacrée de son royaume, la propriété des biens de ses sujets ; que le consentement libre de la nation étoit le seul moyen qui pût concilier le besoin de ses finances avec la justice prescrite par le droit de la nature, autant que par celui de la nation ; que pour l’obtenir il falloir assembler les Etats-généraux, à qui seuls il appartenoit de décider...
[43] Avant le coup Maupeou, grâce au Parlement qui donnait aux prêteurs la sécurité, Il [le roi] avoit à la fois le crédit d'une puissance limitée, & le pouvoir d'une puissance absolue... il étoit despote de fait, & Monarque de droit... Tel étoit notre état ; tel étoit celui du Roi...[A présent, dirais-je au ministre] Quelle sera donc votre ressource après avoir ainsi détruit par vos opérations tout crédit, & pour le présent, & pour l'avenir ?... un Gouvernement perd son crédit dans la même proportion qu'il acquiert plus de facilité de manquer à ses engagements... il n'est qu'une certaine mesure de pouvoir compatible avec le crédit ; tout pouvoir porté au delà, le détruit... La grande science est donc d'avoir dans le fait, par des influences certaines, par des opérations habilement ménagées, & en ne laissant jamais paroître la main toute nue de l'autorité, une autorité illimitée, & de ne montrer jamais dans le droit, qu'une autorité tempérée par des Loix.....
[44] Constant, 2004, "La troisième Fronde : les gentilshommes et les libertés nobiliaires" : ... le but officiel de la convocation était de travailler à la libération des princes, Condé, Conti et Longueville, que la Reine avait fait arrêter le 18 janvier 1650. Or, le 13 février 1651, Mazarin les libéra, pensant profiter de la division qui ne manquerait pas de se produire entre les divers chefs de clans nobiliaires... Pour les grands, l'assemblée devait s'achever. Tel n'était pas l'avis des gentilshommes présents. Ils avaient préparé un programme de réformes et s'apprêtaient à poursuivre des objectifs qui lui étaient propres... Le 15 mars ils demandaient, en compagnie du clergé, la réunion des états généraux. Mazarin, dans une lettre à Anne d'Autriche, conseilla d'en parler mais de ne jamais les réunir. Le Seize mars, le maréchal de Lhospital, au nom de la Reine, vint demander à l'assemblée de se dissoudre, ajoutant que les états généraux étaient convoqués à Tours pour le 1er octobre. Les nobles firent traîner les choses. Chacun savait que le Roi serait majeur le 7 septembre... la noblesse exigea que les états généraux eussent lieu avant la majorité du roi. Ils réclamaient le droit de se réunir en cas d'inexécution de la promesse qui leur était faite... Le 23 mars, le Parlement, très hostile à la réunion des états, obligea le duc d'Orléans à faire son possible pour dissoudre l'assemblée. Le 25 mars, il vint, en compagnie de Condé, proposer aux nobles une réunion des états généraux le 8 septembre, le lendemain de la majorité du roi. Ils combattirent ensemble la proposition de création d'une commission permanente de la noblesse qui veillerait à l'exécution de la promesse. Le marquis de Sourdis, dont le prestige était énorme, conseilla la dissolution qui intervint dans les heures qui suivirent. On sait que la promesse ne fut pas tenue et que les états généraux ne se réunirent jamais, au grand scandale de la noblesse qui ruminait son amertume dans les manoirs ou sur les champs de bataille.
[45] Le thème connaît alors des développements, mais il remonte à loin.
Le Chancelier d'Aguesseau, dans ses Fragments sur l'histoire des remontrances,
1718, (In: OC 1819, T10), texte dont la composition et l'écriture
soignées
autorisent à penser que l'inachèvement est factice, admet la nécessité
de
supporter l'importunité des remontrances du Parlement car, outre son
rôle de tiers équitable entre petits et grands,
et de frein à la puissance empruntée des
ministres et favoris, le seul effet de la
liberté de faire des remontrances est de rendre l'autorité plus
efficace, en la
rendant plus conforme à la règle, et d'en augmenter la raison sans en
diminuer
le pouvoir car il faut que les rois
fassent non-seulement les choses justes, mais qu'ils les fassent d'une
manière
qui en renferme la preuve aux yeux du public...
D'Aguesseau expose les faits relatifs à l'usage des remontrances en partant des assemblées de la 2ème race : leur contribution législative a priori, devenue impossible, la liberté de faire des remontrances fut bientôt substituée à l'ancien usage de mettre les lois en délibération avec ceux qui devoient veiller à leur exécution (p 6).
Figeac, 2010 commente: ce
discours n’a rien de très original, car il avait été tenu bien avant
d’Aguesseau par Étienne Pasquier, Jean du Tillet ou Claude Joly qui
s’appuyait
lui aussi très largement sur Machiavel. Il ne fait que traduire la
volonté de
la haute robe de se considérer comme le « Sénat » du royaume,
gardien
de ses lois et de ses traditions contre la volonté du roi-individu
lorsque
celle-ci devient capricieuse ou mal conseillée...
[46] Les états sont épisodiques et doivent être convoqués, le Parlement est permanent et siège tout le temps. Les députés sont quelconques et temporaires, les conseillers instruits et inamovibles. Les états ne font qu'émettre des vœux dont l'éventuelle traduction en loi passe par le Parlement. Enfin, le Parlement ne délègue pas aux états, il les préside, en tant qu'appartenant au corpus regis.
[47] Pour le détail de ces impôts, voir le Procès-verbal du Lit de Justice du 6 Août 1787. Si la subvention territoriale, taxant les revenus de tous les biens fonds, semble avoir le mérite d'être universelle alors que le vingtième ne l'était pas, ce dernier avait l'avantage de s'étendre (plus ou moins efficacement) aux revenus non agricoles. En outre, la subvention est un impôt de répartition, avec solidarité de fait entre contribuables, dont la distribution par les assemblées municipales (à instituer) sera un puzzle ou un champ de bataille et d'influences.
Quant au timbre, c'est
un cauchemar bureaucratique (cf. Déclaration concernant le timbre, PV du Lit du 6 aout). Le montant attendu
(20 millions contre 80 fixés à la subvention territoriale)
est
dérisoire par rapport à la lourdeur du dispositif (rien que le tarif
prend dix
pages !, ibid.), son
caractère
vexatoire, au poids qu'il ajoute aux transactions, et au coût de
perception
(bureaux et contentieux).
[48] Flammermont : après Supplications (8 juil.) et Itératives Supplications (15 juil.), le 16 juillet, entendu le récit du Premier Président, la Cour arrêta de faire au Roi des remontrances à l'effet de Le supplier de retirer sa déclaration sur le Timbre. Des commissaires furent nommés pour les rédiger. Le 26 juillet, ils avaient fini leur travail ; mais la Cour eut à se prononcer entre deux projets de remontrances, l'un rédigé par Ferrand, l'autre, beaucoup plus véhément, par Duval d'Eprémesnil... le premier projet fut adopté. Il fut présenté au Roi le jeudi 26 juillet.
Ferrand a manœuvré contre Duval pour exprimer le sentiment de la Cour en le mitigeant. Il écrit sans plaisir : Louis le Grand, se croyant obligé de percevoir le Dixième, douta qu'il en eût le droit, et si le Parlement crut alors avoir celui de l'enregistrer, ce fut parce que l'impôt ne devait avoir qu'une courte durée, ce fut surtout parce que la position de l'Etat semblait s'opposer à tous délais ; sans cela, il eût dit que la Nation seule, réunie dans ses États généraux, pouvait donner à un impôt perpétuel un consentement nécessaire, que le Parlement n'avait pas le pouvoir de suppléer ce consentement, encore moins celui de l'attester quand rien ne le constatait; et que, chargé par le Souverain d'annoncer sa volonté aux peuples, il n'avait jamais été chargé par ces derniers de les remplacer [mon soulignement]. C'est ce que votre parlement prend aujourd'hui la respectueuse liberté de dire à V. M. Pénétré de cette vérité, alarmé d'un déficit qui semble monter à une somme énorme, frappé des désordres qui l'ont produit et qui pourraient le perpétuer, il a formé le vœu de voir la Nation assemblée préalablement à tout impôt nouveau. Elle seule, instruite de la véritable position des Finances, peut extirper de grands abus et offrir de grandes ressources (T. 3, pp 673-4).
Flammermont poursuit :
Le lendemain, le Parlement reçut l'édit portant suppression des deux Vingtièmes et établissement d'une Subvention territoriale dans tout le Royaume. Ce même jour, après avoir entendu le récit du Premier Président sur la réponse du Roi, la Cour arrêta le texte de supplications, qui furent présentées à Versailles, le 2 août, sous cette forme :...considérant en outre que la Nation, représentée par les États généraux, est seule en droit d'octroyer au Roi les secours nécessaires, que la Nation peut sans partialité délibérer sur les moyens de vous procurer, Sire, les secours dont le besoin sera évidemment démontré...
Le 5 août, la Cour reçut convocation pour un lit de justice que le Roi tiendrait à Versailles le lendemain. Elle arrêta immédiatement les représentations que le Premier Président adresserait au Roi dans cette séance, dont suit un extrait du procès-verbal :
...votre parlement ne peut, ne doit, ni n'entend donner son avis, ni prendre aucune part à ce qui pourrait être fait en la présente séance...
Le principe constitutionnel de la Monarchie française est que les impositions soient consenties par ceux qui doivent les supporter ; il n'est pas, Sire, dans le cœur d'un roi bienfaisant d'altérer ce principe qui tient aux lois primitives de votre état, à celles qui assurent l'autorité et qui garantissent l'obéissance.
Dans les Remontrances sur la séance royale du 19 novembre 1787 des 11-13 avril 1788, le Parlement se glorifie d'avoir reconnu sa propre incompétence : ... La Constitution française paraissait oubliée. On traitait de chimère l'assemblée des États généraux... Mais il restait le Parlement. On le croyait frappé d'une léthargie en apparence universelle ; on se trompait. Averti tout à coup de l'état des finances, forcé de s'expliquer sur deux édits désastreux, il s'inquiète, il cesse de se faire illusion, il juge de l'avenir par le passé, il ne voit pour la Nation qu'une ressource : la Nation elle-même. Bientôt, après de mûres et sages réflexions, il se décide, il donne à l'univers l'exemple inouï d'un corps antique, d'un corps accrédité, tenant aux racines de l'Etat, qui remet de lui-même à ses concitoyens un grand pouvoir dont il usait pour eux depuis un siècle, mais sans leur consentement exprès [mon soulignement]. Un prompt succès répond à son courage. Le 6 juillet, il exprime le vœu des États généraux; le 19 septembre, il déclare formellement sa propre incompétence; le 19 novembre, V. M. annonce Elle-même les Etats généraux; le surlendemain, elle les promet, elle en fixe le terme, sa parole est sacrée. (ibid., pp 737-8).
Le Parlement est divisé. Ferrand et
quelques autres ont
combattu la demande de réunion des états
généraux et s'opposent à l'arrêté du 5 décembre 1788 qui, par 45
voix
contre 39, démonarchisait la France en
épousant toutes les revendications
libérales (Ferrand, Mémoires)
dans l'espoir de faire oublier les formes
de 1614 que, par étourderie ou inconscience, le Parlement avait
préconisées
pour les futurs états.
Quand on voit l'ascendant que prend sur le Parlement un d'Eprémesnil, illuminé mesmériste et persécuteur de Lally-Tollendal, qui, malgré sa célébrité tapageuse et ses grandes relations, n'est qu'un petit conseiller aux enquêtes ; quand on note l'absentéisme et le désaccord qui caractérisent alors la Cour, l'impuissance des ministres et leurs grands coups d'épée dans l'eau ; on a le sentiment que le Parlement est à la dérive.
Sur l'invraisemblable du Val d'Eprémesnil (1745-1794), voir Carré, 1897, et Servier, 1823, Discours et opinions de d'Eprémesnil, précédés d'une notice sur du Val dont l'auteur donne une parfaite caractérisation : Il avait une âme ardente et le désir de faire du bruit ! Plus tard, devenu la bête noire du côté gauche de l'Assemblée constituante, du Val cultive les provocations royalistes, suscitant autant de bruit mais moins de popularité !
Monarchiste conservateur, c'est essentiellement un trublion. On ne peut pas dire, comme Bidouze, 2017, qu'il a provoqué par erreur une révolution qu'il expiera (il a assumé jusqu’à la fin de sa vie un repentir sincère, quasi christique).
[49]
Arrêté du 7 aout : ... Qu'il est
affligeant pour le Parlement de voir que sa présence purement passive
et
involontaire serve de prétexte pour écraser les peuples ; que
l'ordre
donné au Parlement de se rendre auprès du Roi prouve que la nécessité
de l'enregistrement
est avouée ; que la mention de l'enregistrement qu'on montre aux
peuples
et qu'on insère dans les papiers publics est faite pour en imposer et
pour
dissimuler les réclamations constantes que le Parlement n'a cessé
d'opposer à
tout enregistrement de ce genre par ses arrêtés, arrêts et
supplications
publiques et privées...
[Considérant...]
Que rien ne serait plus opposé aux principes qui seraient adoptés par
les États
généraux que la déclaration du Timbre... Qu'il n'est pas moins
contraire aux
constitutions primitives de la Nation et aux principes qui seraient
adoptés par
les États généraux, de voir le Clergé et la Noblesse soumis à une
contribution
solidaire pour la Subvention territoriale...
A déclaré la
distribution clandestine desdits édit et déclaration nulle et illégale,
comme
étant ladite distribution faite par suite d'une transcription sur les
registres
de la Cour, que ladite Cour a déclaré nulle et illégale par son arrêté
du 7 de
ce mois.
[50] A la révocation des deux nouveaux impôts qui n'a eu pour objet que de dorer, comme l'on dit, la pilule, on a accollé par le même édit la prorogation très-prématurée du vingtième & même son extension actuelle. Et le Parlement, leurré par l'apparence de succès qu'il a cru obtenir de la première partie de l'édit, n'a pas balancé à accueillir sans difficulté la seconde, & à lui donner la sanction par un enregistrement pur & simp1e... & cette complaisance lui a valu son rappel...
En effet, la
subvention territoriale et l'impôt du timbre...ne faisaient pas l'objet
principal du procès. Quel était-il donc?
De la part du
Ministère, c'était de se ménager... la facilité de multiplier,
d'étendre à son
gré les impôts et de disposer ainsi arbitrairement de la propriété des
citoyens.
De la part du
Parlement, c'était au contraire, après en avoir convenu lui-même, de
forcer le
Ministère à convenir que, non seulement aucun impôt nouveau, mais même
aucune
addition quelconque aux impôts déjà subsistants ne pouvait avoir lieu
sans le
consentement de la nation régulièrement assemblée en Etats-Généraux.
...Ou le système
du Parlement ne présentait qu'une dispute de mots, ou il ne devait pas
se
prêter davantage à cette prorogation qu'à l'établissement des deux
autres impôts.
La raison était la même... Ne devait-il pas également en appeler à cet
égard à
la nation assemblée ?...
Lisons cet arrêté et voyons ce qui en résulte. Il contient il est vrai la déclaration de la part du Parlement qu'il... regarde comme hors de son pouvoir d'enregistrer aucun impôt dont la nation préalablement assemblée en Etats Généraux n'aurait pas reconnu la nécessité et fixé invariablement la quotité, la durée et l'emploi. Mais quand fait-il cette déclaration? C'est l'instant d'après qu'il s'est cru permis, ou qu'il n'a pas cru hors de son pouvoir d'enregistrer la prorogation et l'extension du vingtième.
[51]
Le chancelier Lamoignon définit ainsi la composition de la Cour
plénière
(lit de Justice du 8 mai 1788) : ... S. M. n'admet,
de son parlement de Paris,
que la seule Grand'Chambre, à la Cour qu'elle rétablit pour procéder à
la
vérification et 1a publication de ses lois générales. Mais, jaloux de
rendre
cette cour aussi digne qu'il est possible de sa confiance et de celle
de la
Nation, le Roi réunit cette portion éminente de la magistrature aux
Princes du
sang, aux pairs de son royaume, aux grands officiers de la Couronne, à
des
prélats, des maréchaux de France et
autres personnages qualifiés : des gouverneurs des provinces, des
chevaliers de ses ordres, un magistrat de chacun des parlements, des
membres
choisis dans son conseil, deux magistrats la Chambre des comptes et
deux de la
Cour des aides de Paris.
[52] Carré, 1907 : ...La Constitution, dit-il enfin, n'aurait rien de solide, s'il subsistait des corps rivaux de l'Assemblée nationale, des corps accoutumés à se proclamer les 'représentants de la Nation', 'redoutables par l'influence du pouvoir judiciaire', sachant 'tourner tous les événements à l'accroissement de leur puissance'. Ils épieraient les démarches de l'Assemblée, aggraveraient ses fautes, profiteraient de ses négligences, attendraient 'le moment favorable pour s'élever sur ses débris'. Ayant 'fixé les droits du trône', 'fondé la liberté sur la destruction des aristocraties de toute espèce', l'Assemblée nationale se devait à elle-même de détruire les Parlements...
Le décret des 16-24 août 1790, aménagé par celui du 6 septembre suivant, décidera qu'à Paris et en province les chambres de vacations cesseraient respectivement leurs fonctions les 15 septembre et 30 aout 1790. Nous les avons enterrés vivants, commentera un représentant.
[53] Carré (ibid.) : Le Président de la Chambre des Vacations, Le Peletier de Rosambo, avait d'abord avisé le Garde des sceaux que ses confrères avaient l'intention de ne pas enregistrer. Très inquiet, le ministre avait affirmé qu'un refus d'enregistrement serait le signal d'une journée comme celle du 6 octobre [émeute qui força le Roi à revenir à Paris] ; et, les magistrats s'obstinant, de Cicé n'avait triomphé de leur résistance qu'en mettant en avant la sécurité même du Roi. En même temps qu'elle enregistra, la Chambre des Vacations de Paris signa une protestation secrète, qu'elle devait renouveler lors de sa dispersion : La Chambre des Vacations, disait-elle, profondément consternée de l'urgence et de l'empire des circonstances, ainsi que de l'état auquel elles ont réduit la compagnie, Proteste contre la transcription de la déclaration de ce jourd'hui, et contre tous actes émanés d'icelle Chambre qui seraient contraires au bien public, à la justice, et aux lois inviolables du Royaume, extorqués par la crainte de malheurs plus grands encore que ceux qui pourraient résulter desdits actes. Fait en double, le 5 novembre 1789.
[54]
Warlomont, 1969 :
fin 1790, du côté de Mayence, les Princes auraient consulté
l'avocat-général
Séguier sur l'éventualité, en rentrant en France, de constituer un
parlement
unique avec les débris des précédents pour rendre au roi ses
prérogatives
traditionnelles. Il résulte d'un
factum, imprimé sous le titre "Détail exact de la séance publique,
tenue par le ci-devant parlement de Paris à l'Hôtel de ville de Tournai
et des
cérémonies de sa rentrée ainsi que de la messe rouge avec le discours
prononcé
par l'avocat général Séguier dénoncé à l'Assemblée Nationale"
que 158 membres, tant du Parlement de Paris
que des autres parlements du royaume, ont pu être, le 11 juin 1791,
assemblés à
la cathédrale de Tournai. Il est fait état d'une affluence prodigieuse
et,
surtout, de 'Français fugitifs arrivés de Bruxelles et même de Paris'. On signale que la nef était
gardée par des officiers
français en uniforme et que la messe a été célébrée par l'évêque de
Nancy [La
Fare].
[55]
Quoiqu'il évite de théoriser, pour Dessert, 2019, 'l'absolutisme'
est la première ébauche de la technostructure
(p 306). L'omnipotence proclamée de Louis XIV sert de
couverture à
Colbert et à son réseau, que, me semble-t-il, l'auteur a tort de
qualifier d' Etat Colbert qui succéderait à un Etat Mazarin et à un Etat Richelieu,
hommes nouveaux,
remplaçants la traditionnelle gestion par les Grands (Montmorency,
Guise...)
que les Condé auraient voulu maintenir.
Il ne s'agit ni d'Etats ni de technostructure mais de réseaux de clientèles et d'alliances familiales qui occupent et exploitent le système fisco-financier et plus généralement le système de gouvernement. La tête de réseau doit accomplir un énorme travail pour persuader le Roi que tout se fait par ses ordres et qu'il dirige tout, et, d'autre part, pour recruter, implanter et contrôler ses gens. Ce type d' "administration" est alors inévitable car seuls les liens personnels fonctionnent. Cette gestion privée des affaires publiques est coûteuse car chacun prend sa part. Pour que cela ne dégénère pas, il faut à la fois un leadership fort et l'exclusivité. La concurrence des clans et la multiplicité des réseaux rendra le XVIIIe chaotique.
En accusant le Parlement de vouloir faire du roi un "puppett king", le gouvernement cherche à garder le contrôle des ficelles d'un roi dont l'absolutisme apparent est la condition et la garantie du pouvoir ministériel.
Dessert, 1975 : La monarchie qui les a sécrétés malgré ses velléités d'absolutisme ne peut rien sans eux et ils ne peuvent rien en dehors d'elle. Aussi toute tentative pour échapper cette dualité Etat-Puissants ou pour transformer les rapports de force entre ces deux pôles est-elle vouée à l'échec pour l'une ou l'autre partie. Plus grave encore, elle risque de compromettre la cohésion générale du système et par conséquent son existence... Dans ces conditions le lobby Colbert n'est qu'une excroissance normale de la société du xviie siècle... Les grandes dimensions du royaume et les difficultés pour les maîtriser, l'absence d'administration locale adéquate nécessitaient des palliatifs : le recours aux bons offices d'une clientèle dévouée et sûre puisque reposant sur les liens du sang et sur les amitiés s'imposait. Mais... si les fidèles dépendaient du pouvoir, celui-ci était impuissant sans leur soutien qui passait par le service de leurs intérêts privés (p 1326).
[56] Ainsi, Quatorze décharge le Parlement du souci de le défendre des mauvais conseils puisque tout est fait de sa propre certaine science. Plus que les dispositions de l'ordonnance de 1667 (il y en a eu tant de semblables avant !), cette configuration (qui n'exclut pas la coopération) éloigne le Parlement de la scène publique. Se réjouirait-il secrètement de cette tranquillité ? Le silence serait-il connivence ? Le Parlement du XVIIIe, que la confusion ministérielle sollicite trop souvent, regrettera-t-il ce calme ?
Hurt (2002), cherchant à réviser le révisionnisme, ajoute à l'écrasement conventionnel du Parlement son pillage financier. Si les exactions fiscales sont avérées (augmentations de gages etc.), Swann, 2010a, montre à propos de la Bourgogne que la contrepartie se trouve dans les placements financiers rentables qu'il offre (tout impôt est escompté ou remplacé par un crédit qui donne un rendement élevé).
[57] Plus la "monarchie administrative" se développe, plus le roi devient fictionnel. Antoine, 1958, le reconnaît bénignement : les progrès de l'administration avaient entraîné pour le Conseil — et spécialement pour le Conseil royal des Finances — un tel accroissement de besogne, qu'il ne pouvait plus matériellement y faire face. S'ensuivit pour lui la nécessité de couvrir de son autorité les décisions prises en dehors de ses réunions par le contrôleur général et ses principaux collaborateurs. Cette fiction institutionnelle était le point faible du système ; elle allait donner le départ à toutes les plaintes contre le «despotisme ministériel » et exacerber la vieille querelle de juridiction entre Parlement et Conseil/Grand Conseil.
[58]
Richter, 2002 : (à la suite de Montesquieu ?) despotisme
a remplacé tyrannie, évolution lourde de sens et
d'implications : Tyrannie se
rapportait généralement à l'usurpation du pouvoir par un seul, qui se
présentait souvent dans la cité comme le champion du peuple. Le concept
de
tyrannie généra les théories de la résistance et du tyrannicide. Son
emploi
impliquait qu'un régime politique valable pouvait être préservé en
éliminant
les souverains égarés, usurpateurs ou corrompus. Alors que le concept
de
despotisme suggérait que le problème résidait dans le système
politique, corrompu
par nature, plutôt que dans les actions ou les qualités d'un seul
dirigeant.
Résumée par Aristote, la définition du despotisme se polarisait sur
trois
oppositions : entre Hellènes et barbares, maîtres et esclaves,
européens
et orientaux.
La tyrannie est une déviation de la
"monarchie
judiciaire", le despotisme est l'essence de la "monarchie
administrative".
[59] Dans l'Epitre au Parlement de France qui précède son Anti-financier (1763), Darigrand écrit (p 15) : Toutes les Loix possibles n'ont pour but unique que d'assurer la propriété des biens distribués par la Providence aux hommes. Une Loi qui a pour objet de dépouiller de partie de cette propriété, doit donc l'emporter en force sur celles qui l'assurent. Or, cette loi spoliative peut-elle acquérir ce degré d'autorité qui écarte jusqu'au soupçon d'injustice dans la spoliation, si elle n'est au moins revêtue des mêmes formes qui constituent l'authenticité & la force des Loix conservatrices de cette même propriété ? Faut-il un moindre droit à la chose pour abattre que pour édifier ?...Il faut donc conclure que la Loi qui établit les impôts est la première de toutes les Loix publiques, puisqu'elle prévaut sur les droits sacrés de la propriété ; donc c'est de toutes les Loix celle qui demande le plus d'authenticité...
[60] Le visa de 1715, puis le "système" et sa liquidation par l'incroyable opération du visa de 1721 réduisent de moitié la colossale dette publique héritée des guerres de Quatorze : En 1719, Law offrit au roi 1,2 milliard de livres, somme portée ensuite à 1,5 milliard, pour rembourser ses dettes. Les créanciers de l’État étaient alors remboursés en masse, puisque leurs anciennes créances furent simplement converties en billets de la Banque et en actions de la Compagnie des Indes, que le gouvernement eut l’imprudence de multiplier excessivement et sans qu’ils soient en proportion avec les espèces métalliques. Avec le développement du Système, ces nouveaux titres se révélèrent profitables. Par l’effet de spéculation, la valeur d’une action monta en flèche, passant de 500 à 20 000 livres... d’une dette estimée généralement entre 3,5 et 2 milliards de livres à la mort de Louis XIV, il ne subsista plus qu’une dette constituée au capital nominal de 1700 millions de livres après la liquidation du Système et le visa de 1721 (Platonova, 2007).
[61] La monarchie des Bourbons a tout simplement créé un monstre qu'elle ne peut contrôler. Et ce monstre est un monstre violent... il apparaît incontestable que la monarchie française a créé un organisme démesuré par rapport à ses capacités. En 1789, l'absolutisme est tombé en partie en raison de son incapacité structurelle à financer guerres dévorantes et armées voraces avec des revenus normaux et adaptés (Cornette, 2000). Toutefois le problème paraît moins quantitatif que qualitatif. En % "PIB", la "dette publique" en 1789 est au même niveau qu'à la mort de Quatorze. Mais l'impôt rend mal (multiplicité des caisses, fermiers, traitants) et échoue à saisir la "crue" de richesse (augmentation du "PIB" estimée à 60%).
[62] Si la guerre de succession de Pologne (1733-1735) rapporte la Lorraine (maintes fois conquise et perdue), la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) est une victoire pour rien (traité d'Aix la Chapelle) ; la guerre de Sept Ans (1756-1763) une double défaite, et la guerre américaine (1778-1783) ne rapporte qu'une satisfaction d'amour-propre : l'espoir de commercer avec la nouvelle république américaine est vain et l'accord de libre-échange avec l'Angleterre (1786) ruine l'économie.
[63] Remontrances de la Cour des Aides (6 mai 1775). Elles donnent à la suite une autre illustration : en 1725 le feu roi avait exigé de tous ceux qui avaient été anoblis sous le règne précédent, un droit de confirmation à cause de son avènement à la couronne ; mais la loi n'avait pas prononcé la peine de déchéance contre ceux par qui ce droit n'aurait pas été payé ; cette déchéance a depuis été prononcée par des arrêts du Conseil non revêtus de lettres-patentes, comme si on pouvait être condamné à perdre son état d'après des arrêts qui n'ont point le caractère de lois enregistrées : qu'enfin ces arrêts, dont le dernier est de l'année 1730, avaient toujours été réputés purement comminatoires, et que les fermiers-généraux eux mêmes avaient avoué publiquement qu'ils n'avaient jamais été exécutés. En effet, l'exécution en paraissait impossible, parce qu'il répugne à tous les principes de punir la faute de n'avoir pas payé une taxe par la déchéance de la noblesse, peine infamante à laquelle on ne condamne jamais que ceux qui sont convaincus de crimes capitaux ; et qu'il est encore moins possible de faire tomber cette peine sur les enfants de celui qui n'a pas payé, de déclarer déchus de la noblesse des citoyens qui l'ont reçue avec la naissance, et ont toujours vécu conformément à cet état, parce que leur père a négligé autrefois de satisfaire à une loi bursale dont il n'a peut-être pas eu connaissance... [Mais] il s'est trouvé un fermier qui a voulu faire revivre cet arrêt de 1730, oublié depuis qu'il existe, et un ministre qui lui a abandonné toutes les familles qui n'avaient pas payé le droit de confirmation. Ainsi celui dont le père ou l'aïeul ont obtenu l'anoblissement le plus glorieux pour le prix de leur sang et de leurs services, et qui ayant, à leur exemple, passé sa vie dans la dispendieuse profession des armes, ne s'est pas trouvé en état de payer la taxe, pourra aujourd'hui être déchu des droits de la noblesse, quoiqu'il en ait rempli les devoirs ; et sa famille sera reléguée par l'impitoyable financier dans la classe des roturiers, tandis que peut-être ce financier lui-même, anobli par une charge vénale, jouira des mêmes privilèges que la plus haute noblesse.
[64]
Fénelon (Plans de gouvernement pour être
proposés au duc de Bourgogne) : création de six conseils au côté du Conseil d'État, mise
en place d'une succession d'États diocésains, provinciaux et généraux,
suppression des intendants, réforme fiscale et promotion de la
noblesse.
Mousnier
(1951-52, pp 198 sq.) s'insurge contre ce roman antinational :
La réforme
devient une réaction aristocratique contre l'absolutisme bourgeois de
Louis XIV
et même contre tout l'effort absolutiste de la monarchie, depuis la fin
du xve siècle,
l'esquisse idéale d'un
régime qui a failli se constituer aux xive
et xVe siècles...
Le
pouvoir du Roi va être limité par des Etats Généraux, de nobles et de
grands
bourgeois, où domineront les nobles (élus
pour 3 ans, renouvelables)... Leur
fonction principale est de voter l'impôt et d'en surveiller la levée.
Ils
peuvent délibérer sur la guerre, la paix, la justice, les finances, la
navigation, le commerce, les abus, tout. En fait, par le vote de
l'impôt et ce
contrôle, ils seraient les maîtres de la politique royale. Pour les
provinces,...
dans chacune, il y aura des Etats particuliers, recrutés comme les
Etats
Généraux, et avec des pouvoirs analogues. Ces Etats particuliers seront
soumis
aux Etats-Généraux... La
noblesse dominera dans les fonctions judiciaires et administratives
comme dans
les Etats-Généraux. La société française sera aristocratique,
hiérarchisée et
stabilisée, et le passage d'une classe à l'autre difficile. La noblesse
sera
fermée... Non seulement les
nobles auront
le droit d'entrer dans la magistrature, mais ils seront préférés aux
roturiers
à mérite égal pour les places de président et de conseiller des
Parlements, de
lieutenant général et lieutenant criminel des bailliages. Or ces
charges seront
exercées à vie et les enfants dignes succèderont à leur père. Donc, on
aura,
assez vite, un corps héréditaire de «magistrats d'épée», une justice et
une
administration de nobles... l'on
aboutira ainsi à un
gouvernement et à une administration aristocratique, en fait peu
centralisés,
et avec un caractère fédératif, où le roi aura peu de pouvoir réel.
[65]
Campbell 2005, p 12: Certainly an
ancien régime bureaucracy was forming, but one should stress that the
ethics of
it were not yet those of a modern bureaucracy. The state possessed an
administration that created (and exploited) great friction in society.
To
function effectively, government also required political management.
[66] Ces Remontrances ont été imprimées anonymement en 1778 et incluses dans les Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, ou Recueil de ce qui s'est passé de plus intéressant à la Cour des Aides depuis 1756 jusqu'au mois de juin 1775, 1779, [Bruxelles], c'est-à-dire à Paris sans permission. Ces Mémoires sont attribués à "Auger" qui cache vraisemblablement Louis-Achille Dionis du Séjour, président à la Cour.
[67] Par exemple, Remontrances de la Cour des Aides 23 juin 1761 (Auger, p 142 sq.), où l'on reconnaîtra l'essentiel des célèbres Remontrances de 1771 ou 1775 : Telle est, Sire, cette autorité énorme & abusive confiée aux Commissaires départis, qu'en supposant à ces Magistrats toute l'exactitude & toutes les lumières qui leur sont nécessaires, ils ne peuvent jamais répondre de ce nombre considérable de Subdélégués, de Secrétaires, de Financiers préposés au recouvrement, & d'autres subalternes ; de ces subalternes dont le ministère leur est nécessaire pour descendre dans l'examen des facultés de chaque citoyen de votre Royaume...nous prévoyons que les partisans de ce despotisme dont nous nous plaignons ne manqueront pas de se récrier sur ce qu'on a la hardiesse de qualifier de despotisme un pouvoir exercé en vertu de vos ordres, et qu'ils emploieront leurs artifices ordinaires pour faire regarder comme un attentat à l'autorité de VM la dénonciation que nous lui faisons des abus de cette autorité...
Le despotisme sous lequel vos sujets gémissent et qui est l'objet de nos remontrances, n'est point une autorité que VM exerce, ni par elle-même, ni par ceux qu'elle a choisis elle-même et qu'elle honore de sa confiance intime. C'est un pouvoir donné non seulement aux Commissaires Départis mais à une multitude d'hommes sans noms & sans titres, sans commissions émanées de VM, sans pouvoir suffisant pour rendre des jugements réguliers, sans que ceux-mêmes qui les ont choisis puissent souvent dire que c'est par la connaissance de leurs qualités personnelles qu'ils se sont déterminées à ce choix... Cette autorité, Sire, a tous les caractères du despotisme que nous avons mis sous les yeux de VM. Autorité d'un seul homme... Autorité qui n'est point restreinte par la Loi...exercée sans recours et sans appel, non ...qu'il n'y ait un recours...mais ce recours est le plus souvent inutile parce que l'exécution est prompte et irréparable...
Nous ne nous écartons point, Sire, des égards dus à ce qui porte le nom du Conseil de VM mais nous ne pouvons pas nous dissimuler ce que personne en France n'ignore, que ces appels des Ordonnances des Commissaires départis au Conseil de VM ne sont jamais jugés que par un seul homme, par un Magistrat, digne sans doute de toute la confiance de VM mais sujet aux erreurs de l'humanité et nous ajouterons même que ces appels sont absolument une fiction puisque leur multiplicité et la difficulté de constater les faits empêchent de les juger autrement qu'en consultant ce même Commissaire départi de qui on appelé et dont l'avis fait néanmoins la décision... Enfin l'administration réunie à la Juridiction produira toujours le despotisme...
Enfin, Sire, pour
terminer ce tableau général et pour faire connaître à VM la totalité de
la
destruction de l'autorité qu'elle a confiée à ses Cours des Aides, il
nous
reste à lui observer que dans les parties mêmes dans lesquelles cette
autorité
ne parait point avoir été transférée à des Commissaires du Conseil,
elle est
également anéantie par l'usage introduit de détruire l'effet de ses
Arrêts par
ce qu'on appelle des Arrêts du Conseil rendus en Finances... il est
notoire
qu'en matière d'imposition c'est par l'avis d'un seul Magistrat que les
questions les plus importantes sont décidées, que ce même magistrat est
souvent
juge et partie lorsque dans la discussion il
entre une question de compétence, qu'ainsi l'autorité
des Cours des
Aides devient illusoire et que c'est toujours l'autorité arbitraire qui
prévaut, lors même qu'on a voulu conserver aux Cours des Aides leur
compétence.
Le motif qui a fait établir cette forme de cassation, plus irrégulière
encore
que toutes les autres, est sans doute qu'on a prétendu que la décision
de ces
questions appartenait à l'administration... Il peut être
d'administration d'examiner
quelle Loi il est avantageux de faire en matière de finance, mais il ne
peut
jamais appartenir à l'administration d'interpréter la Loi déjà faite,
ni de
juger le Particulier qui prétend s'y être conformé...
C'est la totalité des impositions qu'on a soumises au pouvoir arbitraire, soit en enlevant à vos Cours des Aides leurs fonctions essentielles, soit en les leur conservant en apparence mais en établissant une autre autorité destructive de celle qu'on paraissait leur laisser : autorité toujours exercée par un seul homme sous le nom de VM mais non par VM et sans que les actes de cette autorité viennent jamais à sa connaissance...
...vos Cours des Aides ont la douleur de voir qu'elles ne servent que de prétexte au pouvoir arbitraire, soit qu'on conserve en elles l'apparence seulement d'une cour de justice en matière d'imposition pour faire illusion au peuple et lui dissimuler le despotisme, soit que les auteurs des abus se servent de l'autorité de ces cours pour se soustraire à celle des Parlements... Ce sont là, sire, les très-humbles et très-respectueuses remontrances que présentent à VM vos très-humbles, très-obéissants, très-fidèles & très- affectionnés serviteurs et sujets, les gens tenant votre Cour des Aides, le 23 juin 1761.
Itératives remontrances du 2 sept 1768 :... Une triste expérience nous a démontré, Sire, qu'il existe entre Votre Majesté & le Peuple une sorte de puissance intermédiaire subdivisée à l'infini, puissance inconnue & toujours permanente, dont l'intérêt est le plus souvent contraire à celui du Peuple & à celui de Votre Majesté même... ce sont eux qui enfantent les projets & qui les exécutent ; ce sont eux (permettez-nous, Sire, de dire à Votre Majesté la vérité toute entière), oui, Sire, il est notoire que ce sont souvent eux qui dictent les décisions qui paroissent émanées de votre Conseil ; ces cassations inouïes, qui sont cependant revêtues du nom de Votre Majesté, sont le plus souvent leur ouvrage : enfin il n'est pas possible de méconnoitre leurs influences jusques dans les réponses que Votre Majesté veut bien nous donner de sa main sacrée.
[68] Par la voix du nouveau Garde des Sceaux Hue de Miromesnil : Le Roi sait que s'il existe réellement des abus, il ne faudrait les faire connaître que dans le moment où l'on peut y remédier et qu'il est dangereux d'augmenter l'animosité des Contribuables contre ceux dont le ministère est nécessaire pour la levée des impôts. SM ne doute pas que vous ayez fait les mêmes réflexions et votre intention en faisant ces Remontrances n'a certainement pas été de les rendre publiques mais seulement d'instruire la religion de SM. Vous ne serez donc pas étonnés des mesures extraordinaires que le Roi a prises pour en empêcher la publication. Ce que vous désirez, est que le Roi s'occupe de venir au secours du peuple et à cet égard vous pouvez être certain que vos vœux seront remplis mais vous ne désirez pas qu'il reste dans vos registres un monument propre à perpétuer le souvenir des malheurs que le Roi voudrait faire oublier.
[69]
Michel Hurault de l'Hospital (petit fils du chancelier), alors au
service du roi de Navarre, rapporte (Excellent
et libre discours, sur l'Estat present de la France par un docte
personnage, bienversé aux affaires d'Estat, 1588, p 10 :...Sa foiblesse [du roi Henri III]
finalement est si deshonoree, que
i'ai veu me trouvant en pais estranger devant un grand Prince alié de
la couronne Françoise, qu'en parlant de nostre etat, un de là, qui en
discourait, dit ces mots. Qu'il ne faloit conter [compter] le
Roy que pour un 0 en chiffre, lequel de soi ne peut rien, mais adjousté
à quelque parti, le fait valoir d'avantage. Je l'ai veu & en rougis de crevecœur,
pour la honte de la nation...
Le cardinal de Retz retrouve cette image pour qualifier Conti, le jeune frère de Condé : Je ne crois pas vous le pouvoir mieux dépeindre, qu'en vous disant que ce chef de parti était un zéro qui ne multipliait que parce qu’il était prince du sang (Retz, OC 2, p 180)... Je connaissais bien la faiblesse de M. le prince de Conti, presque encore enfant ; mais je savais, en même temps, que cet enfant était prince du sang. Je ne voulais qu'un nom pour animer ce qui, sans un nom, ne serait que fantôme (id, p 120). Ce nom, un tel nom, transforme une cabale privée en faction publique. Ailleurs, Retz parle d'une position revêtue, comme, dans une fortification, on couvre le rempart d'une couche de briques ou de gazon pour le protéger du canon.
[70] En échangeant la Prusse pour l'Autriche, Quinze perd son levier sur l'Angleterre (Hanovre) et se met dans une impasse : une guerre à la fois continentale et maritime ne peut conduire la France qu'à la défaite.
Duc de Broglie, "L'Alliance autrichienne (Traité de 1756), III. L’entrevue de Babiole", Revue des Deux Mondes, tome 125, 1894) :... Quand Bernis... crut tenir en main le fil d’une négociation véritable, il renouvela ses instances pour obtenir de n’en plus rester chargé seul... Cédant, bien qu’à regret, à ses prières, le roi consentit à lui adjoindre quatre de ses ministres : le ministre des affaires étrangères, Rouillé, Machault, ministre de la marine, le contrôleur général des finances Sèchelles, et Saint-Florentin, préposé aux principaux départemens de l’intérieur. Il eût été naturel d’y appeler aussi le ministre de la guerre, d’Argenson ; mais le roi le croyant trop hostile à l’Autriche et se souvenant qu’il avait à plusieurs reprises insisté pour l’invasion des Pays-Bas, se refusa absolument à s’ouvrir à lui.
« On
peut se
représenter, dit Bernis, la surprise des ministres du roi quand je leur
racontai ce qui s’était passé depuis le mois de septembre
[1755] »...Quoi
de plus blessant en effet, pour des hommes d’Etat pourvus d’un grand
emploi
qu’ils prenaient au sérieux, que de se voir associés, malgré eux, à une
affaire
d’une telle taille, contraire à tous leurs sentimens habituels,
choquant tous
leurs préjugés, et d’apprendre qu’elle était engagée si avant qu’on
n’avait
presque plus la liberté de reculer ! Rouillé [ministre des
affaires
étrangères], en particulier, — dont on avait changé sans lui en dire
mot,
et en quelque sorte derrière son dos, toute la direction de la
politique qu’il
était censé conduire, — devait sentir que son rôle prêtait à rire.
id, (V. Le
traité, tome 125, 1894) :... Le traité, qui
renversait toutes leurs
habitudes [ministres, résidens, chargés d’affaires envoyés auprès des
diverses
cours], tombait sur leur tête, sinon comme la foudre, au moins comme
une douche
inattendue qui les laissait étourdis et stupéfaits... Il n'était [...]
si petit
poste en Europe où un agent français, pénétré des notions qu'il avait
puisées,
dès sa jeunesse, dans les chancelleries, ne se regardât comme une
sentinelle
chargée de surveiller et de dénoncer les menées astucieuses de la
politique
autrichienne, et ne se crût aussi chargé de faire partager sesméfiances
à
l'Etat, quel qu'il fût, faible ou fort, auprès duquel il était
accrédité.
Chacun avait en ce genre sa tâche marquée d'avance, dont il s'attendait
qu'on
lui demanderait compte.... Le mot d'ordre était partout le même :
lutter par
conseils, par dons, par menaces contre la prédominance autrichienne en
attendant le conflit armé. Et maintenant voilà qu'à un jour donné et à
l'improviste les deux rivaux s'embrassent au lieu de se combattre!...
Comment opérer
soi-même, comment expliquer à d'autres ce changement de front?
Sans aborder ici le fond de la question — le manque de fiabilité de Frédéric et le carambolage des Traités (celui entre Angleterre et Russie qui menace la Prusse, celui de l'Angleterre avec la Prusse qui la protège de la Russie et menace l'Autriche, la détournant de l'alliance anglaise et renvoyant la Russie de son côté, celui de la France et de l'Autriche qui menace la Prusse)‑, soulignons la portée de cette révolution diplomatique : de François Ier à la guerre de succession d'Autriche (1740-48) en passant par la Guerre de Trente ans, le but de la politique française a été de contenir l'Autriche. Alors que la guerre américaine avec l'Angleterre a déjà commencé et que Marie-Thérèse est prête à tout pour reprendre la Silésie à la Prusse, la France ne compensera pas son infériorité navale atlantique en s'engluant dans la guerre en Allemagne, tombant dans le piège stratégique tendu par l'Angleterre que Mouffle résume parfaitement : l'Angleterre songeoit dès-lors [1755] à occuper ses ennemis sur terre & à faire une diversion puissante, qui en les obligeant à tenir sur pied des armées nombreuses, les empêchât de continuer à verser pour la marine tous les fonds dont elle auroit besoin. (Mouffle, 1781, T. 3, pp. 65-66).
L'alliance autrichienne ne sera ni comprise ni admise par "l'opinion publique" et les invraisemblables victoires de Frédéric en feront la coqueluche de Paris

