Esambe Josilonus
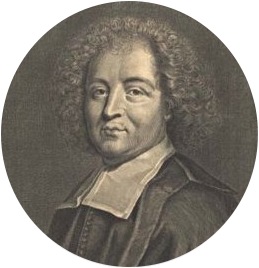
©2024
| 27/11/2024 Esambe Josilonus 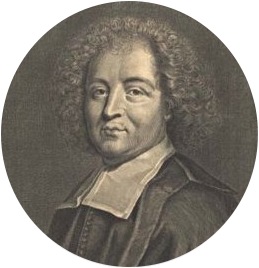 ©2024 | Contrepied :
Histoire des vrais Courtenay |
Je
reprends ici, en le simplifiant et en l'assemblant, le contenu des Appendices 3, 6 et 5 dans lesquels on trouvera plus de dtails en notes et les rfrences bibliographiques compltes. L'histoire des deux Maisons de Courtenay, la vraie et la royale, n'a en commun que la dpossession de Renaud en France (ici, chp. III, section 1).
Les Courtenay royaux ont pour origine le mariage de la jeune Isabeau avec Pierre, dernier fils de Louis le
gros qui , au milieu du XIIe sicle, prend l'hritire, le nom, les terres et les armes. Une brume paisse entoure cette usurpation, comme si les anciens Courtenay sortaient du nant et y rentraient. Or Renaud vivait encore et, pass en Angleterre avec Henri d'Anjou (Henry II), y continua la premire Maison de
Courtenay, de sorte que les descendants de Pierre et Isabeau, de moins en moins royaux, appartiennent une seconde
Maison.
Ici, je ne parlerai de la spoliation des Courtenay que pour expliquer la disparition de Renaud et je prsenterai (pour ce qu'on en sait) l'histoire des Courtenay indpendamment de cette priptie. Je chercherai d'abord leur origine (Chp. 1) et, arriv la premire croisade, je ne ngligerai pas les aventures outre-mer de l'un d'entre eux dont le destin fut autrement glorieux que celui du misrable empereur latin, fils de l'usurpateur (Chp. 2). J'examinerai alors la question de Renaud (Chp. 3) avant de suivre sa postrit en Angleterre : aprs une quasi-extinction, elle russit le revival que ratent les derniers Courtenay franais (Chp. 4).
Au
temps
le roy Robert, fonda le chastel de Courtenay, Haston, le fils d'un [castelier] du chastel Renart, chevalier fu par son sens et par son avoir. Une grant dame espousa dont il engendra Jocelin de Courtenay, et cil Jocelin espousa la fille le conte Gieffroy-Foirole. De celle dame eut deulx fils Guy et Renart, le conte de Joingny. Icil Jocelin, aprs la mort de celle premire dame, espousa Ysabelle, la fille Millon de Montlhery. En celle engendra Millon de Courtenay, et Jocelin, le conte d'Edesse, et Gieffroy Chapalu. Cil Mille de Courtenay engendra trois fils de la sereur le conte de Nevers : Guillaume, Jocelin et Renaut (Grandes
chroniques de France, d. Paulin Paris, Tome 3, 1837, p 170).
Ce roi Robert est Robert II le pieux (ca 972-1031), fils de Hugues, et second roi captien de Francie occidentale (996-1031). Dans le cadre des guerres de Bourgogne, Robert a vinc le comte de Sens et provoqu l'essaimage de son groupe, dj initi par la rvolution des chteaux.
Les origines de la noblesse, comme sa caractrisation, suscitent depuis longtemps recherches et controverses. Rien n'est sr, ni les faits, ni leur interprtation. Hatton est l'un des innombrables chtelains qu'engendre le basculement du pouvoir, des cits (civitates) vers les campagnes (pagi).
Dans le monde n de la dcomposition de l'empire carolingien et des raids normands (deux sries d'vnements dont les historiens interrogent aujourd'hui l'amplitude et les effets rels), les "chteaux" se multiplient partir du Xe sicle, se concurrencent, militarisent l'espace et changent la technique de guerre. L'origine du processus est hybride, la fois "publique" et "prive" (Le Jan, 1995). Du ct public, ce sont les insiders, les comtes carolingiens, commis au gouvernement des villes et de leur pagus : eux-mmes ou leurs vicomtes implantent des points d'appui dont les gardiens s'efforcent de s'autonomiser et de patrimonialiser le pouvoir de ban. De l'autre ct, des "outsiders" difient des "chteaux adultrins", illicites, d'emble privs, qu'ils transforment en pouvoir. De mme que les comtes s'autocratisent en substituant "Dieu" au Roi pour lgitimer leur puissance (comites gratia Dei), s'autorisant ainsi transmettre hrditairement leurs droits ; de mme les chtelains. Ceux qui russissent le mieux, devenus sources de droits, d'honneurs et de cadeaux, tissent de nouveaux rseaux de parentle et de clientle. Dans un univers trs comptitif et trs alatoire (mortalit, volatilit), tout succs reste contest et phmre.
Ce rappel sommaire cadre nos premiers "Courtenay" : ils rsultent de l'atomisation d'un comte de ville et de son explosion en chtelains de pays.
Le point de dpart se trouve Sens, aux limites de la future Champagne et du futur duch de Bourgogne. Depuis 936, un Fromond est comte de Sens. Il n'a d'autre nom que Fromond. Cela signifie-t-il quelque chose ? Chrodmund, Chrotmund, Hrotmund, Fromund, Frumond, Rodmund, Romund, Rodomond, Romont, Fremond, Fremont, toutes ces variantes drivent du scandinave Hrothmund qui est port par l'un des principaux hros du Beowulf.
Parmi les anctres lgendaires des comtes de Boulogne, figurent ces noms rares, Fromond et Fromondin.
Pendant prs d'un sicle (936-1015), Fromond et ses descendants, s'imposent comme comtes hrditaires de Sens, tentent d'en contrler l'archevque, et s'emparent de biens ecclsiastiques qu'ils confient leur clan pour se constituer un rseau d'appuis. Les difficults ne leur manquent pas car ce comt, par sa richesse et sa localisation, suscite la convoitise de groupes bourguignons, franciens, blsois, lorrains et germaniques.
Se succdent : Fromond (comte
de 936 948), Rainard le vieux (948-999), Fromond (999-1012), Rainard le mauvais (1012-1055). Ce
dernier perd la ville. Le groupe familial se rorganise et dveloppe les bases antrieurement plantes dans le pagus. Une ligne deviendra Courtenay.
Les comtes de Sens sont pour nous seulement un prologue. Heureusement, car la documentation manque, les circonstances sont confuses et le rfrentiel des acteurs nous chappe. Outre la variabilit historique de la gographie, notre conception moderne de "territoire" conduit au contre-sens. Il nous est difficile de comprendre que la fluidit de l'espace et des droits coexiste avec la continuit des dtenteurs de pouvoirs. Enfin, les rivalits sont tellement nombreuses et changeantes que, mme en simplifiant, on se perd.
Le
lecteur
press pourra se contenter du rsum prcdent et passer directement la seconde
section qui traite du Hatton mentionn par les Grandes
chroniques.
Le comte et l'archevque, quoique en concurrence dans la cit et ses entours, ne jouent pas la mme chelle. Le pagus de Sens correspond approximativement la partie Nord de l'actuel dpartement de l'Yonne, tandis que la province ecclsiastique rassemble les diocses de Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orlans, Nevers et Troyes. L'archevque de Sens est, ipso facto, commis au "grand jeu". En concurrence avec celui de Reims, il se veut faiseur et conseiller de roi. Jusqu'en 1027, il en sacre davantage que son confrre. Le premier regarde vers la Neustrie, le second vers la Lorraine. Des deux cts, on rencontre de grands noms : Sens, Wenilon, Ansgise, Gautier, Liry... ; Reims, Hincmar, Foulques, Adalbron et Gerbert...
En
848,
Wenilon (archevque de Sens de 837 865) sacre Charles le
chauve Orlans. Mais, en 858, il se joint contre lui Robert le fort, Eudes d'Orlans, Adelard de Paris, et ouvre la voie Louis le germanique qui avance jusqu' Sens et Attigny. Wenilon est le seul vque dans ce groupe de Grands. Les autres vques, pousss par Hincmar de Reims (845-882), raffirment leur fidlit Charles le
chauve. Charles
ayant triomph (859), Wenilon est jug et condamn in absentia au concile de Savonnires (juin 859), puis rconcili. Lui succde Egile (865-6/871) puis Ansgise (871-883), fal de Charles le
chauve que le pape Jean VIII fait primat apostolique des Gaules et de Germanie (875).
A la mort de Charles le chauve, son fils, Louis le bgue (877-879) est sacr par Hincmar de Reims Compigne, tandis que son successeur, Louis III, le sera par Ansgise de Sens. Aprs lui ( 882), aprs Carloman ( 884) et Charles le gros ( 888), comme le fils posthume de Carloman est encore trop jeune (Charles, plus tard le simple), les Grands de Francie occidentale mettent entre parenthses l'hrdit dynastique et, contre Foulques de Reims qui tente d'imposer le roi de Francie orientale, Arnulf, ils lisent roi Eudes (888-898), comte de Paris, fils de Robert le fort, que Gautier de Sens sacre Compigne (Dhondt, 1939).
Quelques annes aprs (893), dans le contexte d'agressions normandes et de difficults du roi Eudes en Aquitaine, ds 893, Foulques de Reims sacre le petit Charles (le simple). Chacun des deux rois combat l'autre, avec des chances variables, cherche le soutien d'Arnulf et des Grands laques, et nomme des vques de son camp.
Par ailleurs, Richard de Bourgogne, frre de Boson, roi de Provence (Mantailles, 879), guerroie depuis longtemps pour rassembler les comts de la Bourgogne du Nord. Il navigue entre les deux rois franciens et met profit les dboires d'Eudes. En 894, la mort du comte de Troyes, Adalelme (Alleaume, Adalhelm), cousin et fidle d'Eudes, permet Richard de Bourgogne de s'emparer de Troyes qu'il confie l'un de ses proches, Garnier (Warnerius), peut-tre un de ses fils. Comme l'archevque de Sens, partisan d'Eudes, a nomm Troyes un vque oppos Richard, celui-ci s'empare de Sens, prononce la dchance de l'archevque, le met en prison, et en profite pour se faire abb de Sainte Colombe la place d'Eudes. Il donne la garde de Sens (vicomt) au mme Garnier qu'il a fait comte de Troyes.
Le roi Eudes, en mourant (898), laisse la couronne Charles le simple, designatio que son frre Robert accepte, ce dont il est amplement rcompens. Charles le simple que Foulques de Reims avait sacr prend prend celui-ci pour chancelier, puis son successeur Herv (900/922). Ensuite, les entreprises lorraines de Charles entranent la rvolte des Grands autour de 920. Charles s'enfuit. Robert, le frre d'Eudes, lu anti-roi, est sacr Reims par Gautier de Sens (922) : une revanche ! Robert tu en 923, la contre-attaque de Charles est arrte par Raoul, le fils de Richard de Bourgogne ( 921), gendre de Robert. Raoul est aussitt lu roi de Francie occidentale et sacr Soissons, encore une fois par Gautier de Sens.
En 936, Raoul meurt. Hugues le grand, fils du roi Robert, rend la couronne Louis IV d'outremer, fils de Charles le simple, qui reconnat sa prminence en le faisant dux Francorum. Hugues prend aussitt Sens (parmi d'autres) Hugues le noir, frre et hritier de Raoul de Bourgogne, auquel il finira par arracher toute la Bourgogne de Richard (946). A Sens, il semble avoir t aid par Fromond, un fils de Garnier. Il lui confie la ville. Voil notre premier Fromond.
Naturellement,
Fromond s'emploie s'autonomiser et se faire comte. Il connat des revers et doit, temporairement, quitter Sens et se replier sur Mont d'Ouanne (le futur Chteau-Renard) o il reconstruit un vieux fort, entre deux bras de la rivire.
Pour le comte de Sens, influencer la dsignation de l'archevque est une tentation autant qu'une ncessit. Outre les droits que les vques dtiennent ou revendiquent sur les abbayes et leurs richesses, ils contrlent directement ou indirectement une partie du pays. De plus l'archevque, par son autorit sur les vques suffragants et ses relations avec les Grands, est un levier grand rayon d'action.
Le fils de Fromond, Rainard, lui succde autour de 948 pour cinquante ans ( 996 ou 999). Une telle dure lui vaut le surnom de petit vieux (vetulus). La mort de Hugues le grand (956) le libre de sa dpendance. Les sources ecclsiastiques en disent grand mal, car il capte ou spolie des terres relevant des abbayes, notamment l'ancienne et prospre Ferrires. Il s'enracine dans le comt, cit et pagus, en multipliant les nouvelles implantations et en consolidant les anciennes qu'il confie aux membres de son groupe familial. A Sens, il s'empare de la riche abbaye de Sainte Colombe dont Hugues s'tait fait abb, et rige la Grosse Tour (turrim maximam) pour augmenter son emprise militaire sur un territoire cloisonn.
Que Rainard l'impose ou le reoive de son alli, le comte de Troyes, le fils de celui-ci, Archambaud, pillard et paillard, devient archevque de Sens en 958. Ils combattent ensemble les Saxons que Brunon de Cologne (frre de l'empereur Otton) envoie contre le comte de Troyes pour secourir son vque. Au grand plaisir des moines de Sainte-Colombe, Archambaud est foudroy par la colre divine (967) lors du grand incendie qui dtruit la cit. Lui succde le saint Anastase qui restaure les abbayes et les glises. La mort d'Anastase (977) fait arriver Seguin (Sewin). Rainard lui refuse l'entre de la ville, Seguin l'excommunie. Quelques mois plus tard, le comte quitte Sens pour l'ouvrir l'vque (fvrier 978).
Ce dml clbre a reu diverses interprtations car Seguin, fils de la sÏur de Rainard, aurait d tre bienvenu. Ecartons la mchancet qu'voquent les chroniqueurs, et remarquons que, si Rainard empche Seguin de s'installer, il ne lui oppose pas un autre candidat ; notons aussi que les malveillantes chroniques ne mentionnent plus d'actes d'animosit du comte pendant les onze annes qui suivent (Seguin 999). Le conflit se localise au dbut (Varenne, 2013) : Rainard semble avoir voulu poser un rapport de forces (et/ou forcer une ngociation), soit pour s'assurer de la coopration d'un neveu rticent, soit pour neutraliser la menace de l'immixtion de la famille paternelle de Seguin.
La
relation
triangulaire constitue par le conflit entre Louis d'outremer et Hugues le grand, arbitr par leur beau-pre commun l'empereur Otton (et son bras occidental, Brunon,
archevque
de Cologne), se poursuit avec leurs fils, respectivement Lothaire, Hugues Capet et Otton II.
Les
ambitions
lorraines de Lothaire finissent par pousser Reims (Adalbron et Gerbert) vers le robertien Hugues Capet. Lothaire meurt en 986 ; son fils et successeur (Louis V), l'anne suivante. Alors, Adalbron fait donner la couronne Hugues (987), dans l'attente d'un carolingien convenable.
Aprs ce coup rmois, le comte de Sens, Rainard, se rallie Capet, la diffrence de Seguin qui n'assiste ni au concile de Senlis, ni au sacre de 987, et ne prte pas serment au nouveau roi. Rainard marie son fils Fromond Gerberge, fille de Rainaud (Ragenold), comte de Roucy et comte de Reims.
Gerberge est la sÏur de Brunon de Roucy, vque de Langres depuis 980 (futur adversaire du roi Robert en Bourgogne), et petite-nice de Brunon archevque de Cologne, en l'honneur et l'imitation desquels un de leur fils est nomm Brunon, le programmant sa naissance pour remplacer Seguin (Varenne, 2013). Mais, quand ce dernier dcde (999), c'est son adjoint, l'archidiacre du diocse, Liry, qui est lu contre Brunon, malgr l'opposition de plusieurs chanoines. Contest, Liry part Rome faire confirmer son lection par le pape Sylvestre (Gerbert, son ancien matre Reims) et, son retour, se heurte Fromond (comte de 999 1012). Liry recommence le long voyage de Rome pour obtenir du pape qu'il ordonne aux vques suffragants de le consacrer et de le secourir. On imagine facilement le type de rapports qui s'instaurent ensuite entre le comte et l'archevque !
Fromond mort, lui succde son fils Rainard le mauvais (iniquorum iniquissimus) qui, de 1012 1055, sera le dernier comte. Son comportement est marqu par l'chec de 999 : d'un ct, animosit contre l'Eglise (vexations et spoliations) ; de l'autre, anticipation de la perte de la cit. Rainard dveloppe sa mainmise alentour. Il tablit ou renforce une srie de forts/fiefs qu'il tient dj ou dont il s'empare, des endroits de passage oblig, sur les autoroutes de ce temps, les grandes rivires ou leurs affluents, notamment Montereau sur la Seine (au dtriment de l'vque), Joigny sur l'Yonne (au dtriment de l'abbaye de Ste Marie), Fert-Loupire etc. A Mont d'Ouanne, le chteau tabli par son pre au milieu de la rivire lui paraissant trop faible, il en rige un deuxime, en haut, sur le mont (au dtriment de l'abbaye de Ferrires) : Chteau Rainard. L'auteur de L'art de vrifier les dates (T.11, p 301) affirme catgoriquement (on ne sait sur quelle base) : Il laissa deux fils, Fromond qui lui succda comme comte et Renaud qui eut en partage Chteau-Renard. Fils ou parent, la garde de Chteau-Renard choit Renaud (Rainier, Rainard) dont sortiront nos Courtenay.
Depuis que, en 1002, la mort de Henri de Bourgogne, son quasi fils, Otte-Guillaume, comte de Bourgogne, s'est saisi du "duch", le roi Robert II, le pieux, fils de Capet, le lui dispute. Robert le Pieux n'accepta pas [Otte-Guillaume] : la Bourgogne fut au centre de ses activits durant une large partie de son rgne. Il lui fallut douze ans de guerre pratiquement incessante pour liminer ce prtendant et reconqurir le duch, depuis Sens et Auxerre, cit aprs cit. Pacifi, il le donna en 1015 son fils Henri, le futur roi Henri 1er...( Bautier, 1985)
Fin
1002,
Otte, soutenu par Brunon de Langres, Landri de Nevers et maints seigneurs locaux, s'empare d'Auxerre qui tient la Bourgogne. L'vque
d'Auxerre ne le suit pas et reste fidle Robert qu'il appelle au secours.
En 1003 Robert amasse une arme. Il passe par Sens pour impressionner Fromond au bnfice de Liry et choue devant Auxerre, l'imprenable. Il pille les terre de l'vque de Langres. Il revient en 1005 et assige Avalon aprs avoir fait la paix avec Otte : celui-ci renonce disputer le duch, tant menac l'Est par Henri de Germanie qui vise, via son pouse Gisle, le royaume de Bourgogne (Rodolphe). Cette fois, Robert prend Auxerre.
En 1015, l'archevque de Sens, Liry, qu'il se sente menac ou excd, ou bien qu'il veuille assurer au roi la porte de la Bourgogne (la route vers Auxerre et Autun), l'appelle au secours (1015). Robert saute sur l'occasion (s'il ne l'a pas provoque). Les troupes royales s'emparent de la ville le 22 avril, mettent le feu, brlent et massacrent la population, peut-tre parce qu'elle soutient le comte, peut-tre par habitude : Venientes vero qui missi fuerant a rege coeperunt urbem cum nimia depopulatione, partem etiam ejus non modicam incendio cremavere (Glaber, LIII, CH6, p71). Fromond, le frre de Rainard, rsiste dans la grosse tour et, vaincu, est emprisonn Orlans.
Li cuens Renarz eschapa et s'enfui touz nuz. S'il perd ses habits et la ville, il tient toujours ses campagnes et leurs forts. Alli au rival du roi, l'ambitieux Eudes de Blois (985-1037), futur comte de Troyes, il lui permet de lier ses possessions de part et d'autre de la Seine en lui donnant Montereau (des terres disputes par l'vque) o ils construisent un chteau qui devint ensuite fort nuisible au roi et l'archevque de Sens. Ultrieurement, Rainard et Eudes reprennent Sens, dvastant tout, puis Rainard accepte un compromis : sa vie durant, il gardera Sens qui, aprs, sera partage entre l'vque et le roi. On comprend que, revenu, il en veuille Liery et le perscute autant qu'il peut.
Mais Sens n'est pas encore au roi ! d'abord parce que Rainard vit jusqu'en 1055, ensuite parce que Liry meurt en 1032, au milieu des troubles lis la succession du roi Robert. En effet, Henri 1er a succd son pre Robert le Pieux le 20 juillet 1031 [...]. Il se heurte immdiatement une formidable opposition, mene par sa mre elle-mme et son frre Robert, mais anime surtout par Eudes II de Blois, remuant et ambitieux, par le comte de Valois Raoul, un cousin, et le comte de Sens Renard. Il est aid en revanche par les ennemis du comte de Blois, le comte d'Anjou et celui de Joigny dont il dsigne le fils comme archevque de Sens (Bautier, 1985, p 543). Eudes de Blois, alli la reine-mre Constance, s'empare de Sens et le garde de 1032 1034, sans profit pour Rainard dbord par son alli. Le nouveau roi (Henri) parviendra reprendre la ville et installer son archevque, Gilduin de Joigny, la place de celui des chanoines et d'Eudes de Blois, Mainard, auquel, en compensation, Eudes donne l'vch de Troyes. Plus tard (1049), Gilduin sera destitu et Mainard, son rival malheureux, se substituera lui.
Le
roi Henri s'tant alli Conrad II contre Eudes de Blois qui dispute l'empereur le royaume de Bourgogne, Eudes riposta en formant avec certains seigneurs de l'Ile-de-France une nouvelle coalition laquelle prit part le second frre du Roi [Eudes], mcontent de n'avoir reu aucun apanage. Alors s'ouvrit une seconde priode de guerres (1034-1039)... La mort du comte Eude II [1037] ne la termina pas : ses fils tienne et Thibaut luttrent avec la mme pret. Menac encore une fois d'tre dpossd de la couronne, Henri Ier reprit Sens, dfit son frre Eude et l'emprisonna Orlans... Aprs la mort du comte de Sens, Rainard, alli fidle d'Eude II, le Snonais fut annex dfinitivement au patrimoine captien (Luchaire, 1910, p 161),
Rainard mourra comme un grand homme, avec prodiges et temptes (1055). Ses droits passeront au roi (Henri) qui marquera le point contre le comte de Blois. On ne sait trop ce que sauvent les anciens comtes, ce qu'obtient le roi, et ce que garde l'vque car la ville est divise en plusieurs parties, les terres du comte nombreuses, les prtentions et droits enchevtrs. L'vque conservera jusqu'en 1790 les quatre baronnies de Nailly, St Julien-du-Sault, Villeneuve-l'Archevque et Brienon et leurs dpendances.
C'est la fin de la priode comtale pendant laquelle le groupe familial s'est enchtel alentour. L'absence de chef de "maison" le dcompose (ou rsulte de sa dcomposition). Joigny prend le chteau-haut de Mont d'Ouanne (Chteau-renard) et Hatton, fils de Renaud, tient le chteau-bas ( moins que ce ne soit l'inverse). Le conflit entre les deux provoque l'viction ou le retrait de Hatton qui se replie sur Courtenay.
A Courtenay, entre Chteau-Renard et Sens, Hatton, le fils d'un castelier du chastel Renart, construit un fort sur une terre anciennement prise l'abbaye de Ferrires, vraisemblablement, une motte castrale partir ou la place d'une premire superstructure de Rainard le vieux. Une position judicieuse sur un affluent du Loing, la limite du Snonais et du Gtinais, mi-chemin entre Sens et Montargis, sur la route de Paris la Bourgogne.
Ce qui compte n'est plus l'honor (mme patrimonialis) mais les droits rels attachs l'espace. En tmoigne le retournement opr en deux gnrations : le comte Rainard donna son nom son chteau et au bourg avoisinant qui le porte toujours (Chteau-Renard, 45220) ; Hatton, au contraire, prend celui de l'endroit o il plante sa base. "Courtenay" devient son surnom, sans autre titre que le commun dominus. Les noms s'enracinent et ce qui restait des villes-fonctions (qui continuent parfois signer les comtes, comme Blois, Nevers etc.) cde la place des enveloppes territoriales de droits.
Courtenay sera le marqueur d'une ligne fodale. Au fur et mesure que l'volution des structures de parent verticalise les groupes sur l'axe paternel et que le pouvoir s'ancre au sol, de tels toponymes affichent et rsument origines, droits et parents alors que, auparavant, les parentles largement endogamiques, dpourvues d'identifiants, mais non de mmoire, se laissaient difficilement apprhender de l'extrieur. L'Eglise a stimul cette mutation en instrumentalisant l'institution centrale du mariage : illicit des unions d'appoint (polygamie) et norme exogamique. Les interdits "incestueux" sont largis un tel degr qu'ils cassent les groupes horizontaux : ds le IXe sicle, l'Eglise proclame la prohibition des unions jusqu'au septime degr canonique de parent (genicula). Cette interdiction impossible respecter rend la plupart des mariages illgaux, conditionnels, et les subordonne la complaisance de l'Eglise. Plus tard, Latran IV (1215) ramnera les cas interdits au quatrime degr canonique mais ajoutera les affins.
Hatton, un maillon d'une large et longue chane entrecroise, sera vu par les gnalogistes des Courtenay royaux comme l'anneau auquel s'attache leur descente, un No originaire qui aurait pris pied dans un monde vide. En 1661 du Bouchet commencera ainsi son Histoire gnalogique de la Maison Royale de Courtenay : Le premier de ses Ayeux qui s'est garenty de l'oubly, paroist dans le Continuateur de l'Histoire d'Aimoin, sous le nom de CHASTELAIN DE CHASTEAV-RENARD. Et on apprend de cet Auteur qu'il avoit un fils nomm ATHON, qui se rendit fameux par sa valeur & qui fortifia le Chasteau de COVRTENAY sous le Regne du Roy ROBERT.
Rtrospectivement, on gratifie Hatton des armoiries des Courtenay (d'or trois tourteaux de gueules) qu'il ne saurait avoir eues : ce n'est que bien plus tard que le binme nom/blason devient constitutif d'identit collective (Nassiet, 1994). Les armes et le cri, pas plus originaires que les noms, reprsentent initialement des "logos" de combat attachs aux personnes, non au lignage. Encore la fin du XIIe sicle, le fils de "Pierre de France", ne sera pas associ gueules trois tourteaux d'or mais au champ d'azur sem de billettes de Nevers (son pouse), armes que sa promotion impriale (Constantinople) remplacera par des croix.
Un groupe hraldique suppose des armoiries identitaires. Si les expditions outremer ont t la matrice des "logos", le passage de l'individu au lignage suppose une double normalisation, celle des armes et celle des familles. Le timbrage fixe ne commencera qu' partir du XIIIe sicle, comme produit d'une infodation hrditaire qui s'exprime par le nom (de terre) et les armes (de famille). Les "fondateurs" n'en avaient pas ou en portaient d'autres, personnelles et temporaires.
Les Courtenay et les comtes de Boulogne affichent les mmes armes, cela ne prouve pas des anctres communs. On peut admettre une concidence : aussi anciennes que primitives, ces armes associent une figure de base (les tourteaux seront les meubles les plus usits) des couleurs vivement contrastes (jaune et rouge). Ce "visuel" lmentaire se peint, se repre et se reconnat aisment. Aucun notaire, aucun juge d'armes ne dressait alors catalogue pour empcher les doublons et les imitations. Nombreux furent ceux qui revinrent des croisades avec, sur leur cu, des merlettes, des coquilles, des figures ondes ou des besants (Mnestrier). Des ronds rouges sur fond jaune, quoi de plus simple ?
Quelles que soient ses couleurs, voil Hatton, rescap du naufrage comtal, ou pilleur d'paves s'il a mis a profit la confusion pour s'implanter. On ne sait de quelles alliances et parentle, il hrite. Si la ligne qu'il fonde n'est pas insignifiante, elle apparat mdiocre. Les domini de Courtenay ne sont pas les hritiers du comte Rainard, seulement des sous-produits. Ils restent sur le march, ils ne l'influencent plus. Quoique, ncessairement, ils participent aux luttes des petits et grands "fodaux" entre eux et avec le roi, aucun d'entre eux ne se signale. Faut-il l'imputer au manque de documentation ? leur habilet ? leur passivit ? leur manque de moyens ? Ils se marient bien, ils agrandissent leur patrimoine, ils comptent mais Ñsi j'ose direÑ ils ne "comtent" plus.
Qu'ils ne soient pas ngligeables, on le voit par le mariage du fils de Hatton, Josselin : il pouse Hildegarde, fille de Geoffroy "Ferrol" Seigneur de Chteau-Landon, comte de Gtinais, & d'Ermengarde d'Anjou, galement parents de Geoffroy le barbu et de Foulques Rchin. Par elle, il devient co-seigneur de Montargis. Josselin se remarie en 1065 avec lisabeth (Isabelle), l'une des Montlhry sisters issues de Guy le Grand, seigneur de Montlhry, et de Hodierne de Gometz-la-Fert. Montlhery was one of those troublesome castellan families - others were Beaugency, Montfort, and Le Puiset - which in the eleventh century had come to dominate the territories round Paris at the king's expenseÉ(Riley-Smith, 1997, First Crusaders, 170).
Josselin s'allie ainsi un clan puissant en conflit constant avec le roi de Paris. Les deux lignages, Montlhry et Puiset, bass la priphrie du petit cÏur captien, sont le type des "brigands fodaux" dnoncs par le lobby royal. De leur puissant donjon, ils font leurs affaires sans tenir compte du roi ou contre lui. Vers 1079, la "guerre du Puiset", un soulvement presque gnral de cette fodalit contre Philippe I. (Fliche, 1912), stimule peut-tre par Guillaume le Conqurant, a fini par une lourde dfaite du roi et de ses allis. On se souvient de la longue srie d'expditions que Louis VI le batailleur, d'abord comme roi dsign, ensuite comme roi, Ñet Louis VII aprs luiÑ, devra conduire pour s'imposer et que Suger emphatisera. Le donjon du Puiset sur la route de Paris Orlans n'a cess d'tre attaqu, parfois pris et dtruit, ensuite reconstruit, puis attaqu nouveau, etc.
Les Montlhry sisters sont fameuses par l'abondance et la qualit de leur descendance. Leurs frres non plus ne sont pas insignifiants.
Parmi ces enfants de Guy et Hodierne, notons:
* Milon "le Grand" de Bray, seigneur de Montlhry
* Guy "le Rouge", comte de Rochefort
* Mlisende x Hughes de Rethel par lequel leur fils Baudoin du Bourg tient aux comtes de Boulogne, parent grce laquelle il se fera roi de Jrusalem (Baudoin II) et en fondera la ligne (Mlisende => Baudoin III, Amaury I => Baudoin IV, Sybile=> Baudoin V...)
* Alix x Hugues le Puiset, "Blavons" de Breteuil, Vicomte de Chartres
* Isabelle x Josselin de Courtenay
* Mlisende "Caravecina" x Pons de Tranel, Seigneur de Pont-sur-Seine
* Hodierne (Ermesende) x Gauthier, Seigneur de Saint-Valry
Isabelle et Josselin ont pour fils un Miles ou Milon, n en 1068 (mort aprs 1127), et un Josselin, probablement l'an. Nous le verrons au chapitre suivant, ce dernier participe en 1101 la malheureuse arrire-croisade du comte de Nevers, survit, et devient seigneur de Turbessel (1102-1113) en Syrie, prince de Tibriade (1113-1119), enfin comte dÕdesse (1119-1131). Aprs lui, deux gnrations de Courtenay appartiendront aux Grands d'outremer : ses successeurs (Josselin II et III), la reine-mre Agns et sa fille, Sybille, reine de Jrusalem.
Milon, le frre de Josselin, ou bien n'a pas cd aux mirages, ou bien est rest pour remplacer son an comme dominus, dfendre les terres et les agrandir. Il se marie grandement en 1095 Ermengarde, fille de Renaud II, comte de Nevers, et dÕIda/Raymonde (elle-mme fille d'Artaud V, comte de Lyon et Forez, et veuve de Guigues, comte d'Albon et de Grenoble). A l'approche de sa mort, Milon fonde en 1124 l'abbaye cistercienne de Fontaine-Jean charge de prier pour lui, restitution partielle de terres prises l'Eglise et institution d'une "basilique" familiale. Milon achve la territorialisation en fixant les morts au sol. Fontaine-Jean, entre Chteau-Renard et Champignelles, dtruite plusieurs fois pendant la guerre de cent ans, sera anantie pendant la rvolution.
Les fils de Milon, Guillaume et Renaud (Reinaldus de Monteargiso), partent outremer avec Louis VII, volens nolens. Le premier meurt et Renaud (Rainard, Rainier etc.) revient aussitt en France occuper son hritage ; il "domine", en tout ou en partie, les seigneuries de Courtenay, Chteau-Renard, Blneau, Tanlay, Charny, Montargis etc., sans qu'on sache de quoi il tait suzerain et de quoi vassal. Il semble avoir pous Helwise, fille de Ferry de Donjon. Vers 1150, il "disparait" (cf. infra, chp. 3), et sa fille lisabeth (Isabeau) lui succde, un beau morceau, la premire priphrie du domaine royal, qu'il fallait garder des mains concurrentes. Le roi donne Pierre, son plus jeune frre, la fille, les terres et le nom. On connat la suite.
Avant d'en arriver l, nous ferons un dtour par l'Outremer o brillent Josselin et sa descendance, jusqu' ce que le reflux des Francs les emporte.
Fin XIe, la "rvolution des chteaux" est termine, mme si ses rsultats restent provisoires (concurrences). Ce sont ces hommes, les chtelains, leurs chevaliers, leurs hommes et leurs prtres, qui passent Outremer et Ñsoulignons la diffrence avec l'expdition quasi contemporaine des Normands en Angleterre Ñ, ils ne sont pas dirigs par un chef. Ce sont des armes de comtes. En ce sens, la 1re croisade (1095-1099) exporte la "rvolution des chteaux".
Malgr les droits de l'empereur de Constantinople, la conqute de l'Outremer sur les mirs "musulmans" en fait un pays ouvert. Le turning point d'Antioche est clairant : la ville conquise, on "oublie" l'empereur. A Nice, l'empire, prsent et actif, avait rcupr la cit sans contestation. A Antioche, l'arme impriale, trompe, se retire et Bohmond se dclare prince souverainÑnon sans combats (avec Raymond de Toulouse d'abord, Alexis Comnne ensuite, et bien sr les Turcs).
La msaventure franque de l'empire "romain" en Syro-Palestine n'est ni sans prcdents, ni sans remdes. L'empire utilise frquemment des barbares ÑCumans ou NormandsÑ contre d'autres : les chiens mordent les chiens (Francos cum Turcis praeliantes, quanti canes se invicem mordentes). Ces "allis" se contrlent difficilement, surtout lorsque, victorieux, ils cherchent se mettre leur compte et s'installer (cf. avant la croisade, les tentatives successives de Herv, Crispin et Roussel). L'empire Ñet Alexis, personnellementÑ en a l'habitude. En fin de compte, quelques dizaines d'annes plus tard, les empereurs Jean II et Manuel reprendront le contrle de la Syrie. Mais le temps de l'empire est pass, la "rvolution des chteaux" le renversera (1204) et, de Constantinople la Grce continentale en passant par les les, il clatera en princes, duchs, baronnies et seigneuries. La "quatrime croisade", comme la premire, sera une expdition de barons avides alors que les infructueuses deuxime et troisime ont t des guerres royales (Housley, 2006, pp. 66-67).
On connat les trois Josselin successifs par l'Histoire des faits et gestes dans les rgions dÕoutre-mer de Guillaume de Tyr (c1130-c1184) dont le succs mondial, dans son temps et le ntre, doit autant ses qualits narratives qu' son exhaustivit : Guillaume est le seul couvrir tout le sicle, mme s'il n'en a pas connu directement la premire moiti. Les Josselin ne sont pas absents non plus des chroniques armniennes et arabes qui ont enregistr leurs faits d'armes et leurs cruauts. Comme ils ont marqu la politique et laiss des traces dans les chartes, l'historiographie des Croisades ne les ignore pas : par exemple, on compte une centaine d'entres dans les deux premiers tomes de l'Histoire des croisades de Grousset (1934).
Murray (2006) rsume ainsi l'histoire de ces Courtenay d'Outremer :
L'un des petits-fils d'Hatton [de Courtenay], le redoutable Josselin ( 1131) vint en Outremer autour de 1101 et devint seigneur de Turbessel dans le comt d'Edesse, alors gouvern par son cousin Baudoin du Bourg. Priv de sa seigneurie par Baudoin en 1113, Josselin rejoignit le royaume de Jrusalem et fut fait seigneur de Tibriade [prince de Galile]. Lorsque Baudoin devint roi de Jrusalem, il infoda le comt d'Edesse Josselin. La famille de Josselin acquit une puissante position, en mlant conqutes et politique matrimoniale, notamment travers d'troites relations et intermariages avec la noblesse latine et armnienne. Malgr la prise du comt d'Edesse par les musulmans, les enfants de Josselin II ( 1159) devinrent des personnages centraux du royaume de Jrusalem : Agns ( aprs 1186) pousa Amaury, comte de Jaffa, et son frre Josselin III ( 1200) devint snchal du royaume. Quoique Agns ft contrainte au divorce quand Amaury devient roi (1163), elle et Josselin devinrent trs influents durant le rgne du fils d'Agns, Baudoin IV (1174-1185). Ils jourent un rle dterminant dans la nomination d'Hracle [Hraclius d'Auvergne] comme patriarche latin de Jrusalem (1180) et assurrent la couronne la fille d'Agns, Sybille (1186). Leurs actions ont t juges svrement par les historiens, en partie sous l'effet de l'Histoire de Guillaume de Tyr, leur ennemi. Les filles de Josselin III se marirent des occidentaux et vendirent leurs terres l'ordre teutonique (ma traduction).
Organiser l'expos par rapport Edesse est la fois commode et pertinent. Josselin premier est associ ce rsultat accidentel de la 1re croisade, Edesse dont le comt fournit ses rois au royaume et, en mme temps, constitue sa pointe avance et son rempart. Josselin second perd Edesse (1144-1151) et la 2nde croisade qui devait la reprendre tourne au gchis. Il meurt aprs une longue captivit. Ses enfants, Agns et Josselin troisime, rinvestissent leur capital dans la politique du royaume de Jrusalem. Ce panier de crabes ne rsiste pas Saladin, et la croisade de la dernire chance ne sert rien.
Josselin (Joscelin, Jocelyn, Gauzlin, Djoslin, Josseran, Jozeran) ne s'est pas joint aux premiers contingents. Il n'a pas particip l'pope hroque, ni au sige d'Antioche, ni la prise de Jrusalem. C'est sans lui que Baudoin de Boulogne s'attribue Edesse, moins un comt franc quÕun comt armnien direction franque (Cahen, 1940).
Josselin arrive aprs la conqute, comme d'autres membres du groupe Montlhry-Puiset venus renforcer l'emprise du clan et trouver Outremer une heureuse compensation la pression royale en Ile-de-France (ou une chappatoire aprs dfaite). Dans ce terrain d'aventures ouvert o les morts au combat permettent un renouvellement permanent, o il suffit de conqurir pour se placer, tout guerrier peut trouver un seigneur servir, une veuve pouser, une troupe commander, un chteau garder et, par l, s'il a de la chance, prendre "l'ascenseur social". Les exemples ne manquent pas dans ce territoire incertain, fragment, polycentrique et menac. Mais les envahisseurs apportent avec eux leurs "rapports sociaux", marqus, non par l'individu, mais par le groupe.
La Croisade se composait d'armes distinctes (et non convergentes), celles des Normands de Sicile, des Normands de Normandie, des "Provenaux", des "Lorrains" etc, chacune sous le drapeau de son Grand, chacune assemblant des bandes avec leur big man qui s'emploie fdrer ÑcoagulerÑ ses hommes. Toute action collective passe par des conseils, pressions, discussions, marchandages, indemnisations. Une fois le pays conquis, la disponibilit des terres et la fluidit des marches donnent de la plasticit aux relations "fodales" importes. Dans ce cadre gnral, les groupes de clientle et de parent (souvent articuls) sont la norme et la clef.
Les Montlhry-Puiset russiront particulirement bien : ils dominaient les colonies du Levant tablies la suite de la 1re croisade et dirigeaient le mouvement. Le roi de Jrusalem tait l'un d'entre eux. Le comt d'Edesse dans le nord de l'Irak et les deux plus importantes seigneuries de Palestine taient dans les mains de cousins. Un quatrime cousin tait abb de l'un des plus prestigieux monastres de Jrusalem et un cinquime fut patriarche (bien qu'il se soit rvl un handicap). Ils s'allirent par mariage avec les chefs des deux autres colonies, la principaut d'Antioche et le comt de Tripoli [...] Peu de chevaliers gagnrent beaucoup aux croisades, mais les Montlhry en ont profit de manire spectaculaire, mme si leurs ambitions ne furent jamais totalement satisfaites (Riley-Smith, 1997, First Crusaders, p 7-8, ma traduction)
Citons en particulier, le fameux Hugues du Puiset, comte de Jaffa : en 1132, la tte des barons du parti de la reine Mlisende, sa cousine, il s'opposera au roi Foulques et, quoique dfait, empchera celui-ci d'vincer celle-l (Mayer, 1972; Besson, 2015). Il est le petit-fils de Hugues Ier Blavons, seigneur du Puiset, et d'Alice, l'une des fameuses Montlhry sisters comme la mre de Josselin.
Josselin, vraisemblablement, vient avec l'arrire-croisade de Guillaume de Nevers, le beau-frre de son frre. Il fait partie du petit nombre de survivants qui russissent gagner Antioche.
Il arrive au bon moment : Baudoin du Bourg, le fils de sa tante Mlisende de Montlhry, vient d'tre enfieff du comt Edesse par Baudoin de Boulogne qui, aprs la mort de son frre Godefroy "de Bouillon" (1100), s'impose comme roi de Jrusalem, malgr le patriarche et Tancrde d'Antioche. Devant abandonner son comt, il le confie son cousin du Bourg.
Il reste beaucoup faire dans un pays fait de small pockets of territory surrounded by lands ruled by autonomous warlords, either Armenian or Turkish...Even those areas under his direct rule had Armenian soldiers and castellans (MacEvitt, 2008, p 75-6). Baudoin du Bourg, centr sur Edesse, a besoin d'un homme fiable pour tenir la partie occidentale du comt et le gu sur l'Euphrate : il tablit son cousin Josselin seigneur de Tell Bashir and Rawandan (ibid., p. 80).
A partir de son installation "Turbessel" (Tell Bashir), Josselin apparat dans les chroniques et chansons dont certaines, rtroactivement, le listent dans les chefs de la 1re Croisade (Mathieu d'Edesse) ou mme, sous le nom de Jozeran, le comptent parmi ceux qui ont pris Jrusalem. Il s'illustre par ses exploits guerriers et ses captivits (1104-08 et 1122-23) dont la dernire deviendra une lgende: emprisonn avec le roi Baudoin II et le cousin Galran du Puiset, ils s'emparent du chteau o ils sont dtenus. Josselin part chercher des secours, traverse les lignes ennemies dguis en paysan, franchit l'Euphrate accroch des outres. Pendant ce temps, le chteau est assig et repris. Ses dfenseurs massacrs, sauf le roi, son neveu et Galran. Josselin revenant avec les secours, apprend qu'il est trop tard et commet d'immenses ravages en reprsailles. Cet pisode abondamment repris (d'Albert d'Aix Orderic Vital) illustre aussi le soutien armnien Josselin.
Josselin l'ouest, Baudoin l'est de l'Euphrate. Le premier dfensif (contre Antioche), le second offensif (vers la Msopotamie). Stratgiquement, le comt protge les autres Etats latins. Appuy au Nord et l'Ouest aux montagnes armniennes dont les valles descendent vers l'Euphrate, il s'ouvre l'Est sur Mossoul et au Sud sur Alep Ñ un coin entre la Syrie musulmane et les mirats de Msopotamie (Stevenson, 1907). Dans ce comt htrogne et coup par l'Euphrate, la coopration de Baudoin et Josselin, mise entre parenthses pendant leur captivit commune (Harran, 1104), devient problmatique aprs leur libration (1108) quand l'quilibre est rompu : d'une part, le compromis avec les chefs armniens sur lequel il se fondait est affect par les soupons et les attaques de Baudoin ; d'autre part, l'offensive de Mawdd, difficilement contenue, conduit Baudoin abandonner partiellement la partie orientale ravage (1110).
En consquence, la partie occidentale (Turbessel) devient le cÏur du comt. Baudoin la rcupre en accusant Josselin de trahison (1113). Celui-ci rejoint le roi de Jrusalem, Baudoin de Boulogne, qui le recycle Tibriade (seigneurie de Galile, l'une des deux grandes Princes du royaume), d'o il mnera des attaques sur le Hauran.
A la mort du roi (1118), Josselin, loyal son cousin et/ou inquiet de l'ventualit d'un roi tranger, contribue de faon dcisive au "coup d'Etat" qui donne la couronne Baudoin du Bourg. Pour autant que l'hrdit compte dans l'lection du roi par les barons, du Bourg, simple cousin du roi, n'tait pas le candidat naturel. En 1100, la couronne passa de Godefroy son frre Baudoin de Boulogne en respectant la hereditarie successionis antiquissimam legem. Baudoin mourant sans enfant malgr ses deux mariages, les barons choisissent son frre Eustache, comte de Boulogne. Josselin, lui, s'oppose un roi tranger au pays et plaide pour un qui soit prsent et acclimat (du Bourg). Les partisans d'Eustache partis le chercher Boulogne, Josselin runit nouveau le conseil des barons. En tant que prince de Galile, il est un des principaux du royaume et, d'autre part, du Bourg ne manque pas de soutiens : le conseil rvoque la dcision prcdente et lit du Bourg qui Ñpar un heureux hasard qu'on attribue gnralement JosselinÑ se trouve Jrusalem en plerinage. Il se fait couronner aussitt. There can be no doubt that Joscelin of Courtenay, who as lord of Galilee was the greatest magnate in the kingdom, had manipulated a parlement to get his first cousin the throne... (Riley-Smith, 1997, First Crusaders, pp. 173-4).
Baudoin II, aprs son avnement, pour asseoir son pouvoir, place ses parents et amis aux postes de commande. Pour rcompenser Josselin (ou l'loigner ?), il le met la tte du comt d'Edesse, confiant la Galile un autre cousin, Guillaume de Bures.
Josselin se rinstalle Turbessel, dans la partie utile du comt. Outre l'ennemi naturel, il doit s'occuper de la relation avec Antioche qui, en 1108, avait tourn la guerre ouverte : pendant la captivit de Baudoin, la garde du comt fut confie Tancrde, prince d'Antioche ad interim aprs le dpart de Bohmond. Tancrde l'a dlgue son cousin, Richard de Salerne (Richard du principat) dont la rgence et les exactions ont excit beaucoup de mcontentement. On ne s'tonnera pas que les deux ne fassent aucun effort pour la libration de Baudoin et Josselin. Lorsqu'elle survient quand mme, ils refusent de rendre le comt. Les deux camps s'affrontent en bataille range, chacun avec ses allis musulmans.
Josselin, devenu comte, essaie d'obtenir la paix en se remariant Marie d'Antioche (1121), la fille de son ancien ennemi Richard. Le frre de Marie, Roger, devenu Rgent d'Antioche par la mort de Tancrde, lui donne Azaz (Hasart), une place capitale la jonction des deux comts. Le conflit rebondira lorsque Bohmond II viendra occuper son hritage (1127) : Joscelin summoned Turkish forces to his banner and with their aid ravaged the principality of Antioch during the summer of 1127 and compelled the Antiochenes to recognize his rule (Nicholson, 1969). Sous une forme ou une autre, la tension se maintiendra la gnration suivante. Josselin II et Raymond de Poitiers (Raymond d'Antioche) refuseront de s'entraider, ce qui contribuera la chute d'Edesse et, par contrecoup, l'affaiblissement d'Antioche.
La non coopration est d'autant plus dommageable que les deux entits sont prises en tenailles entre les "Turcs" et la reconqute byzantine (Diehl, 1903). Raymond sera contraint reconnatre la suzerainet de l'empereur (1137), comme Josselin II (1142). Rvolt, puis battu, Raymond mendiera son pardon Constantinople (1144). Pour les empereurs Jean et Manuel qui, outre leurs qualits personnelles, profitent d'une situation favorable, la Cilicie, Antioche, Edesse, appartiennent l'empire et leurs princes en sont dpendants. Edesse perdue et son comte prisonnier (1150), son pouse Batrice vendra les restes l'empereur (qui les perdra son tour). De l'autre ct, le successeur de Raymond, le calamiteux Renaud de Chatillon, aprs ses provocations en Cilicie et Chypre, verra arriver une arme impriale Antioche et devra s'humilier plat ventre (1158). Manuel, matre de la Syrie (ce qui en reste), deviendra le protecteur des Latins. Des alliances croises seront noues. La stratgie d'Alexis russit : les barbares sont solubles dans l'empire.
Josselin I est mort la mme anne que Baudoin II (1131). With Baldwin and with Joscelin dead, the old generation of pioneer Crusaders was ended (Runciman). Comme Baudoin du Bourg, Josselin a pous une princesse armnienne dont le capital relationnel est prcieux. Baudoin ayant tabli son contrle sur le comt, Josselin passe l'expansion qui, par ncessit (main d'Ïuvre militaire) et par attrait (pillage, conqutes), se mne conjointement avec les Armniens : While Baldwin II had built up the internal structure of the county, Joscelin was a vigorous military leader intent on expanding the county's boundaries ((MacEvitt, 2004, p. 93).
Josselin II hrite du comt d'Edesse en 1131 et pouse en 1132 Batrice, veuve de Guillaume de Sane (Sahyun). Ils engendreront :
1) Agns qui frlera la Couronne par le second de ses quatre mariages (Renaud de Marash, Amaury frre du roi, Hugues de Ibelin, Renaud de Sidon) ;
2)
Josselin
(futur III) ;
3) Isabelle qui maintiendra l'indispensable alliance armnienne en pousant un prince des montagnes, le rupnide Thoros.
Josselin II apparat dans toutes les histoires des Etats latins comme le nom de leur premire dfaite stratgique : son comt, pice la plus avance de l'ensemble, est le premier tomber. Guillaume de Tyr lui reproche d'avoir vcu dans le luxe et la dbauche Turbessel au lieu de dfendre Edesse. Mais, on l'a vu, la partie au-del de l'Euphrate est dlaisse depuis 1110. La cit d'Edesse est un centre commercial et une forteresse habite, bien plus qu'une capitale. Ses fortifications et sa position avance et stratgique lui valent autant d'attaques et de siges qu'elle en repousse jusqu' ce que, en 1144, le puissant Zengi la conquire. En 1146, Josselin tente de la reprendre et choue. Edesse, au lieu d'tre le verrou d'Alep, devient un point d'appui de Nur ad-Din quand il prend possession aprs la mort de son pre Zengi (1146).
Que Josselin II st ou non que son cousin germain Renaud viendrait avec la "seconde croisade", on imagine avec quelle impatience il devait attendre celle-ci et quelle dception elle lui apportera. Initie pourtant par la chute d'Edesse et la ncessit de secourir le Nord, cette expdition aggravera la situation : Pendant la priode de la "seconde croisade", il n'y eut aucune coopration entre le Nord et le Sud, et mme l'inimiti commena remplacer l'indiffrence qui s'tait rvle si nuisible. Les seules guerres avec les Musulmans qui intressaient Jrusalem taient ses propres frontires... Au lieu de s'associer Antioche et Damas contre Nuredin, ils attendirent l'invitable attaque et employrent l'intervalle s'aliner leurs allis [Damas] et abandonner Nuredin les avantages qu'ils possdaient (Stevenson, 1907, pp. 154-5, ma traduction).
Nul doute que, en 1148, Antioche, Josselin, comme Raymond de Poitiers, comme aussi Alinor et ses barons aquitains, ne pousse attaquer Nur ad-Din Alep, ce qui, en outre, aurait port un coup indirect l'empereur Manuel, toujours soucieux de limiter les ambitions et le potentiel "latin" en Syrie du Nord.
Mais ni le "turc", ni le grec n'avaient rien craindre: Louis VII obnubil par Jrusalem, rapte son pouse Alinor et s'enfuit littralement d'Antioche. Edesse oublie, la croisade, dj bien mal partie, va s'autodtruire Damas. Ce choix rsulte d'une multitude de raisons, principalement la fragmentation des Etats Latins et la lutte pour le pouvoir Jrusalem entre les deux co-rois, la mre et le fils. L'expdition Damas se fait sans le concours d'Antioche, ni de Tripoli, ni d'Edesse, et, comme on le sait, abandonne en quelques jours. Outre les difficults propres de l'affaire, les barons de Mlisende contribuent son chec.
L'affrontement arm de la mre et du fils au printemps 1152 apporte la victoire au second. Baudoin rgne enfin. A sa mort (1162), lui succde son frre Amaury, le fils fidle de Mlisende, elle-mme dcde en 1161.
Quant aux restes du comt d'Edesse, pris entre deux meules, celle de Massoud d'Iconium et celle de Nuredin, Batrice, l'pouse de Josselin, les a vendus l'empereur. Elle se replie sur Jrusalem avec son argent et ses enfants. L'empereur a pay pour rien, il ne parviendra pas dfendre ses acquisitions. Tout est dfinitivement perdu en 1151. Josselin II, lui, aprs une dizaine d'annes de captivit Alep, meurt en 1159, un mois avant que l'empereur obtienne de Nuredin la libration des captifs.
Mme si Josselin III reste comte titulaire d'Edesse, la suite de l'histoire se passe Jrusalem o, on le verra, Agns, sa sÏur, joue un rle important.
En compensation de ses pertes au Nord, le jeune Josselin reoit de Baudoin III des terres autour d'Acre et un fief-rente sur les revenus du port (Nicholson, 1973). Ses succs militaires lui valent d'tre marchal du royaume (conntable en second) de 1156 1159. Sa position s'amliore encore par le mariage de sa sÏur Agns avec Amaury, le frre du roi (1157). Mais Josselin est captur la bataille d'Harrim (Harenc), probablement en 1164, avec les autres chefs : Colomon (gouverneur de la Cilicie byzantine), Bohemond III d'Antioche, Raymond III de Tripoli, Hugues de Lusignan. Josselin reste longtemps prisonnier Alep tandis d'autres paient leur ranon ou sont rachets par leurs proches. Il ne rapparat qu'en 1176, sauv par sa sÏur Agns.
Agns, fille de Josselin II, a frl la couronne en 1162 quand son poux Amaury en a hrit. Mais les barons n'en voulaient pas comme reine et Amaury l'a sacrifie : une opportune dcouverte de consanguinit justifie le dmariage. Les contemporains expliquent l'viction par des facteurs personnels : Agns tait trop vieille, sa conduite relche, elle serait mme "bigame" etc. Mais, comme la plupart du temps, les arguments ad feminam cachent et expriment la fois une lutte de factions. Batrice ne s'tait pas replie seule d'Edesse et sa cour de barons "rfugis" entourait Amaury. Les Grands de Jrusalem rcusaient cette influence trangre.
Ce "divorce" se prsente curieusement : le mariage est dclar la fois nul et valide. Les ex-poux ont le droit de se remarier (Agns aussitt, Amaury en 1168 avec Marie Comnne, nice de l'empereur Manuel) ; et en mme temps, leurs enfants, Baudoin et Sybille, restent lgitimes et conservent la totalit de leurs droits hrditaires la couronne, alors que si le mariage tait rput n'avoir jamais exist, il ne produirait aucun effet.
Agns pouse le puissant Hugues de Ibelin, seigneur de Rama. Douze ans aprs, en 1174, la mort d'Amaury transmet la couronne son fils Baudoin (IV), encore mineur. Agns, mre du roi, revient au premier plan. Par raison de famille ou besoin de soutien, elle fait racheter Josselin par le Trsor royal (1176). Le royaume vit ses dernires annes : partir de l'Egypte, Saladin prend Damas et commence sa longue conqute de la Syrie de Nuredin et des possessions latines.
Josselin est aussitt nomm snchal (administrateur) du royaume. Par achats, assignements, changes et hritages, il agrandit son propre domaine en terres et en fiefs-rente et redevient un grand seigneur : la seignorie dou conte Jocelin, known then as now only by that rather indefinite title, was never an homogeneous unit but was always an agglomration of separate entities welded together by the man who acquired them and dispersed almost immediately after his death (La Monte, 1938). Acteur important dans la politique du petit royaume, il est du parti d'Agns et des barons qui combattent la prpondrance de Raymond de Tripoli.
A la mort de Baudoin IV le mezel (1185), la couronne aurait d passer sa sÏur Sybille dont la vie conjugale est accidente car, hritire prsomptive, elle fera roi un mari qu'on lui cherche apte couronne. Le comte de Sancerre ayant dclar forfait, c'est Guillaume longue pe, fils an du marquis de Montferrat qui l'pouse en 1176 et meurt aussitt de maladie, laissant un fils posthume, Baudouinet. Le duc de Bourgogne, pressenti pour pouser la veuve (1179), tarde trop. Sybille choisit Baudoin de Ibelin mais il est captur et, son retour, la trouve fiance Guy de Lusignan qu'a jet dans ses bras son frre Amaury de Lusignan, conntable du royaume, alli la reine-mre Agns. Mais les Grands ne veulent pas du calamiteux Guy. Baudoin IV, justement inquiet de sa mdiocrit, l'a loign du pouvoir et, pour court-circuiter Sybille et Guy, a saut une gnration en dsignant pour successeur (et en l'associant lui de son vivant) le petit Baudouinet, le fils de Sybille et de Montferrat. Raymond de Tripoli devient rgent du royaume et Josselin tuteur de son petit-neveu.
La rapide mort de l'enfant (1186) ouvre la bataille contre Raymond de Tripoli. Le trne est vacant. On demande aux rois d'Europe de l'attribuer et, en attendant, Raymond resterait rgent. Sybille s'empresse de prendre la couronne, en tant qu'hritire naturelle de son fils.
Josselin joue un rle dcisif dans ce coup d'tat. Par ruse, il empche le Rgent de venir Jrusalem. Par force, il prend le contrle militaire de la ville. Reste le problme du mari de Sybille. Les barons la mettent en demeure de divorcer. Une scne de comdie : elle accepte condition de choisir elle-mme son nouveau mari et dsigne... Guy. En fin de compte, ils sont couronns tous deux.
Les barons du parti adverse ne parviennent pas leur opposer un anti-roi, abandonnent Raymond et se rallient Jrusalem. Pour leur malheur. Dans une situation militaire difficile, l'aventurisme de Guy de Lusignan et sa mfiance l'gard de Raymond conduiront au dsastre d'Hattin (juillet 1187) o il sera captur, avec Josselin et bien d'autres.
L'arme latine dtruite, Saladin ne rencontre plus de rsistance en Palestine Ñsauf TyrÑ et entre dans Jrusalem en Octobre 1187. Ds lors, le royaume ne sera plus qu'un croupion, mme si virtuellement il se continue Chypre.
Josselin, relch avec Guy en 1188, se heurte avec lui Conrad de Montferrat, frre de Guillaume, qui vient de sauver Tyr et aspire la royaut. Josselin accompagne Guy au sige d'Acre (Akka). Saladin concentre ses forces pour aider les assigs et la troisime croisade (Philippe Auguste, Richard d'Angleterre etc.) apporte les siennes aux assigeants. La ville finit par tre prise en Juillet 1191 aprs deux ans d'efforts et de rsistance. Victoire sans lendemain.
On ne sait plus rien de Josselin (After that nothing is known of him) : s'il est encore en vie aprs Acre, il aura probablement soutenu Guy dans son drisoire combat avec Conrad pour la "royaut" et, peut-tre, en 1192 l'aura-t-il suivi Chypre, son lot de consolation. A moins que la mort de sa nice Sybille (1190) par laquelle il touchait la couronne ne lui fasse abandonner la partie. A plus de soixante ans, sa carrire tait finie.
De son mariage tardif avec Agns de Milly, fille de Henri le buffle (Bubalus), il reste deux filles, "Biatris et Anns" (Lignages d'Outremer, chp. XXVIII : Ci dit des contes de Rohais).
La premire, marie d'abord un frre du "roi" Guy, pouse ensuite Othon de Botenlauben, comte de Henneberg, vraisemblablement arriv avec la croisade germanique de 1197. Plus tard, elle vend aux chevaliers Teutoniques ce qui restait de sa part dans la seigneurie de Jocelin (1220), et accompagne son mari en Allemagne o, dit-on, leur pierre tombale commune se voit encore au clotre de Frauenroth qu'ils ont fond en 1231.
La seconde s'unit Guillaume de Mandle, un Normand de Calabre rcemment arriv dont elle a (peut-tre) un fils qui poursuit obscurment la ligne.
Au dbut du XIIIe sicle, quand, en Orient, le rideau tombe sur cette quatrime gnration des descendants de Josselin de Courtenay et d'Isabelle/Elisabeth de Montlhry, il semble se lever sur la deuxime Maison de Courtenay, "royale" par le mariage de Pierre, fils de Louis VI, avec la fille de Renaud. Ils engendrent une srie de Courtenay, dsormais "captiens", dont l'an, nomm Pierre, charg et recharg d'pouses hritires par Philippe Auguste, ne rsiste pas l'attrait de l'empire (latin) de Constantinople (1217). Toutefois, si toute couronne est bonne prendre, les unes ont plus d'pines que les autres et celle de Constantinople tout particulirement. Le destin imprial de Pierre avorte : repouss par les Grecs de Durazzo, il n'arrive jamais Constantinople et meurt dans les montagnes. Sa veuve, l'emprire Yolande ( 1219), son grand fils Robert ( 1228), son fils posthume Baudoin se dbattent dans une situation impossible : l'empereur latin de Constantinople, pratiquement sans domaine propre, sans pouvoir sur Venise ni sur les barons latins qui ont essaim partout et ne se soucient pas de lui, sans secours extrieurs suffisants, pris entre les Grecs et les Bulgares, entour par les Turcs, l'empereur est un fantme qui s'vanouit en 1261 quand les Grecs reconquirent la ville. L'histoire reprend son cours. Les deux Siciles, comme au temps des Normands de Guiscard mais dsormais sous les Angevins, rvent toujours de l'hgmonie en Mditerrane orientale, des Balkans Constantinople. L'ex empereur latin Baudoin s'allie Charles d'Anjou (1267). Les Anjou-Courtenay prennent pied en More (principaut d'Achae) mais rien ne marche et les Turcs concluront.
Courtenay impriaux et Courtenay d'Edesse, un sicle d'intervalle, les deux squences illustrent des aspects opposs de l'introduction des Francs dans un Orient o ils ne manquent ni d'ennemis, ni d'allis (souvent les mmes). La "rvolution des chteaux" qu'ils importent fait gagner les premiers Courtenay et perdre les seconds. L'chec des premiers est principalement exogne (dfaites militaires), celui des seconds endogne : dans le monde que les Francs de 1204 emportent avec eux et plantent dans ce qui restait de l'empire grec, il n'y a pas de place pour un souverain. C'est le paradis des barons qui tondent le vilain, s'battent, tournoyent, guerroyent et s'panouissent alors que, en "France" o la pression tait prsent plus forte, ils devraient tenir compte de l'mergence royale. Josselin aurait t comme un poisson dans l'eau : il aurait pous une princesse bulgare ou grecque, prt hommage un duc ou un autre et se serait taill une baronnie.
On se souvient que Milon de Courtenay, le frre de Jossselin, a pous en 1095, Hermangarde, la fille unique de Renaud (ii) comte de Nevers. Ils ont trois fils : deux disparaissent et le troisime est ce Renaud (Regnaud, Rainard, Rgnier) partir duquel l'histoire des Courtenay bifurque.
Renaud appartient aux grands du petit royaume (proceres regni). Il serait arrire-cousin du Roi par son aeule maternelle quatrime. Li ce qui compte dans la noblesse du temps et du lieu, il pouse la fille de Guy du Donjon, descendant des comtes de Corbeil. Elle lui donne deux filles. En 1147, ce Renaud part en croisade avec le roi. Ses frres ayant dcd, il hrite de son pre et rentre prmaturment. Et, en 1151, Renaud disparat, laissant derrire lui ses terres et ses filles. Le Roi Louis VII case la cadette en la mariant Avelon, sire de Suilly (en Donziais), et donne l'aine, Isabeau, son frre Pierre. Ce dernier prend le nom, les armes (d'or trois tourteaux de gueules) et les terres de Courtenay. Rien ne serait plus banal si Renaud tait dcd ou si, vivant et incapable de produire un fils, il avait tout abandonn sa fille charge de transmettre le nom et tout ce qui va avec. Mais il n'a fait ni l'un ni l'autre. Renaud est si bien vivant et fcond que, en Angleterre, il engendrera le lignage des Courtenay (ou Courtney, Curtney), encore prsent aujourd'hui : Charles Peregrine Courtenay, Pair d'Angleterre.
On lit en France : Pierre pousa Isabeau, hritire de Courtenay. Comme si Renaud tait mort.
On lit en Angleterre : Renaud se querella avec le Roi qui saisit ses biens et fit pouser sa fille son frre (He quarrelled with King Louis VII, who seized Renaud's French possessions and gave them along with Renaud's daughter Elizabeth to his youngest brother).
Sans ce mystre, la mutation de Renaud en "anglais" ne surprendrait pas : "France" et "Angleterre" n'ont pas encore diverg, les nobles des deux cts parlent la mme langue et s'enchevtrent. Depuis la conqute normande, beaucoup sont possessionns des deux cts du canal. Par exemple, Simon de Montfort est comte de Leicester par sa mre, et son fils cadet, pass en Angleterre, dirigera la seconde guerre des Barons contre Henry III (1264-1267).
Le cousinage est universel et les fidlits volatiles, comme l'illustre, entre autres, la perptuelle oscillation des Poitevins ou des Comtes de Boulogne, la jointure "gopolitique" des deux Royaumes en formation : Henry accueillera - et mme attirera - ceux qui sont mcontents de Louis. Et rciproquement, Louis protgera Becket et les fils rvolts d'Henry.
On ne sait rien de la dispute avec le roi qui annule Renaud. Elle sera tue ou oublie des deux cts. Sans autre appui que des indices, je suggre deux conjectures cumulables (section 1) et discute ensuite la transformation de Renaud en Reginald (section 2).
La fuite ou l'exil de Renaud pourrait s'expliquer par sa participation au complot du frre de Louis VII (a) et/ou au remariage de sa femme (b).
Les rivalits, voire guerres, entre frres perturbent la royaut, presque chaque gnration, jusqu' la fin. Robert de Dreux, frre de Louis VII, tente de mettre profit son absence (1146-1149) pour s'emparer du pouvoir. Impossible d'tre sr que Renaud participe, quoique les guerres du Puiset ne soient pas loin et que, apparent aux Montlhry-Puiset, l'autorit du roi ne l'effraie gure. Que, en 1149, il attaque et dpouille des marchands qui voyagent sous la protection du roi, est-ce brigandage ordinaire ou association aux dmarches illicites dont Robert tait le centre ou le drapeau ?... une conspiration, qui, par ses ramifications, par le rang et la naissance de son auteur, tait le plus grand danger qu'ait encore couru le trne des Captiens (Combes, 1853).
Robert a une position forte, bien mari, bien pourvu en terres et en alliances, hritier prsomptif de la Couronne, puisque son frre ain dans les ordres et le roi sans fils (il faudra attendre 1165). En dsaccord avec Louis VII propos de Damas, il quitte la croisade prmaturment en mme temps que Renaud (fin 1148 ou dbut 1149) : les perturbateurs du repos public sont de retour, crit au Roi le Rgent, le vieux Suger, abb de St Denis, qui a difficilement surmont les rvoltes de 1147/48 et dont la position reste problmatique. Maints seigneurs s'irritent contre les empitements royaux ; maints vques, abbs ou chanoines, s'irritent des rformes ecclsiastiques de Suger ; grands et petits s'irritent du ranonnement du peuple pour (ou sous prtexte de) financer la croisade. En outre, les "royaux" contestent le droit de Suger gouverner : Robert et les deux autres frres du Roi (Philippe, du chapitre de Ste Corneille Compigne, et Henri, vque de Beauvais), soutenus par la Reine-mre, Adle de Savoie, veuve remarie Mathieu Ier de Montmorency, ennemi de l'abbaye de St Denis ; jusqu' Louis VII qui craint que son Rgent n'abuse du pouvoir et ne se prenne pour le roi.
Dans cette crise, les mcontents poussent Robert en avant. Au sicle suivant, une lgende naitra en Bretagne (dont son petit-fils sera devenu comte) et courra partout : Robert aurait t le frre an de Louis, indument cart de la Couronne, sous prtexte de btise. Quelques historiens la reprendront (cf. Duchne, 1631).
An ou non, Robert escompte l'appui de Thibaut le grand, le puissant comte de Champagne, frre d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre, et comptiteur historique du roi dont il a encore rcemment souffert : Louis, en 1142/1143, a envahi la Champagne et, entre autres destructions, pris, pill et incendi Vitry o des centaines d'habitants, rfugis dans l'glise, ont brl avec elle. Mais, par jalousie, prudence, ou pression de son fils Henri, loyal au roi, Thibaut se range du ct de Suger, avec Thierry, le comte de Flandres. Le comte de Vermandois reste ambigu, comme le Chancelier Cahors.
Suger fait face avec dtermination. Soutenu par les autorits de l'Eglise, Bernard de Clairvaux et le Pape (Eugne III), l'abb de St Denis convoque un "parlement", une assemble des Grands, Soissons pour le 8 mai 1149. Preuve de sa fragilit, il ne parvient pas la runir. L'incertitude des rapports de force la repoussent de trois mois, au 4 aot.
Robert a propos de trancher le dbat l'ancienne, par un duel avec son principal opposant, Henri de Champagne, fils du comte, afin de prouver par sa victoire que Dieu soutient sa cause. La mthode "parlementaire" de Suger triomphe. Robert, aveugl par sa haine contre Henri, manque d'habilet ; l'art oratoire de Suger et ses menaces d'excommunication submergent les hsitants que la proclamation raffirme de la loyaut des armes de Flandres et Champagne impressionne. Les Grands, mis en demeure de dfier publiquement le Roi, de surcrot protg par sa prise de croix, renclent sauter ce double pas. S'opposer, combattre, marchander, se passe dans le jeu. On condamne (ventuellement, on excute) les "mauvais conseillers" du Roi, on ne touche pas au Roi. Dsavouer le Roi, c'est renverser le jeu.
Robert choue dissocier Suger du roi pour prendre la rgence sa place. Plus subtil, il aurait pu russir et, au retour d'un Louis dmoralis par son chec en Palestine et ses dboires conjugaux, "satisfaire" son vÏu notoire de rejoindre un couvent. Le roi abdiquant, il "recueillait" la couronne.
Suger triomphant, Robert reconnat qu'il a perdu et demande pardon. La Vie de Suger crite par son admirateur contemporain, Guillaume, donne de l'affaire une version, la fois anecdotique et glorieuse : Avant que le roi ft de retour, son frre (Robert) revint de Jrusalem. Quelques hommes du peuple, qui toujours est facile se laisser entraner vers les nouveauts, se mirent courir sur le passage de ce prince et lui souhaiter une longue vie et le pouvoir suprme; il y en eut mme parmi le clerg, qui, mcontens que certaines choses se fissent dans le royaume autrement qu'ils ne voulaient, cherchrent sduire Robert par de perfides adulations, lui inspirer une confiance aveugle dans son sang royal, et le pousser quelques dmarches illicites... Mais comme un lion qui sent sa force, le juste Suger, instruit des projets prsomptueux de Robert, et voulant empcher qu'il ne le troublt dans l'exercice du pouvoir qui lui tait confi... s'entendit avec les fidles du royaume, et ne cessa de s'opposer aux efforts du frre du roi, que lorsqu'il eut par sa prudence rprim l'audace de Robert (Vie de Suger, L III, Ed. Guizot 1825, p 187/188). Cette source et les autres (lettres de et Suger etc.) sont reprises dans L'art de vrifier les dates (continu par Saint-Allais, Tome 3, 1818, 2, 160) : La malheureuse expdition de Damas le [Robert] brouilla avec le Roi... Il fut des premiers, aprs la leve du sige, reprendre la route de France. Son arrive dans ce royaume y jeta le trouble par les tentatives qu'il fit, de concert avec plusieurs mcontents pour enlever la rgence du royaume Suger. Sa partie tait si bien faite, qu'il se vit sur le point de russir...
Robert et les siens ont encore une chance : leur position se rtablirait si le Roi, absent depuis deux ans, ne rentrait pas ou, rentr, dsavouait Suger. C'est presque le cas : parti en juin (1149) de Palestine, Louis VII, intercept par des "pirates" byzantins, leur chappe grce ' des navires siciliens qui passaient par l. Ensuite, rencontrant une violente tempte, un miracle le prserve du naufrage.
Arriv en aot en Sicile, une foule de barons et prlats accourent sa rencontre pour renouveler contre Suger des accusations qui le troublent (animum turbaverunt), malgr les protestations du pape Eugne. Les hsitations de Louis lui font prolonger plusieurs mois son sjour en "Italie". Lorsque, en novembre, Louis rejoint enfin son royaume, il doute tellement de Suger qu'il le convoque une entrevue pralable Cluny : Ayant reu, en effet, sur l'tat de notre royaume, une foule de bruits diffrents, et ne sachant pas ce qu'il y a de certain cet gard, nous voulons apprendre de vous-mme comment nous devons agir envers chacun, et contre qui nous devons nous tenir en garde. Peut-tre pense-t-il s'emparer du Rgent puisqu'il le fait venir secrtement et seul, ce qui le met sa discrtion.
Mais, par affection ? crdulit ? respect ? persuasion ? religion ?, Louis se laisse convaincre par Suger de son innocence et de son dvouement. Il le complimente publiquement et, la Cicron, le qualifie de pre de la patrie.
Robert, battu, peut encore esprer attraper la couronne : pendant quinze ans le Roi engendrera fille aprs fille. Ce n'est qu'aprs un troisime mariage, maints plerinages et une "intervention divine" que natra enfin Philippe dieudonn (1165), plus tard auguste.
Revenons notre Renaud. Si, comme il est vraisemblable, il a fait partie du groupe de Robert, Suger ou le comte de Champagne, ne pouvant pas se venger de l'intouchable frre et hritier du Roi, aura puni ses amis et, en particulier, donn l'hritire et les biens de Renaud au dernier frre du Roi, ce Pierre qui n'a rien et qui, par sagesse, btise ou insignifiance, n'a pas suivi Robert.
Une autre possibilit : aprs l'chec de Robert, Renaud, compromis, menac peut-tre, abandonne tout, s'enfuit et passe au Plantagent dans les bagages d'Eleanor.
Renaud et Louis se sont dj heurts lorsque tout ce monde tait en Palestine et que la conduite de la reine Antioche faisait dbat (Aurell, 2005). Raymond de Poitiers, son trop bel oncle, voulait orienter la croisade vers la reprise d'Edesse dont, nous le savons, le comte titulaire (Josselin II de Courtenay) tait le cousin germain de Renaud. Tout poussait ce dernier se joindre Raymond, Josselin, Alinor, ses vassaux et autres barons, pour combattre le lobby jrusalmite et l'obstination de Louis qui le conduiront devant Damas (une erreur et un chec). Ces tensions ont pu provoquer ou prcipiter son retour.
La question de la Reine est lourde d'implications, prsentes (Raymond ou Louis ?), imminentes (Edesse ou Damas ?), prochaines (donnera-t-elle un fils au Roi ?) et futures (Plantagent). Peut-tre, dj, Renaud opte-t-il pour elle. Peu d'annes plus tard, toute ambigut se dissipe : aprs le "dmariage" d'Elonore (1152), Renaud s'entremet dans son union avec Henri Plantagent, bientt Roi d'Angleterre, qu'elle pouse trs vite.
Sans reprendre ce que narrent tous les livres d'histoire, rappelons que Louis prend trs mal l'affaire. D'une part, aprs beaucoup d'hsitations, en tant que suzerain, il a nagure reconnu au Plantagent la Normandie que son pre (Geoffroy d'Anjou) avait arrach au roi d'Angleterre (Etienne de Blois). Henri prte foi et hommage puis se ddit. D'autre part, aprs le remariage d'Eleanor (mai 1152), les deux poux rgnent sur la Normandie, l'Aquitaine, la Bretagne, le Poitou, le Maine, le Berry, l'Auvergne etc. et prtendent au comt de Toulouse. En outre, ce mariage de l'ex-femme du roi moine avec le jeune et ptulant angevin apparat comme une insulte personnelle et un dni fodal puisqu'ils bafouent leur suzerain au lieu de lui demander son aveu.
Le courroux du roi se traduit en actes. Ds le mois suivant, le Roi attaque la Normandie. Soutenu par son fidle Henri de Champagne, il s'allie aux ennemis d'Henry : son frre Geoffroy qui veut l'Anjou, et son cousin Etienne de Blois qui dfend sa couronne d'Angleterre. La multiplicit des enjeux provoque celle des champs de bataille : Angleterre, Anjou, Aquitaine, Normandie... Aprs maintes pripties, la mort du fils d'Etienne (1153) fait de Henry son successeur et lui donne la couronne en 1154. En 1156, il prte nouveau hommage au roi de France pour la Normandie, au nom de son fils toutefois.
En quatre ans, Henry a gagn sur tous les tableaux. Et, plus encore, puisque, lui, il a dj eu d'Alienor deux fils dont un vivant alors qu'elle n'a laiss que des filles Louis !
Cause ou consquence de la brouille avec son roi, il est dit que Renaud a contribu efficacement au rapide remariage d'Alinor avec Henry (having been very instrumental in effecting the match). Qu'il ait t partisan de la reine depuis Antioche ou qu'il le soit devenu aprs son retour, il a tremp dans la prparation de ce coup d'clat. En effet, celui-ci n'a pas pu se concevoir, se dcider et s'excuter en huit semaines, mme si l'acclrent les tentatives de capture auxquelles Alinor chappe de justesse lorsque, de Paris, elle rentre en Aquitaine : la chasse l'hritire tait ouverte.
Alinor, anticipant ou souhaitant son "divorce", se serait mise d'accord avec Henry ds l't 1151, quand il vient Paris avec son pre prter hommage pour la Normandie. Renaud a pu jouer un rle ce moment ou dans les mois suivants. Une fois le mariage clbr et la guerre commence, il ne lui restait qu' dfendre Alinor en combattant pour Henry. Comme nous le verrons, le roi d'Angleterre rcompense Reginald en lui accordant Sutton (Berkshire), puis en lui donnant l'occasion de devenir baron d'Okehampton, "patron" de l'abbaye de Forde, gouverneur du chteau d'Exeter et sheriff du Devon. Ses descendants, devenus comtes hrditaires de Devon, comptent dans les soixante familles qui constituent la ruling elite de l'Angleterre (Davies, 2009) et sont actifs dans son histoire, notamment pendant la "guerre des deux roses" o leur adhsion Lancastre leur vaut dcapitations et forfaitures. Ils se relvent avec la victoire Tudor. Henry Courtney, d'abord couvert de bienfaits par Henry VIII, est ultrieurement, dcapit tandis que son fils Edward reste enferm la Tour. Ce dernier, libr quinze ans plus tard par l'avnement de la reine Mary et rtabli comte du Devon, a failli en tre pous...
En France, sans procs ni guerre locale, sans confiscation ni reprise, les domaines de Renaud sont saisis ou au moins retenus par le Roi. Renaud, de son vivant, se dpouillerait-il volontairement au profit d'une fille trop jeune pour ne pas tomber en tutelle ? Non, il s'enfuit ou est chass. Le Roi prend la fille en garde, l'lve la cour, puis la donne, elle et ses biens, son frre cadet comme s'ils taient sans matre. Ce marcottage radique les vrais Courtenay et greffe la ligne sur une nouvelle souche.
Pierre le coucou devient "sire de Courtenay" et en prend les armes pour ce qu'elle (la fille) lui fut accorde celle charge (du Tillet), comme si le roi voulait effacer Renaud. Ces Courtenay rinitialiss forment une seconde Maison qui rpudiera la premire.
Plus tard, on dira que Pierre, tel Esa, a chang cupidement ses (faibles) droits la royaut contre un (copieux) plat de lentilles. Dans son temps, le changement de nom ne choque pas. La substitution se pratique couramment en l'absence d'hritier et, dans une alliance asymtrique, l'instar d'une adoption, le petit s'honore de prendre le nom du grand. Or Courtenay vaut beaucoup plus que ce petit Pierre, tellement insignifiant que, seul de toute sa fratrie, il ne porte pas de nom royal. Ses frres s'appellent Philippe (comme le pre du Gros), Louis (le Hlodowig emblmatique), Henri (comme le grand-pre du Gros), Robert (comme l'arrire grand-pre et le fondateur de la dynastie), Hugues (comme le premier Capet), et encore un Philippe. Lui, c'est Pierre, un nom qui, jamais en France, n'a t ni ne sera royal. Pierre, comme si la liste tait puise et la rserve d'hritiers suffisante. A ce moment, chez les puissants, les noms importent (Werner) et programment des destins. Dans le code royal, Pierre signifie " zro".
Jusqu' son mariage, on le nglige : ni son pre, ni son frre Roi, ne lui donnent la moindre charge ou la moindre terre. Cette inconsistance, jointe son nom apostolique (Pierre fait sens dans le code piscopal), le voue l'Eglise o plusieurs de ses frres sont dj cass. Il sera repch de justesse et par hasard.
Au contraire, Robert, hritier prsomptif, est lanc tt dans les eaux "anglo-franaises". Aprs un mariage avec la comtesse de Montfort, il est uni la Dame de Braine, de la maison des comtes de Salisbury. Il adopte les armes de Braine (chiquet d'or et d'azur la bordure de gueules). Puis, ds 1135, il trouve un nom (surnom) quand le Roi lui attribue en fief hrditaire le comt de Dreux qu'il transmet trois sicles de descendants jusqu' la fille finale (Jeanne 1346). Une branche cadette engendrera une dynastie de Comtes puis Ducs de Bretagne en ligne directe jusqu'en 1341.
Aprs 1150, Robert, devenu loyal et/ou prudent, jouera un rle de premier plan dans les guerres royales tandis que notre Pierre restera "junior", sans rien en propre.
Tandis que la continuit patrilinaire se poursuit du ct anglais o demeurent les vrais Courtenay descendus d'Athon directement par mles, Pierre cre une nouvelle Maison, Courtenay par fille et captienne par mle. Du Bouchet, l'historiographe des Courtenay au XVIIe, la fera commencer Louis VI et renverra les anciens Courtenay en marge, au paragraphe traitant de l'pouse de Pierre : les Courtenay royaux n'admettent pas d'autre anctre que Louis VI le gros.
Notons et soulignons que ces Maisons s'ignoreront, du dbut jusqu' la fin. Quoique les tiers les connaissent toutes deux, ils ne les rapprochent pas. Dbut XVIIe, le roi d'Angleterre s'tonnera devant les Courtenay rsiduels franais venus chercher refuge : nous avons ici des gens de votre nom. Pour expliquer cette troublante gmellit, on fera sortir les Courtenay anglais d'un fils d'Athon qui aurait conquis l'Angleterre avec Guillaume le Btard. C'est la version qu'adoptera sans grande conviction du Bouchet : Athon... fut pre de Josselin I du nom, Sr de Courtenay, & comme je crois, d'un autre fils qui suivit Guillaume la conqute d'Angleterre & qui donna origine la Maison qui a port le nom & les Armes de Courtenay au mme Royaume & qui subsiste encore (p. 7).
Cette indiffrence rciproque surprend en un temps d'alliances multiples, de cousinage intense et de va-et-vient continuels. Elle traduit une rupture, dfinitive quoique implicite, dont la mmoire survit au souvenir. En France, Renaud le "bad boy" n'existe pas. Aprs son retour de croisade, il s'vanouit.
Les Courtenay d'ici s'obscurcissant peu peu tandis que les autres, de longue main plants en grandeur (du Tillet), brillent dans l'histoire d'Angleterre. Ironique revanche, seuls les vrais, les anglais, restent connus, y compris de l'Histoire de France o ils font des passages remarqus : le cartel que, en 1386, Richard II d'Angleterre pousse son Courtenay lancer Guy de la Trmoille, chambellan du duc de Bourgogne, a t clbr par Froissart, ainsi que la joute subsquente avec le sire de Clary. Aprs le trait de Troyes, l'admiral de Henry VI d'Angleterre, Edward Courtenay devient "amiral de France" (1439), titre auquel il figure au tome 7 du Pre Anselme (Grands officiers de la Couronne), sa notice tant suivie d'une gnalogie des Courtenay d'Angleterre, supposs issus d'un compagnon de Guillaume le Conqurant.
C'est cette hypothse que nous devons examiner prsent car, en antidatant la sparation des deux Maisons, elle ferait du mariage de Pierre et d'Isabeau un incident sans importance.
Dans l'Angleterre angevine, un pays trs ouvert, passablement agit et king-centred, les contemporains de Reginald le connaissent comme puissant baron du Devon venu de France. Il n'y a pas d'autre Courtenai que celui du Gtinais. Ces Courtney en sont sortis, mais quand ? et comment ? L'hypothse normande (XIe sicle) des gnalogistes franais demande examen, mais la tradition anglaise est trop bien tablie pour ne pas l'adopter.
Si tant de nobles dj fieffs ont pris part l'expdition de Guillaume le btard (1066) pour agrandir leur patrimoine, a fortiori les cadets sans avenir qui les dbouchs des croisades n'taient pas encore ouverts (la 1re est en 1099). Souvent voque, la connexion carolingienne ou pr-carolingienne entre les comtes de Sens et de Boulogne permettrait d'imaginer que, aprs la mort de Renaud le mauvais (1055) et la perte de Sens, un quelconque parent d'un castellier de Courtenay ait joint les Boulonnais qui, avec les Flamands et autres aventuriers, accompagnent Guillaume ; que ce Courtenay ait fait souche en Angleterre, sans cependant avoir t assez grand ou assez valeureux pour tre remarqu ; qu'un de ses descendants, Reginald, la suite d'exploits inconnus, soit rcompens par Henry II ; et qu'ainsi un petit guerrier merge, en devenant baron. Cela est possible. Tout est possible.
Le Domesday Book
ne le mentionne pas mais notre ventuel Courtenay, non enfieff comme tenant in chief, peut avoir t under-tenant, ou l'homme d'un under-tenant.
Comment savoir si un Courtenay tait avec le Conqurant ? Les listes des compagnons de Guillaume qui circulent ne nous aident pas. En tout tat de cause, elles ne contiennent que les grands noms dont, par hypothse, notre ventuel Courtenay n'est pas. Au moment de la vogue des gnalogies (XVIe/XVIIe) l'ide s'est rpandue que, la fin du XIe, quand l'Abbaye de la Bataille (Battle Abbey) est entre en fonction (expiatrice et commmorative), elle disposait d'une liste nominative (exhaustive ?). Nul ne l'a vue et elle ne figure pas dans les archives subsistantes. Il en existe des "copies" non authentifies qui diffrent dans le nombre et l'identit des conqurants, ainsi que dans la manire de les crire et de les ordonner. Elles ne concident que partiellement avec le Domesday Book. Quelques unes de ces listes mentionnent un Courtenay (Curtenay, Courtenay, R. de Courtenay). Qu'est-ce que cela prouve ? Dans sa discussion du Battle-Abbey Roll (1889), la duchesse de Cleveland s'exclame : M. de Magny reproduces this list in his Nobiliaire de Normandie with the addition of fifty names [...]. He, too, eschews references ; and I am curious to know upon what authority he has included Courtenay.
Sont-ce des copies fautives d'un original disparu (et suppos exact), ou bien des reconstitutions ou des inventions ? En 1655, Thomas Fuller (Church History of Britain, Bk II, 7) se moquait : Battle-Abbey Roll is the best extant catalogue of Norman gentry, if a true copy thereof could be procured. Il en souligne la fantaisie, some names therein being augmented, subtracted, extended, contracted, lengthened, curtailed.
La Liste est, pour les nobles anglais, l'quivalent du rle du Mayflower pour l'aristocratie WASP ! En particulier, les "copies" ont servi blanchir des trangers, Gascons, Poitevins, Flamands, Savoyards que chaque roi ou reine apportait avec lui du continent.
Les critiques mettent en cause ce vague opinion floating in society, qu'il existe une liste originale que pourtant aucun chroniqueur n'a jamais mentionn et dont les "copies" ne sont corrobores par rien : aucune preuve n'existe qu'une telle liste ait t dresse, et si elle l'a t, elle n'est pas arrive jusqu' nous, ni en original, ni en copie... Holinshead en 1577 est le premier qui donne une liste le titre de Roll of Battle Abbey... Stowe, peu d'annes aprs, publia une autre liste, diffrente de celle d'Holinshead... Ensuite vint Duchesne. Il reut de Camden une copie de la liste de Stowe et la publia... Il y a dedans des noms de famille que nous savons s'tre tablies en Angleterre longtemps aprs la conqute. Des personnes sont omises dont nous savons qu'elles taient dans l'expdition (Hunter, 1853, ma traduction).
Admettre sans preuve, qu'il y ait eu au XIe de premiers Courtenay, laisserait intacte notre question car comment et pourquoi un Reginald issu de ces premiers aurait-il inspir la tradition qui le fait arriver avec Henry au XIIe ? Il aurait suffi sa gloire qu'il ft venu avec le Conqurant.
Toutefois Vincent (1999), parlant de Renaud/Reginald qui adduxerat ei reginam Alyanor, qualifie cette origine de family myth, de mythical account, et affirme catgoriquement : There is absolutely nothing, save wishful thinking, to support such a suggestion. Le Reginald, tige des Courtenay anglais, serait, non pas le pre d'Isabeau, mais un vague cousin des franais. The Courtenays to whom Henry lI awarded lands in England, although related to the original Courtenay line, appear to have been only distant cousins. A preuve, dit-il, le ralliement du fils de Reginald, Robert Courtenay baron d'Okehampton, Louis
(futur VIII), lorsque, appel par les barons rvolts contre Jean sans terre, il est proclam roi d'Angleterre et s'empare temporairement du pays. Ensuite Robert le trahit et est priv de toutes les terres (omnes
terras
Roberti de Corteneiaco) reues et recevoir de Louis auquel il s'oppose prsent (qui contra nos est). S'il reoit ce harsh
treatment,
c'est perhaps because of his kinship to one of the leading families of France.
Quelle
plaisanterie !
Robert, comme la plupart des barons anglais, aura soutenu les Franais pour se dbarrasser du roi Jean. La mort de celui-ci (1216) change la donne et, jointe aux exactions, usurpations et pillages des Franais, provoque nombre de dfections. Cela ne prcise en rien l'identit de Reginald.
Les Franais n'ont jamais dit que Renaud passe en Angleterre. Cela conforte la version anglaise traditionnelle : Renaud a t annul et spoli ; annul parce que spoli ; spoli parce qu'annul. Cette turpitude royale impose le silence. Renaud ne disparat pas, il disparat au regard franais que Vincent emprunte. Il nous dit d'abord que Renaud est mort la croisade (Renaud or Reginald, simply disappears at the time of the Second Crusade, in all probability deceased), puis rencontrant la plainte contre lui pour brigandage (Suger) qui prouve son retour : either that he had returned before the king from crusade, or that he had never fulfilled his crusading vows.
Essayons d'abord de prciser la chronologie. Il semble que Reginald arrive en Angleterre quand Henry devient roi (1154), et meure en 1194. Ca lui laisse le temps d'avoir une belle carrire anglaise. On ne sait pas quand il est n mais la croisade laquelle il participe commence en 1147. En admettant qu'il ait alors une vingtaine d'annes, n au milieu des annes 1120, il meurt autour de 70 ans, un ge avanc mais admissible. En gros, il est de la mme gnration que les fils de Louis VI (ns entre 1120 et 1132).
On ne peut ni dater ni localiser la premire apparition du thme que Camden nonce en 1607 (Britanniae descriptio) : Reginald est le premier Courtenay anglais, venu avec Henry qui l'a rcompens pour avoir contribu son mariage avec Eleanor. Reginald est de la premire maison de Courtenay. Il ne manque qu'un nom (Renaud) pour arriver l'identit. Camden, renforant du Tillet, nous dbarrasse du lointain cousin alatoire, hypothse peu plausible : on imagine mal ce qui aurait pouss un tel cousin se rallier Henry et Henry le gratifier Si encore le quidam avait t normand, angevin, ou au moins des bords de Loire. Mais Courtenay, la jointure de l'ile de France et de la Bourgogne... Le hasard, l'accident, peut expliquer un dpart, pas une reconnaissance ritre en Angleterre. Si Eleanor est le premier lien entre Reginald et Henry, lors des affrontements des poux, Reginald reste l'cart ou soutient le roi. Il ne suit pas la reine lorsqu'elle quitte l'Angleterre, n'est pas entran dans sa punition, ni ne profite de sa rdemption avec l'avnement de Richard.
Mon argument, aussi imparfait soit-il, c'est la tradition, constante et unanime : It has been generally received as a fact... Renaud et Reginald sont faiblement documents, leur relation nullement. Rien ne dmontre ni la diffrence, ni l'identit. Toutefois, cette dernire a deux lments pour elle. D'une part, la concidence des noms et des temps. D'autre part, le cui prodest ? : Reginald et ses descendants n'ont aucun avantage attendre de cette origine franaise. Au cours des innombrables guerres sur le continent, aucun Courtney ne revendique son hritage Courtenay : ils ne se soucient pas plus de leurs cousins franais que ceux-ci d'eux. Avoir (ou supposer) cette ascendance franaise ne rapporte rien, jamais, aucun Courtney.
Les traditions mythiques ont gnralement un arrire-plan (sinon une finalit) politique ou au moins symbolique, mme les plus farfelues (comme l'origine troyenne des Francs). Avec les Courtney, nous nous trouvons devant une tradition presque brute, non construite, non finalise, non utilise. Cette innocence emporte ma conviction.
Toutes les gnalogies des Courtenay auxquelles nous avons pu nous rfrer indiquent que Reginald de Courtenay vint en Angleterre et obtint des concessions de terres dans le rgne de Henry II, et que, en pousant Hawisia de Aincourt, fille de Lord of Aincourt et Matilda de Averinches, il devint seigneur de Okehampton... Il a gnralement t reu comme un fait que Reginald de Courtenay accompagna la reine Eleanor en Angleterre en 1151, juste dix ans avant qu'il obtienne de Henry II le manoir de Sutton, et qu'il fut le premier membre de la famille install dans ce pays (Dallas & Porter, in Notes & Querries, 1895, S. 8, vol. 7, pp. 441-3 et 503-5, ma traduction).
Le roi d'Angleterre rcompense d'abord Reginald en lui accordant le manoir de Sutton (Berkshire) en 1161. Au moment de la grande rvolte, en 1173, il s'assure de sa fidlit en lui donnant la garde des filles d'une hritire du Devon. Reginald en profite pour pouser l'ane par laquelle il devient baron de Okehampton, "patron" de l'abbaye de Forde, gouverneur du chteau d'Exeter et sheriff du Devon. Il n'est alors que baron fodal, comme on dira plus tard pour exalter le baron par writ reconnu comme tel par le roi et convoqu par son nom au Parlement. Okehampton est la fois une terre et un "portefeuille" de droits sur une grande part du Devon. L'honour de Okehampton est aussi riche qu'un comt, dira-t-on.
Je n'essaierai pas de donner la descendance de Reginald car les premires tapes ne sont pas claires et nous importent peu. Nous survolerons les Courtney comtes de Devon jusqu' leur extinction (section 1) et examinerons leur curieuse rsurrection 250 ans plus tard (section 2).
Comme j'en reste aux grandes lignes, je n'ai pas de scrupules suivre le trop dvou Cleaveland, 1735. Gibbon juge que The rector of Honiton has more gratitude than industry, and more industry than criticism, tout en l'utilisant largement, comme le feront les auteurs ultrieurs de Peerages. Cleaveland, le du Bouchet des Courtenay anglais, vise la clbration des hauts faits et de la valeur de la famille travers le temps ; sa tche est plus simple que celle du franais car il n'a pas surmonter la confusion de la gnalogie. Et, comme tous ces Courtney ont agi et brill, il ne manque pas de matire.
Les barons de Okehampton, comtes de Devon, disparaissent dans les dfaites de Lancastre sur les champs de bataille de la "guerre des deux roses" (a). La branche cadette, capitalisant le dvouement familial, en reoit les dividendes aprs la victoire Tudor (b).
Robert (1183-1242), baron d'Okehampton, que le roi Jean a nomm gouverneur du chteau d'Oxford et sheriff de l'Oxfordshire, pouse Mary, fille et hritire du puissant William de Redvers et de Vernon, 5me comte de Devon. Son descendant, Hugh Courtney (1275-1340), le premier baron par writ de Okehampton, revendiquera l'hritage de sa cousine, la dernire Redvers, Isabel ( 1293) qui avait succd son frre Baldwin : il deviendra comte de Devon (de facto en 1293, de jure par patente royale du 22/03/1335).
Sans entrer dans les dtails, le grand homme de cette premire priode est Hugh (1303-1377), second comte de ce nom. En 1325, il pouse Margaret Bohun arrire-petite-fille du roi Edward I. Les Courtney mlent leur sang celui des Plantagent. Hugh sera l'anctre commun aux branches collatrales qui, successivement, rallumeront le flambeau, les Courtney d'Haccomb en 1485 et les Courtney de Powderham...en 1831 (cf. infra). Parmi sa nombreuse progniture, mentionnons les plus clbres :
Hugh, l'hritier, tant prdcd, comme le fils suivant, Edward, c'est l'an de ce dernier, Edward (1357-1419), qui devient comte de Devon.
Le roi ayant repris en main la garde du chteau d'Exeter et la nomination du sheriff du Devon, ces offices n'choient plus aux Courtney qu'pisodiquement, mais la dignit comtale et les profits (third penny etc) et honneurs associs, passent de pre en fils jusqu' la "guerre des deux roses".
Chargs de lever l'arme du Devon et de la diriger quand un dbarquement franais menace, ces Courtney sont aux cts du roi dans ses guerres cossaises et franaises, souvent amiraux ou chefs de flotte. Dj le premier comte jouissait de la quatrime ou cinquime place dans l'ordre de prsance des Lords au Parlement et, plus tard, le cinquime comte, Thomas, se sentira assez grand pour disputer la premire place Arundel, pourtant le plus ancien comte d'Angleterre (Cleaveland, p. 213). Les Courtney sont trop hauts, trop guerriers et trop impliqus dans les alliances/rivalits entre grands nobles, pour ne pas se prcipiter dans la "guerre des deux roses". Dans cette auto-extermination de la noblesse qui mle vendettas personnelles, fidlits et opportunisme, nos comtes sont du ct Lancastre. Cela anantira la branche ane et, avec la victoire Tudor, fera la fortune de la branche cadette.
Thomas, comte de Devon, est avec Somerset inculp de trahison par le duc d'York (1453). Disgraci quand le duc devient protector du royaume (1455), il meurt, soit empoisonn, soit dans une bataille.
Son fils Thomas (1432-1462) partage les hauts et les bas du roi et de la reine. Le fils du duc d'York devenu roi (Edward IV, 1461), il est accus de trahison (attainted), dgrad (forfeited) et dcapit. Son frre Henry semble avoir eu le mme sort (1466). Le dernier frre John, restaur dans ses honneurs en 1470 quand Henry VI retrouve temporairement la couronne, est ensuite tu la bataille de Tewksbury (1471, victoire d'York) et derechef dgrad. C'est la fin des Courtney d'Okehampton. Leurs possessions et leurs honneurs sont distribus aux partisans d'York. Il faudra attendre l'act of resumption de Henry VII (1485) pour annuler ces condamnations et transfrer biens et dignits Edward Courtney de la branche cadette (Haccomb/Boconock).
Ceux-ci sont issus du grand Hugh.
Edward, l'arrire petit-cousin des derniers Okehampton, trs actif aux cts du comte de Richmond (futur Henry VII), adhre la conspiration de Buckingham contre Richard III et, aprs son chec (1483), lui, son frre Walter, le cousin Peter, vque d'Exeter et d'autres western gentlemen, rejoignent le Tudor en Bretagne. Ils sont tous outlawed et attainted. Plus tard, ensemble ils dbarquent dans l'ouest : They landed the 6th of August, and a great many Noblemen with their Retinues immediately resorted to them. A la bataille de Bosworth, Richard est battu et tu. Richmond roi (1485), il restaure aussitt Edward dans les honneurs et biens des Courtney comtes de Devon (patentes 26 Oct., 1485).
Devenus royaux par des voies dtournes, les Tudor resteront craintifs et vindicatifs l'gard de tous les descendants Plantagenet (anyone with Plantagenet blood lived under a death sentence, Seward, 2010). Pour se donner quelque lgitimit, Henry VII pouse aussitt la fille ane du roi "yorkiste" Edward IV.
Dix ans aprs (1495), William, le fils et hritier d'Edward Courtney, pouse son tour une fille d'Edward IV, apportant une nouvelle dose de sang royal dans le pedigree Courtney. Peut-tre, la goutte de trop ! William, suspect d'tre devenu yorkiste par son mariage et compromis par Suffolk (Edmund de la Pole) dans sa rbellion, est emprisonn (1506) et dgrad pour l'empcher d'hriter de son pre Edward ( 1509).
Heureusement pour lui, le roi meurt et Henry VIII, prenant le contre-pied de son pre, libre son "oncle" William et l'honore en lui donnant porter la troisime pe lors de son couronnement. Derechef, le Courtney est restaur dans ses biens et dignits (10 mai 1511), ce dont il ne jouit gure, mourant quelques jours plus tard (9 juin).
Son fils Henry lui succde. Dans une premire phase, il fait partie des joyeux compagnons du roi dont il reoit gratifications, honneurs et titres (marquis d'Exeter en 1525 etc.). Mais, quand le schisme arrive, Henry est de cette conservative aristocracy qui s'oppose au chancelier Wolsey, soutient la true queen (Catherine d'Aragon) contre le Boleyn party et rejette Anne, au couronnement de laquelle il a l'audace de s'absenter (1533). Revenu en faveur pendant la parenthse Seymour, il est emport par la crise qu'ouvrent en 1536 la condamnation du roi par Pole (Pro Ecclesiae Unitatis Defensione) et le soulvement du Yorkshire (Pilgrimage of Grace), et qu'aggrave encore la mort de Jane Seymour (oct. 1537). En butte la suspicion de Cromwell et du roi, compromis par le catholicisme affich de sa femme Gertrude, il est liquid avec les autres amis et parents de Pole (western conspiracy): la House of Lords le dclare coupable de trahison (3 Dec. 1538). Il est dcapit (9 jan 1539) et dgrad. Encore un !
Son jeune fils, Edward, born to be a prisoner, reste la Tour pendant quinze ans, spcifiquement exclu du general pardon de l'avnement d'Edward VI. En 1553, la nouvelle reine, Mary, rappelle le cardinal Pole et vient la Tour librer "ses prisonniers" (3 aot). Edward, aussitt (re)cr comte de Devon (3 Sep. 1553), rate de peu la main de la reine. Le bel Edward, the last spring of the White Rose of Plantagenet, magnifi par sa longue captivit, est le candidat naturel du chancelier Gardiner, du conseil priv de la reine, et des Commons. Et aussi des ambassadeurs franais et vnitien qui cherchent empcher le mariage espagnol. De plus la mre d'Edward, catholique et fidle jusqu'au bout Catherine d'Aragon, mre de Mary, est l'amie intime de la reine qui se souvient de la dcapitation du marquis d'Exeter pour conspiration avec Pole. Edward a tout pour lui, mais Charles Quint gagne et Philippe d'Espagne pouse la reine.
La version romanesque : la reine voulait Edward, il prfrait sa demi-sÏur, Elizabeth (la future Virgin Queen). D'o jalousie, colre et disgrce. Voyez, par exemple, le roman pistolaire de Lenoble (1697, Mylord Courtenay ou histoire secrte des premires amours d'Elisabeth d'Angleterre).
La version politique: le mariage d'Edward et Mary, quasi dcid l't 1553, est dfait par les manÏuvres de l'empereur, aid par le dvergondage public et l'absence de sens politique d'Edward que dplorent les contemporains ( commencer par l'ambassadeur de France, qui le soutient vivement). L'ide d'un mariage entre Edward et d'Elizabeth n'a rien d'une romance, c'est le projet de ceux qui dsirent ou projettent une autre option que Mary. Apeur, hsitant, insouciant, Edward ne tente pas sa chance. Sa chute est aussi rapide que l'avait t son retour aux honneurs : l'chec du soulvement contre le mariage espagnol (insurrection de Wyat) la suite de la remontrance du Parlement du 16 Nov. 1553, le renvoie la Tour en fvrier 1554 avec le duc de Suffolk (aussitt dcapit ainsi que la malheureuse Jane Grey)... et Elizabeth.
Aprs le mariage de la reine (juillet 1554), Edward, libr (printemps 1555), est mis sous surveillance espagnole Bruxelles. Il s'enfuit Venise et meurt Padoue en octobre 1556, peut-tre empoisonn. Avec lui s'teignent les Courtney. Ses biens et domaines sont partags entre les descendants des sÏurs de son arrire grand-pre Edward. Le titre de comte de Devon tant teint, il sera vendu par James I, d'abord Blount, Baron Mountjoy, ensuite (1618) Cavendish dont les descendants, promus Dukes of Devon(shire) en 1694, le sont encore aujourd'hui.
L'extinction des Courtney (avant leur rsurrection) nous invite un parallle avec les Courtenay royaux. Ceux-ci dcollent ds la seconde gnration (Philippe Auguste) et atteignent tout de suite les hautes sphres. Mais ils ne se "soutiennent" pas. Si Pierre deux du nom avait eu des fils de son premier mariage ou vit le pige imprial du second, peut-tre lui et ses descendants auraient connu une belle carrire de comte franais ou de marquis germanique. La branche ane, empereur titulaire, garde son prestige pendant un sicle : l'chec de la reconqute l'teint. Quant au frre de Pierre deux du nom, Robert de Champignelles, bien plac la cour, il engendre une multitude de fils mais, s'il russit dcrocher pour l'un l'archevch de Reims, les autres ne sont que de gros sires.
Certes, nos Courtney sont mieux localiss : le Devon est une frontire, propice aux dbarquements des Franais ou des Anglais exils, ce qui, d'emble, leur donne un rle significatif. Ils ont la chance d'hriter de l'earldom des Reviers, de russir de beaux mariages et de ne manquer, ni de fils ni de vertu guerrire. Leur extinction en 1556, aprs les hrosmes des deux roses et le flamboiement du marquis d'Exeter la Cour, est autrement spectaculaire que l'asphyxie insidieuse de leurs homologues franais.
On ne peut s'empcher de se demander si, au-del des hasards et des diffrences systmiques, l'cart des trajectoires ne rsulte pas d'une path dependence : le destin des Courtenay n'tait-il pas inscrit dans leur origine ? Biologiquement, Pierre est le fils du roi, "socialement" il n'est rien. Au moment o son mariage fait de Reginald un baron d'Okehampton, celui de Pierre le rend "sire de Courtenay". Son fils, Pierre "ii" n'est que comte consort, et Robert, quoique dot en terres, ne reoit pas de titre. Les deux bnficient d'une conjoncture favorable (expansion philipaugustienne), ils ne s'inscrivent pas dans la structure. Ces Courtenay sont royaux sans l'tre, ce pourquoi ils l'oublieront.
Au contraire, l'outsider Reginald est positionn dans la structure fodalo-royale et les Courtney, s'ils se rjouissent du sang royal (anglais) que leur apportent plusieurs alliances, sont avant tout une dynastie comtale que, pour sa gloire et son malheur, les drames des deux roses poussera au premier plan.
Reste une ressemblance ironique : longtemps aprs que les Courtenay et les Courtney soient teints, des cousins ambitieux entreprennent de les rallumer ! au long et vain combat des Courtenay tardifs des XVIIe/XVIIIe pour annuler des sicles d'obscurit, rpond au sicle suivant celui, bref et victorieux, du Courtney rsiduel pour repartir en arrire de 250 ans, se faire hritier mle du malheureux Edward et devenir sa suite comte de Devon.
La mort du bel Edward Courtney en 1556 ne laissait subsister qu'une branche collatrale, les Courtney of Powderham, aussi oublis que prospres. En 1762, ils mergent et accdent la pairie avec le titre hrditaire de viscount Courtenay of Powderham-Castle. En 1830, le 3me viscount, William "Kitty" Courtenay, actionn par son petit-cousin William, ptitionne pour tre restaur dans les honneurs d'Edward dont, en 1556, son arrire-grand pre sixime, William of Powderham, tait next in descent (Harris, 1832).
O me suis-je tromp ? qu'ai-je fait (de mal) ?, telle serait la "devise plaintive" (plaintive motto) des derniers Courtneys, dplorant la chute de leur maison (Gibbon qui prcise en note: a motto which was probably adopted by the Powderham branch, after the loss of the earldom of Devonshire). Malgr son opulence, ses succs propres et son silence, la dernire branche Courtney souffrirait d'tre dtache du tronc et ampute des honneurs qu'il confre. Pourtant, le portrait qu'en dresse en 1735 son thurifraire, Cleaveland, ne semble pas lui laisser dsirer grand chose : ...that Noble Family of Courtenay of Powderham, which continueth there to this Day, and is in a prosperous ConditionÉmore flourishing than it was then, having been matched to very honourable Families since, and having a great Addition made to their Wealth by the great Increase of their Estate in Ireland.
Les Courtenay franais, dplorant la chute de leur maison, auraient pu clamer aussi Ubi lapsus ? Quid feci ? D'un ct il s'agit de la dignit comtale, de l'autre de la dignit royale. Le premier cas n'est pas une affaire d'Etat et, en Angleterre, rencontrera un dispositif formel pour se plaider. Une autre diffrence est la clart indiscutable de l'issuance des Courtney of Powderham, loin des zigzags et des brumes des Courtenay tardifs. Aussi le cas Courtney tel qu'il sera trait au XIXe est rduit l'essentiel : le droit du sang.
Les Courtney de Powderham portent bien sr three Torteaux Gules et se transmettent de pre en fils le chteau de Powderham et une srie de terres en Devon et Cornwall ainsi que de vastes possessions en Irlande. Ils descendent en ligne directe du cinquime fils du grand Hugh, Philip, que, en 1383, Richard II fit Lord Lieutenant of Ireland for ten Years.
Sautons les gnrations, et arrivons (par une longue srie de William et quelques autres) ce William (1632-1702) qui, malgr un beau-pre gnral dans l'arme du Parlement, soutient (au moins au dernier moment) le roi Charles II, lequel, la restauration, le fait baronet. Par hritage collatral, il reoit le chteau et le parc d'Okehampton (passs des familles trangres par la mort d'Edward), renouant ainsi le lien lignager. En 1762, son arrire petit-fils (William) est cr viscount of Powderham-Castle ce qui l'lve la pairie alors que, jusque l, simples squires, s'ils ont souvent sig au Parlement, c'tait aux Commons en tant que knight of the shire.
Le troisime vicomte, son petit-fils, encore un William (1768Ð1835), est celui qui nous intresse. Il va demander et, plus heureux que les Courtenay franais, obtenir, sa restauration dans les honneurs d'Edward qui "dormaient" depuis 250 ans.
Ce William ("Kitty") est clbre pour son excessively flamboyant lifestyle aliment par les revenus irlandais, et pour son homosexualit publique une poque o on la punissait de mort. Inculp, il quitte l'Angleterre et partage sa vie entre son domaine New York, la place Vendme et son chteau de Draveil ct de Paris. Inutile de prciser qu'il n'occupe pas son sige la House of Lords. Comment un tel homme en vient-il rclamer la succession d'Edward ? Via un cousin entreprenant, toujours un William, son seul hritier. Ce William trouve l'argumentation, et ptitionne au nom du viscount (1830. Le dossier arrive au comit des privilges de la Chambre des Pairs.
Cousin William a tout pour russir. L'intrt d'abord : en hritant des biens du viscount, il ne lui succdera pas comme lord, n'tant pas heir of his body ; tandis que, si le titre de comte de Devon d'Edward arrivait William-Kitty comme descendible, il irait jusqu' lui. Ce William (1777-1859) a les moyens de son ambition: avocat, MP pour Exeter depuis 1812, master in Chancery, il est devenu en 1826 clerk-assistant la chambre des Lords (chef en second de son administration). Il jouit de la bienveillance du Lord-Chancellor Brougham (cabinet Grey). Ce dernier emportera la dcision du Committee au terme d'un dbat d'antiquaries qui plane trs loin de la crise rvolutionnaire qu'affronte le gouvernement entre l't 1830 (George IV ) et juin 1832. Campbell, dans son histoire des chanceliers (1869, T. 8, pp. 524/5), critiquera la dcision: the limitation "to the grantee and his heirs male" could not let in the collateral heir. Such a limitation of a landed estate could not be made by the law of England, and therefore could not be made of a dignity. Tout le monde pense ainsi et s'tonne.
Le dossier prsente deux aspects : une discussion juridique abondamment dbattue que je survolerai et une question de fait qu'on cherche luder car pendant 250 ans les Powderham se sont satisfaits de leur sort sans jamais rclamer.
La position de William la Chambre lui donne accs aux archives. Il retrouve les instruments juridiques de 1553 (restauration d'Edward) dont le texte prcis tait inconnu. Quelle satisfaction aura-t-il prouv en lisant la clause d'hrdit ! alors que, gnralement, les honneurs d'un tel se transmettent l'heir of his body, ce texte-ci tend la transmission tout hritier mle, et perptuit (sibi et heredibus suis masculis imperpetuum).
La diffrence est norme : l'absence de fils teint la dignit ; mais un homme a presque toujours un hritier, ft-ce un cousin loign, et la dignit se transmet. Si William-Kitty rcupre les honneurs d'Edward titre d'hritier, William les aura son tour en tant que cousin au troisime degr du viscount William: en effet, il descend de Henry Reginald, frre du premier viscount dont William est le petit-fils. Les termes de la patent de Queen Mary transforme en bill par le Parlement permettent donc la fois de qualifier le viscount de comte de Devon (alors qu'il n'est lui-mme qu'un cousin loign d'Edward) et, sa mort, de faire de William un comte hrditaire !
Nanmoins, si la gnalogie est limpide, le caractre exorbitant d'une telle clause d'hrdit soulve quelques difficults qui seront discutes. Retenons en deux : la jurisprudence Lovel (18. Henry VIII) et l'intentionnalit de la clause.
* la jurisprudence Lowel (18. Hen. VIII) annule toute concession de terre que la Couronne ferait un homme et ses hritiers mles en gnral : a grant of lands to a man and his heirs male by the Crown is void car l'indtermination du bnficiaire n'est pas admissible. Contra, William et ses avocats (Pepys et Nicolas) arguent qu'un honour n'est pas un land mme s'il implique des droits sur la terre (dignities are not governed by the same rules of law as lands) ; et que 18. Hen. VIII ne fait pas jurisprudence en raison de la spcificit du cas Lowel, Henry VIII regrettant un don antrieur ;
* l'intentionnalit de la clause : attendu que, en Angleterre ( la diffrence de l'Ecosse) une telle clause ne se rencontre presque jamais dans les patents, on pense une faute ou un oubli du rdacteur ou du copiste ou, tout simplement, un sous-entendu, tant il parat vident que le successeur ne peut tre que le fils hritier. Telle est la law of England. Contra, la rdaction est volontairement exceptionnelle : Queen Mary, comme elle en avait le droit, reconnat et honore, non seulement Edward, mais cet illustre sang Courtney, qui a rendu depuis si longtemps tant de services la Couronne. La rfrence explicite de la patent Hugh le grand et la consanguinit royale montre bien que the intention was to restore to the family the dignity which it had before enjoyed, and to perpetuate it in the heirs male. Nicolas souligne que, lorsque Queen Mary restaure Edward, sa ligne est menace d'extinction, ce pourquoi la reine largit la transmission aux collatraux. Au temps de Henry VII et VIII, cela ne fut pas ncessaire, leur Courtenay tant pourvu de fils : The earl [Edward] was then unmarried, and his next heir male was Sir William Courtenay of Powderham, who, like himself, was descended from Hugh the second Earl of Devon and Margaret de Bohun, and, in the event of the earl's dying without male issue, would have become their heir maleÉ from what other motive than the desire to benefit the collateral heir male could the omission of the words "de corpore" arise, when they occur in both the previous grants (Hen7, Hen8) ?
Par le dcs d'Edward qui tait le successeur de Hugh, l'anctre commun aux deux branches, le next in descent, se trouve treize degrs plus loin, en remontant Hugh et en descendant jusqu' William Courtney de Powderham-Castle dont le ptitionnaire est l'hritier direct. Le commitee for privileges accepte l'argument et proclame earl of Devon, le viscount Kitty et, rtroactivement, son pre, grand-pre, arrire grand-pre etc., tous faits earl de jure et inscrits comme tels dans la liste des comtes de Devon du Peerage : neuf gnrations de comtes d'un seul coup !
Edward mourant sans postrit, ses cousines troisimes reurent ses biens, lesquels ont t disperss par leurs mariages. Les biens, non la dignit ! celle-ci a dormi pendant 250 ans, attendant d'tre veille par le vicomte charmant ! Dormi ? on la croyait teinte ! l'objection, timide au commitee, s'exprime vivement dans la socit. C'est la question de fait : si l'honour est teint, la Couronne peut crer le viscount comte de Devon, elle ne peut pas le restaurer en attribuant ses pre, grands-pres, et lui-mme une dignit qui n'existe plus.
Nous retrouvons ici la problmatique familire aux Courtenay. Si les avocats se dmnent pour l'carter, l'attorney general l'aborde nettement : this case exhibits the remarkable fact of a long acquiescence, from the reign of Queen Mary to the reign of the present sovereign, in the nonenjoyment of the dignityÉIt appears, by the pedigree, that the collateral heirs male of Sir Edward Courtenay were persons in a highly respectable station of life, fully competent to have asserted their claim at that time.
Banks (1831), ulcr par le jugement de la House, protestera avec vigueur: l'Earldom Courtney est si bien teint par la mort d'Edward qu'il a t trait comme tel par la couronne et par les intresss, les Courtney de Powderham-Castle.
Si la Couronne (cette entit intemporelle et impersonnelle) voulait confrer l'honour au sang Courtney, elle l'aurait, ou bien transmis aux Powderham la mort d'Edward, ou bien mis en rserve en attendant qu'ils le rclament. Or elle n'en a rien fait. Au contraire, elle a dispos de la dignit comtale : en 1603, le roi Jacques l'a attribue Blount, Baron Mountjoy, et, aprs sa mort sans hritier mle, William Cavendish (1618) dont les descendants, devenus Dukes of Devon en 1694, restent en mme temps Earls of Devon. La couronne a tellement exclu les Powderham de la succession d'Edward que, la restauration de Charles II, elle a promu baronet William de Powderham (1632-1702) et ses hritiers, dniant ainsi qu'il soit un comte en puissance. Plus encore, en 1762, elle a fait viscount et peer un autre William C. de Powderham et ses hritiers !
Les intresss, eux, ont adhr cette dignit et sig la Lords'House en tant que viscount, une position infrieure et toute neuve, inacceptable s'ils croyaient mriter l'earldom multisculaire de Hugh le second. Loin de l, pendant 275 ans (1556-1830), aucun hritier mle de Powderham n'a effectu la moindre dmarche pour le rclamer, ni protest quand il a t transmis d'autres. Ne savaient-ils pas ? La patent d'Edward tait-elle si peu de chose que, emporte avec le reste par ses hritires, elle se soit perdue ? Non, les Powderham n'ont jamais pens tre les successeurs d'Edward. Pour eux, pour la Couronne, pour tout le monde, la dignit d'Edward n'existait plus.
Mais le Committee dcide: It was moved to Resolve, That the Chairman Report to the House, That it is the opinion of this Committee that William Viscount Courtenay hath made out his claim to the title, honour, and dignity of Earl of Devon, which being put, passed in the Affirmative. The Report was read to the House on the same day /14th March 1831/, when the Resolution of the Committee for Privileges was Agreed to by the House, and it was Resolved and Adjudged, by the Lords Spiritual and Temporal in Parliament assembled, THAT WILLIAM VISCOUNT COURTENAY HATH MADE OUT HIS CLAIM TO THE TITLE, HONOUR, AND DIGNITY OF EARL OF DEVON.
Problme : les Cavendish sont dj earl of Devon (titre non aboli mais fondu dans leur dukedom). On s'en sort en abolissant la vieille quivalence entre Devon et Devonshire : Courtney sera Devon et Cavendish Devonshire !
L'histoire ressemble celle des Courtenay : une branche marginale qui s'est tue pendant des sicles se rveille soudain et rclame les privilges de ses lointains anctres.
Certes,
les
deux dossiers diffrent. L'issuance des Courtneys est
indiscute
alors que le lien des Courtenay tardifs avec le dernier descendant certain de la branche cadette est flou (cf.
Annexe II). Flous aussi sont les honneurs revendiqus par les franais puisque, en son temps, le fondateur (Pierre, fils de Louis VI le gros) n'en avait pas. Il leur faut rclamer les honneurs que Pierre aurait eus aujourd'hui si, aujourd'hui, il tait fils de roi.
Ct
anglais,
tout est crystal clear : l'honour revendiqu, crit en toutes lettres dans la patent de la reine et le bill
du Parlement, est parfaitement dfini. Devenir comte de Devon comme successeur de Hugh, projette le viscount
of Powderham-Castle vers le haut et vers les temps hroques, et lui assure les premiers rangs dans l'ordre de prsance. Ct franais, si notre Courtenay qui n'a Ñet n'a jamais euÑ le moindre titre devenait d'un coup prince du sang reconnu, il serait capable de la Couronne ce qui est bien autre chose.
Le
Courtney de Powderham-Castle arguerait-il du mariage du grand Hugh avec la petite fille du roi Edward I en 1325 pour tre reconnu comme royal ? Il n'en a pas l'ide. Il ne pouvait pas en avoir l'ide, quelque ambition on lui prte, car les tumultes de l'histoire d'Angleterre ont provoqu des changements de dynastie. En France, la continuit affiche des descendant d'Hugues Capet incite une vision linaire des droits qui aveugle les Courtenay.
Mais la plus grande diffrence rside dans le haut degr de formalisme et de documentation qu'on trouve en Angleterre depuis la conqute normande. Les droits sont crits ! le long jeu entre le roi et le Parlement, comme les contentieux jugs par les tribunaux, ont explicit les privilges et les devoirs, multipli et prcis les procdures. Nos Courtenay franais ont prsent leur premire requte au roi Henri IV en esprant la voir soumise un traitement formel, soit au Conseil, soit au Parlement. Aussi vague que menaante, elle est carte et le Parlement ne se prononcera que tardivement et obliquement (Hlne) car il n'y a rien juger. Et ces mdiocres Courtenay n'ont rien fait pour la Couronne.
En Angleterre, deux sicles plus tard, l'opulent et well
connected vicomte Courtney, prsente sa ptition au roi, invoquant un instrument juridique, la patent de Queen
Mary, et formulant une demande prcise qui, en mme temps, n'a pas de rel enjeu (sauf pour l'hritier du viscount) : it
is
a case of curiosity, rather than of practical importance, dit le Lord-Chancelier. La demande transmise la House est examine par le committee for privileges qui, l'acceptant, propose aux Lords de la satisfaire, ce qu'ils font. Le dbat, au committee comme dans l'espace public, ne porte pas sur des gnralits et des chartes prives mal ou pas authentifies, il s'appuie sur des documents et des prcdents, il se nourrit d'une immense jurisprudence en matire de concessions royales et de peerage. Faute de vrais pairs, il n'existe pas en France un tel corpus de casuistique en la matire !
Toutefois, nous pouvons induire du dossier Courtney quelque chose sur la manire et quelque chose sur le fond.
Premirement la manire. En voyant la premire requte des quatre Courtenay tardifs en 1603, on lui trouve des raisons vraisemblables mais il est impossible d'imaginer comment l'ide leur arrive. Le cas Curtney apporte une suggestion : pendant une srie de gnrations, les Powderham, cousins de tant de grands hommes, et non ngligeables eux-mmes, ont eu la vague pense, non pas d'un droit, mais de mriter quelque chose. Cleaveland prte ce sentiment William, lorsqu'on le fait baronet : he not affecting that Title, because he thought greater of Right did belong to him... Mais ces Courtneys, persuads avec tout le monde que la dignit de count
tait morte et enterre avec Edward, n'y rvaient pas. Et voil qu'un accident survient : l'arrire cousin. Il n'hritera pas du titre et du sige du viscount absentiste. Or il est ambitieux, il a sig aux Commons, il travaille la House, il voudrait bien tre Lord. Par chance, le texte de la patent d'Edward lui offre une ouverture. Il mobilise deux excellents avocats (Pepys
deviendra
Lord Chancellor et Harris est spcialis dans le droit du peerage) et, grce au soutien du Lord Chancellor et la faible combativit de l'attorney general, obtient ce qu'il voulait. Mutatis mutandis, n'y-a-t-il pas eu quelque chose de ce genre chez nos Courtenay ? Quelqu'un est tomb sur du Tillet et, dans le contexte du temps, a eu l'illumination. Qui ? probablement un des cousins signataires Ðje penche pour un des deux qui s'exileront temporairement en Angleterre, des Salles ou Frauville. Il convainc le "chef de la maison", Gaspard de Blneau et dclenche l'affaire qui, ensuite, se dveloppe par action et raction.
Deuximement, le fond. Le Committee examine la question du sang que pose la clause de transmission de la patent
et, dans le cas d'Edward, la disjonction des general heirs et
du heir male. Heirs male of his body (sous-entendu :
lgitime) est dfini. Heirs male tout court ouvre des possibilits presqu'illimites. Heir general sert de repoussoir car, alors, des filles pourraient hriter de l'honour (ce qui leur arrive souvent) et, en se mariant inconsidrment, le transporter dans des familles indignes, voire alien, voire alien ennemies. Tandis que le heir male, mme latral, appartient au sang qui a initialement reu l'honour. Inutile de s'offusquer du "chauvinisme mle" de l'poque. L'intressant, c'est le mythe de l'anctre commun qui ramne le dbat Hugh : his
collateral
heirs male must be of the blood of the grantee,Ñthey must be descended from the same common ancestor (Lord
Wynford,
deputy speaker of the House).
Pourtant, la pratique juridique ignore l'anctre commun :
* dans les troubles de l'histoire anglaise, le earldom of Devon a t plus souvent forfeited, annul et recr que restaur, chaque fois personnellement. Edward lui-mme ne rcupre pas la dignit de son pre qui reste forfeited. Edward, restored in blood but not in honour, est recr sous le mme intitul et avec les mmes droits, comme le couteau dont on change alternativement le manche et la lame, ou le bateau de Thse ;
* puisque la clause la plus gnrale stipule heir
of his body, la doctrine est que l'honour n'appartient pas au "groupe familial", il descend en ligne verticale, de pre en fils an, tant qu'il y en a et condition d'tre rinvesti par le roi. L'honour n'est pas un bien priv qui suivrait la loi gnrale des successions : sauf exception, les filles et les cadets en sont carts, les collatraux aussi.
Les Courtney ici, les Courtenay l, par un postulat anthropologique, se rclament d'une espce de droit du clan ( nos yeux, l'aspect le plus saugrenu de leur dmarche) : puisque l'anctre
commun a t qualifi (de jure pour le Hugh du XIVe, de facto pour le Pierre du XIIe) ; puisque cet honneur est dormant ; puisque nous sommes le dernier avatar du grand homme (directement ou indirectement) ; nous devenons son substitut, identifi lui, et donc son honneur (ou quelque chose de cet honneur) nous choit. Le primogenitor se rincarne successivement dans ses hritiers qui ne reoivent pas de droits de leur prdcesseur mais portent les droits du commun anctre. La dure n'importe pas tant que les filiations tiennent. Le droit des fiefs tardif exprime quelque chose de ce genre (Balde selon Giesey, 1961), sans toutefois envisager les honneurs. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette conception archaque ne choque pas plus les Franais du XVIIe que les Anglais du premier XIXe.
Sur cette base, les Courtenay auraient pu gagner. Mais le parallle anglais montre ce qui, leur manquant, rendait l'chec inluctable : ils demandent plus que les Courtney avec moins d'atouts en main.
Chp.
I. Du comte de Sens au sire de Courtenay
Chp. II. Trois gnrations de Courtenay d'Outremer
Chp. III. La dpossession des anciens Courtenay Combes, 1853
Chp. IV. Curtney, comtes de Devon