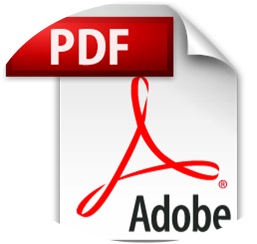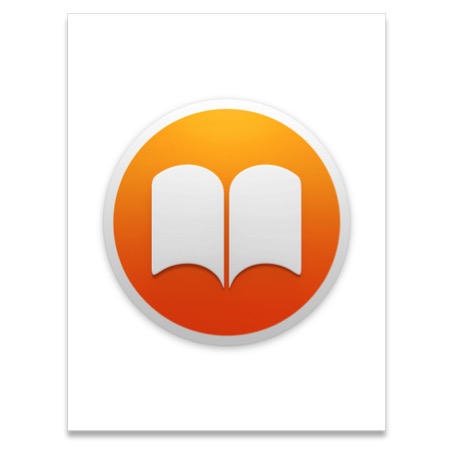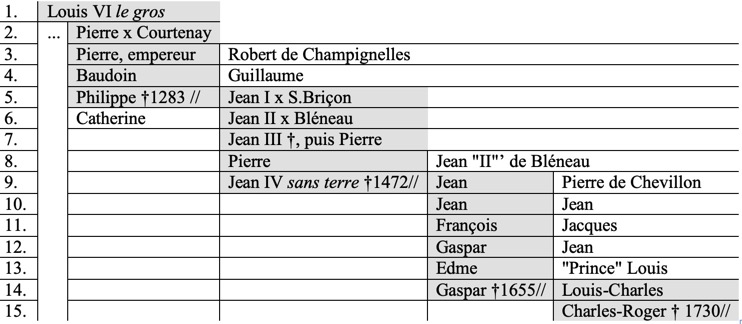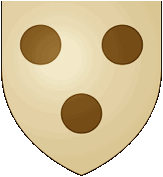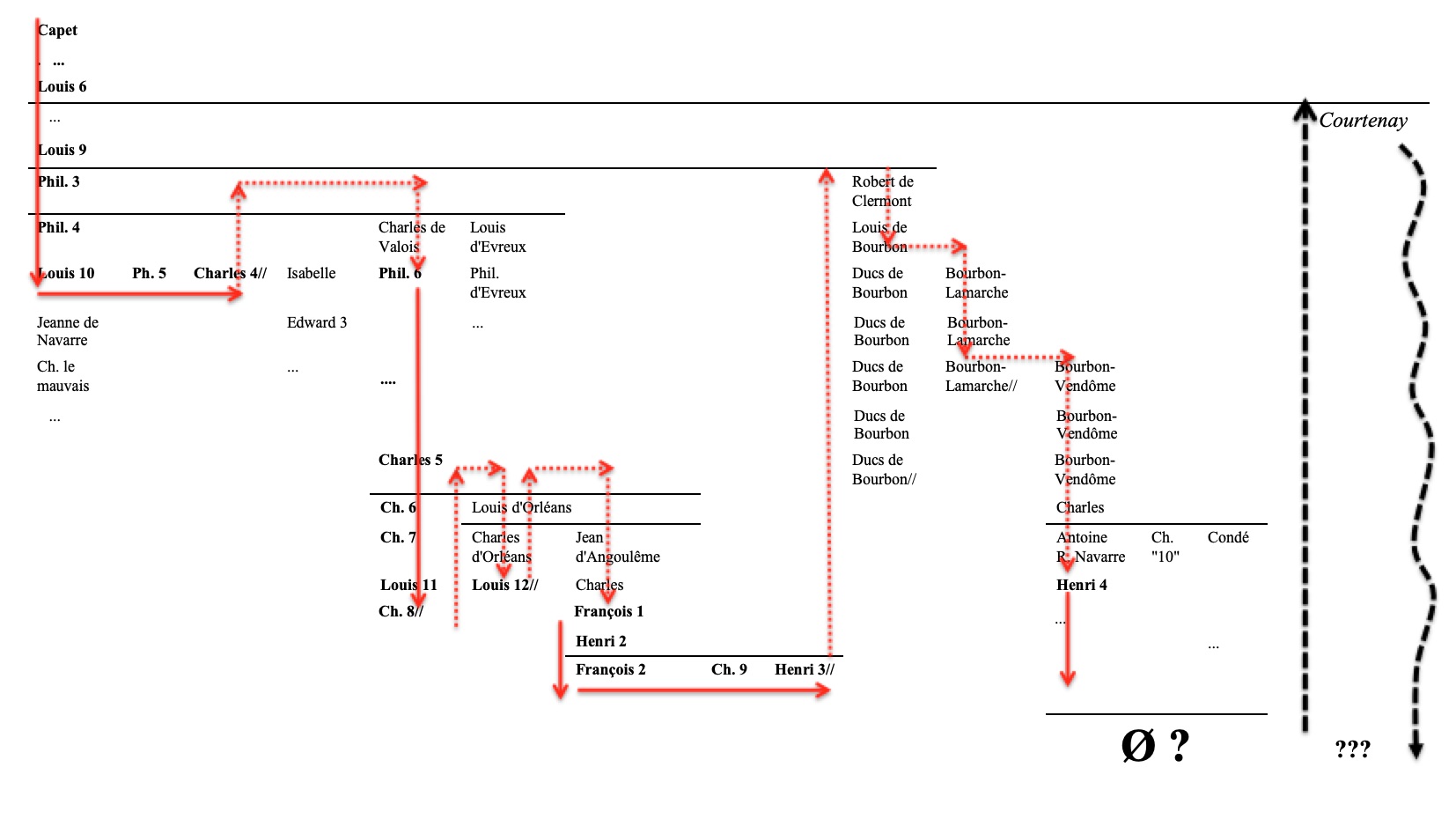27/06/2025
| Esambe Josilonus | Les Courtenay royaux: reconnus en tant que mconnus |
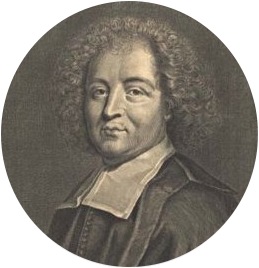 ©2025 | |
Nouvelle version (2025/2)
1. Offensive
2. Dfensive
3. Si falso, puniendum...
4. La chute
Conclusion. Le droit et le fait.
Rfrences
Des Courtenay du XVIe sicle affirmrent descendre directement par mles du plus jeune fils de Louis VI le gros ( 1137), et ceux du XVIIe requirent des Bourbon la reconnaissance de leur sang royal et l'octroi des prrogatives associes. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV les laissrent sans rponse. La question enterre avec le dernier mle (1730), le Parlement de Paris en crivit l'pitaphe (1737).
L'affaire, rencontre par accident, m'intrigua : cette seconde Maison de Courtenay supplante la premire au milieu du XIIe sicle. Lorsque, des sicles plus tard, de lointains rejetons, astiquant leur lustre terni, excipent de leur descente de Louis VI le Gros pour prtendre au label "prince du sang", on ne nie pas leurs droits, on ne les accorde pas. Ils ne sortent pas de cette impasse.
A peu prs absents de l'Histoire, ils n'ont gure laiss de traces. Aprs les premires gnrations, ils n'impressionnent plus la pellicule. Leur historiographe priv, du Bouchet (1661), euphmise : les chroniqueurs ont oubli de mentionner leurs hauts faits. On ignore presque tout des hauts et bas de leurs ressources : des ventes ou engagements de terres sont parfois mentionns, on suppose que des mariages les enrichissent, on ne sait rien de prcis.
***
Je fus d'abord amus par cette variante de la Grenouille et du BÏuf, ces simples gentilshommes qui s'enflent et se travaillent pour galer les Princes du sang. D'o le centrage des premires versions de ce texte (2015 et 2020) sur cette ambition fantomatique dont je cherchais les circonstances. Mais des recherches ultrieures m'ont convaincu que le cas dpasse les personnes : l'volution de la monarchie importe plus que les faiblesses ou les malchances de nos sieurs. En admettant leur issuance de Louis le gros, une telle origine ne suffisait plus au moment o ses bnficiaires faisaient valoir leur conception nave du droit du sang. De mme qu'est gentilhomme celui qui vit noblement depuis des gnrations, de mme un Prince doit vivre en Prince. Cette caractristique suppose un consensus "social", des moyens et un statut.
Au XIIe sicle, le premier de ces Courtenay, Pierre, frre de Louis VII, n'tait rien et n'avait rien. Au XVIIe, il aurait t combl d'honneurs, de privilges et de ressources. Mais ils n'choient pas ses descendants car, tandis que la Monarchie s'instituait, les hasards dynastiques ont magnifi les fils de S.Louis, d'abord captiens, puis Valois, Valois-Orlans, Valois-Angoulme et enfin Bourbon-Vendme. Nos Courtenay sortaient d'une ligne obsolte. La monarchie Bourbon pouvait les saluer, pas les admettre.
Telle est ma perspective en 2025. L'esprit et le plan ont chang et l'expos incorpore des lments pris dans les appendices. Ce qui concerne la premire Maison de Courtenay fait l'objet d'un article spcifique. Cette nouvelle version (2025/2) enrichit la prcdente sans modifier la perspective.
Il est, hlas, impossible d'viter le mlange des genres. Le texte commence comme un narratif et finit en dissertation. La matire en est l'excuse : elle oblige une approche chronologique qui mle le factuel et l'analytique, l'historique et le juridique, malgr le renvoi en appendice des dveloppements dtaills.
***
Le Prologue prsente les premires gnrations, issues de Louis le gros, celles qui marquent. La branche ane s'teint ; la branche pune s'endort ; les autres ne comptent pas.
Comment expliquer que des cadets de cadets se rveillent au XVIe ? que leurs fils formalisent leurs prtentions au sang royal sous Henri IV et le coincent dans un dilemme ? (Chp. 1).
Avec l'accident de 1610, la sollicitation tourne au contentieux, le contentieux l'action politique et, Cond dfait, nos sieurs perdent leurs anctres (Chp. 2).
Nanmoins ils rebondissent. Le roi ne dcidant rien, ni pour eux ni contre eux, ils exploitent l'ambigut et en sortent une princerie sans consquence qui se termine lorsque, en 1730, meurt le dernier mle (Chp. 3).
La pice est finie. La fille restante essayant de jouer les prolongations, le Parlement baisse le rideau (Chp. 4).
La conclusion tire les leons. Le sang est une notion complexe comme d'ailleurs la biologie le montre : il a besoin du cÏur, des poumons, de l'estomac etc. L'lment appartient un systme. Aussi, le sang de nos Courtenay suffit leur donner une couleur de royalit, il n'en fait pas des royaux.
¦ Pour
rendre le texte plus lisible, je m'interdis les notes. On se reportera aux Appendices 1, 2 et 4 dans lesquels on trouvera des prcisions ainsi que les rfrences bibliographiques particulires.
Prologue. Premires gnrations.
Rservons l'histoire de la premire Maison les interrogations sur la "disparition" de Renaud de Courtenay au dbut des annes 1150. Il laisse deux filles que le roi prend en garde. Louis VII case la cadette en la mariant Avelon, sire de Suilly (en Donziais), et donne l'ane son petit frre, Pierre. Par Isabeau (Elisabeth), l'hritire, il devient Courtenay. Elle est une lointaine cousine par sa grand-mre paternelle, Ermengarde de Nevers, issue de Hadwige (Alix, Avoye), fille du roi Robert, lui-mme fils de Hugues Capet.
Le roi Louis VI le gros a eu pour fils : Philippe qui meurt peine couronn, Louis qui le remplacera, Henri futur archevque de Reims, Robert futur comte de Dreux, Philippe futur archidiacre de Paris, et le dernier, notre Pierre, qui nat vers 1125.
A moins de trente ans, il pouse donc Courtenay, Montargis, Chteau-Renard, Champignelles, Tanlay, Charny, Chante-Coq et plusieurs autres terres, une collection de droits localiss dans les dpartements actuels du Loiret et de l'Yonne, entre la Bourgogne et le petit cÏur captien, la jointure des deux grandes "autoroutes" du temps que sont la Seine et la Loire. Il restera la marge de l'action royale. On sait seulement qu'il accompagne Louis VII sa malheureuse croisade (1147), qu'il est l'un des trois barons lacs envoys pour traiter d'une paix avec Henri II d'Angleterre en 1178, qu'il repart outremer (Acre) en 1179 avec Henri le libral Comte de Champagne, et qu'il ne vivait plus en 1183.
Il n'eut point de terre comme apanage et ce qu'on lui donna ne fut dcor d'aucun titre. C'est la gnration suivante, avec l'mergence royale philippaugustienne, que leur origine profitera aux fils ans de Pierre : Pierre et Robert.
La dame de Courtenay, Elisabeth/Isabeau, survit vingt ans son mari, jusqu'en 1205. Elle a produit un grand nombre d'enfants : cinq garons et six filles atteignent l'ge actif, capital humain exceptionnel en ces temps de surmortalit infantile et maternelle. Les fils hritent de leur mre, le pre ne possdant rien. Selon l'usage, l'an, Pierre, second du nom, reoit la plus grande part, dont Courtenay et Chteau-Renard ; Robert devient sire de Champignelles, Guillaume et Jean hritent de seigneuries mineures, respectivement Tanlay et Yerre. Quant aux filles, elles sont toutes maries noblement. Exploit rare, tout le monde est cas, jusqu' la moindre cadette, sans user du joker religieux :
- Pierre de Courtenay, ii du nom, empereur latin
- Robert de Champignelles, bouteiller du roi
- Guillaume, sire de Tanlay
- Jean, sire de Yerre
- Alix × Aymar, Comte d'Angoulme
- Eustachie × Comte de Sancerre
- Clmence × Vicomte de Thiern
- Constance × Guillaume, sire de la Fert Arnaud
Avant d'examiner la vie des deux ans, disons un mot des autres. Si les plus jeunes fils de Pierre et Isabeau (Guillaume et Jean) n'ont rien de remarquable, les filles (Alix, Constance, Eustachie, Clmence) constituent un prcieux capital relationnel qui n'est pas gaspill mais investi, d'abord aux alentours puis, aprs annulation ou dcs de leur mari, au del de la petite "France" royale. Leurs premiers mariages se font avec des sires voisins de Courtenay et leurs remariages nettement au-dessus et plus loin, sans doute la faveur de la fortune de leurs frres ans. Eustachie pouse d'abord un petit sire de Pacy-sur-Armanon, puis Guillaume, Comte de Sancerre ; Clmence, Guy VI vicomte de Thiern (Thiers) ; Constance, un sire de Chateaufort puis Guillaume, sire de la Fert Arnaud.
Alix ( 1218) mrite une mention spciale. D'abord unie un sire de Joigny, elle pouse en second Aymar Taillefer, puissant Comte d'Angoulme. Ils engendrent cette fameuse Isabelle (1188-1246) que Jean sans terre, pour prvenir l'union des comts d'Angoulme et de la Marche, arrachera en 1200 son fianc, Hugues de Lusignan, prcipitant les deux comtes dans l'alliance franaise. Cette erreur politique est aussi matrimoniale. Les mfaits et dbordements d'Isabelle lui vaudront d'tre appele Jezabel en Angleterre. La reine ultrieurement remarie (1220) son premier fianc, Lusignan, Comte de La Marche, leurs comts joueront un grand rle dans les guerres "franco-anglaises".
Branche ane
Pierre, ii du nom, prend un beau dpart. Il reoit l'essentiel du patrimoine maternel. Il dveloppe Montargis (fortifications et franchises) dont, en 1184, il cde les droits au roi (Philippe Auguste) en contrepartie d'une bonne hritire : une jeune Agns, mise en rserve la Cour aprs qu'elle et reu de son pre Guy le comt de Nevers et, de son oncle Renaud, ceux d'Auxerre et de Tonnerre (Du Chesne, 1619). Cette union reste presque strile : Mathilde, seule et unique fille, qui, la mort d'Agns (1192), reoit les trois comts dont Pierre exerce la garde noble.
Dans les terres qu'il gouverne au nom de la petite Mathilde, Pierre agit comme les autres comtes. A l'extrieur, il bataille avec ses puissants voisins (Champagne et Bourgogne). A l'intrieur, il abuse des abbayes (qui se dfendent bien), s'oppose aux vques dominateurs et endosse les vieilles querelles. C'est ainsi qu'il perd la petite Mathilde, prcocement fiance au comte de Namur, frre de la deuxime femme de son pre, grce quoi le Roi et lui cherchaient joindre possessions flamandes et bourguignonnes.
Mathilde, fut (littralement) conquise par Herv de Donzy qui, par le dcs de ses frres, avait rassembl les terres de sa Maison, proximit de la Loire. De longtemps, les barons de Donzy et les comtes de Nevers se disputaient la terre de Gien. Au cours d'une bataille, Herv vainc Pierre et le capture (1199). Le roi Philippe Auguste pacifie les adversaires et, en rcompense, se fait donner par Herv la terre de Gien, objet de la dispute. Ce n'est pas cher puisque, en change de la libration de Pierre, Herv reoit la petite Mathilde avec le comt de Nevers (Auxerre et Tonnerre restant au pre titre viager). En 1199 la fille a onze ans. Comme sa mre, elle ne produira pas d'hritier : une unique fille (1205-1225), nomme Agns (Anne) qui, ironiquement, sera la tige maternelle des Bourbon royaux. En effet, le roi interdit Herv de la marier au petit Henry, fils an de Jean roi d'Angleterre (futur Henry III), et l'accorde l'an de son fils an, Philippe, roi de France en puissance, qui meurt 9 ans sans qu'on active la clause de substitution qui la passait au suivant, Louis, futur IX et saint, alors g de quelques mois. Aprs qu'Agns et ainsi frl deux couronnes et trois maris royaux, le roi l'unit l'un de ses grands faux, Gui de Chatillon. Leur unique fille, Yolande, sera marie au riche et puissant Archambauld IX, sire de Bourbon ; leurs filles pouseront en mme temps (1248) deux fils de Hugues IV duc de Bourgogne : la premire, Eudes, l'an ; la seconde (Agns), le pun (Jean). Ces derniers engendreront un seul enfant, derechef une fille, Batrice, hritire de Bourbon, attribue (1272) Robert de Clermont, fils cadet de S.Louis. Telle est l'origine des Bourbon-Clermont dont l'un, bien des gnrations plus tard, deviendra Henri IV auquel les Courtenay demanderont de les reconnatre !
Revenons Pierre II du nom. S'il avait eu d'Agns de Nevers un fils au lieu d'une fille, les comts bourguignons seraient rests rassembls et, pour peu que la biologie et la guerre favorisent les gnrations suivantes, une ligne de grands Courtenay aurait pu se consolider, toute royale.
La premire pouse de Pierre dcde, Philippe Auguste, toujours soucieux de dtacher les Flandres de l'Angleterre, l'a recharg en hritire en la personne de Yolande du Hainaut, fille de Baudouin, comte de Flandre et du Hainaut, et sÏur de la dfunte reine, Isabelle de Hainaut. Tout en restant actif Auxerre, directement et par procuration, Pierre entame une deuxime vie. Avec Yolande, il retrouve la prolificit paternelle : leur mariage engendre dix enfants vivants. Outre les garons que dvorera Constantinople, six filles dont trois contribueront la brve diplomatie impriale de Yolande. Parmi les autres, l'une se fera nonne ; une autre, Isabelle, pousera Gautier, seigneur de Bar, puis Eude seigneur de Montaigu ; une autre, Marguerite, Raoul d'Issoudun puis Henri comte de Vianden Ñ cette comtesse de Vianden ne sera pas la moins active.
Yolande donne Pierre non seulement des hritiers mais un hritage car, en 1212, la mort de son frre Philippe lui apporte le comt (marquisat d'empire) de Namur. Son frre an, Baudoin, devient comte de Flandre et du Hainaut puis, en 1204, premier empereur latin de Constantinople.
Empereurs latins
On sait que, la suite des ambitions des Normands de Sicile, des expditions outremer, et des antagonismes qu'excitent les trahisons rciproques, la quatrime croisade se laisse dvier par les Vnitiens, intermdiaires obligs entre l'Orient et l'Occident. Le dtour par Constantinople pour rendre leur couronne Alexis et Isaac Ange qui, une fois rtablis, paieraient la dette des Francs Venise, aboutit l'invasion de la ville, incendie, massacres et pillage hont. Les Francs lisent pour "empereur" le frre de Yolande, Beaudoin, inoffensif comte de Flandre et du Hainaut. Venise est seigneur de un quart et demi de l'empire, l'empereur de un quart et les barons (Montferrat en premier) du reste. Mais le quart de l'empereur est largement en Asie que les Grecs de Nice dfendent bien, sa suzerainet sur les barons est toute thorique et Venise fait ce qu'elle veut.
Coup de l'arrire-pays agraire dont le drainage conditionnait la puissance et mme la survie d'une ville gante, l'empereur doit se dfendre contre les Grecs (Nice, Epire), les Bulgares, les "Turcs", sans oublier les "Tartares" pisodiques et les aventuriers de tous poils. Sans ressources, attaque de toutes parts, du dedans comme du dehors, dchire de rivalits, Constantinople, pendant un demi-sicle, deviendra un trou noir, engloutissant l'argent et les hommes, annihilant l'nergie et la sagesse des meilleurs.
En un an, l'empereur Baudoin ne parvient qu' exciter encore plus les Grecs contre les Francs et se faire btement battre par les Bulgares Andrinople (1205). Il meurt en captivit. Son frre Henri le remplace (1206), rtablit la situation militaire, noue des alliances et se concilie une partie de l'aristocratie grecque. Quand il dcde sans descendance (1216), les barons choisissent sa sÏur, Yolande, et son mari, Pierre de Courtenay, en qui ils voient un proche parent du roi de France et un grand personnage (Auxerre etc.). Pierre cde la sduction d'une couronne impriale. Si ce titre lui assure une (petite) place dans les livres d'Histoire, il le tue avant d'atteindre Constantinople ! Ayant mis ses terres en gage pour lever des fonds, Pierre part avec de nombreux vassaux et hommes d'armes. Pour payer leur passage aux Vnitiens, ils assigent pour eux Duras (Durazzo, aujourd'hui Durrs) sur la cte albanaise. Ils chouent. Lchs par leurs transporteurs, ils tentent de passer par les montagnes o ils sont assaillis et vaincus par les Grecs d'Epire : Pierre et beaucoup d'autres disparaissent. Fin de l'empereur !
Reste l'emprire, Yolande. Venue par mer, elle accouche Constantinople d'un Baudouin, le premier et seul franc jamais n dans la pourpre. De concert avec les barons, elle gouverne Constantinople et poursuit la sage stratgie d'Henri en mariant judicieusement ses filles. Mais Yolande meurt trop vite (1219).
Les barons, fidles au droit hrditaire, envoient une dputation au fils an de Pierre et Yolande, Philippe, comte/marquis de Namur. Ce dernier, tent ou non, trop occup se dfendre contre ses voisins, renvoie les barons son frre cadet, Robert, que, avec l'assentiment du roi Louis VIII, ils conduisent Constantinople pour le couronner. Ce Robert, de 1220 1228, ne montre que la faiblesse de son esprit et la bassesse de son courage. Il finit par s'enfuir et meurt.
Le dernier fils de Pierre, le porphyrognte Baudoin (1217-1273), tant encore trop jeune, Jean de Brienne, "roi de Jrusalem", est lu empereur ad intrim et, coup double puisqu'il a dj mari sa fille Isabelle Frdric II, l'empereur germanique, fiance l'empereur latin la cadette, Marie, alors ge de 4 ans (le mariage aura lieu en 1234). Brienne dort pendant deux ans, puis fait mal et, comme les autres, appelle le pape et les rois son secours en expdiant en Europe le jeune Baudoin qui, pendant son sjour (1237-39), se met en possession de Courtenay et revendique le comt de Namur usurp par sa sÏur Marguerite de Vianden. Il la chasse au terme d'une guerre sanglante. Voulant en tirer hommes et argent pour se soutenir Constantinople, il gage le comt au Roi de France (1238).
Brienne dcd en 1237, Baudoin est couronn empereur son retour Constantinople. Sa situation est si prcaire que seul le refus de Louis IX l'empche de cder Courtenay, terre de consquence dont sa famille portoit le nom. En 1243-46, il repart en Europe. Ensuite, Namur perdu, il envoie son pouse Marie le reprendre avec l'aide du roi de France (1253). Le comte de Luxembourg, en 1256, appel par le peuple rvolt, chasse Marie. Baudoin reconnat son chec et vend ses droits sur Namur (1263).
Malgr tous ces efforts, les Francs, coincs dans Constantinople, manquent tellement d'argent que l'empereur, aprs avoir dvor ses terres, fondu le plomb des toits pour frapper de la monnaie, vendu la couronne d'pines du Christ et autres reliques, met au clou son fils Philippe chez des prteurs vnitiens o il restera plusieurs annes. A la fin, surdtermine par la guerre des Vnitiens et des Gnois qui s'allient avec l'un ou l'autre des empires grecs ennemis des latins, par les autres rivalits europennes (France-Angleterre-Empire germanique) et par les alliances antagoniques rgionales, la situation devient absolument sans issue : l'Empire, toujours insoutenable, en raison de son vice organique et des erreurs commises, est repris en 1261 par les "Grecs" (Michel Palologue).
Baudoin de Courtenay fuit jusqu' Naples auprs du roi Charles d'Anjou, fils de Philippe Auguste. Ils s'allient pour reprendre Constantinople et cimentent leur accord en mariant leurs enfants : Philippe, tout juste dgag des Vnitiens, pouse Batrice, issue du premier mariage de Charles d'Anjou. Les "empereurs", Baudoin et Marie, continuent courir l'Europe pour lever des fonds et chercher des soutiens. La reconqute subit chec sur chec... Enfin, en 1282, Charles d'Anjou a nou des alliances, reconstruit une immense flotte, rassembl des soldats. Le succs ne fait plus aucun doute... lorsque les Siciliens se rvoltent (Pierre d'Aragon).
Baudoin meurt (1273). Hommes et argent fuient son fils Philippe (1243-1283) : la raliste Venise, constatant son impuissance, l'abandonne pour s'allier aux Grecs. Le pape ne lance pas d'appel la croisade (aurait-ce servi quelque chose ?) car les Grecs engagent, fort propos, des ngociations religieuses qui font esprer la fin du schisme. Philippe choue mme faire un fils ! Il n'a qu'une fille.
Cette emprire Catherine devient en 1301 la seconde pouse de Charles, comte de Valois, la fois frre du roi rgnant, Philippe le bel, et pre du futur Valois royal (Philippe VI). Encore une seule fille, Catherine II du nom ! Encore un perdant magnifique ! Ce Charles visa toutes les couronnes et n'en obtint aucune.
Lorsque Catherine dcde (1307), ses funrailles sont grandioses. Mais les honneurs rendus sa dpouille s'adressent son mari et son titre d'emprire, non son ascendance royale. Reste sa fille dont Charles, remari une troisime fois (1308), las du fantme d'empire, se dbarrasse en la mettant en position d'y prtendre par elle-mme. Pour cela, il dnoue le mariage antrieurement conclu avec le petit duc de Bourgogne, moyennant l'abandon de ce qui reste de l'hritage de Catherine, dont la terre de Courtenay : baille en apanage ou en cadeau diffrents princes qui la donnent ou la vendent leur tour, Chabannes s'en emparera vers 1450 (dpouilles de Jacques CÏur). Par lui, elle arrivera aux Boulainvilliers au profit desquels, en 1563, Charles IX rigera la seigneurie de Courtenay en comt.
Pour sa part, la trs jeune emprire pouse gaillardement en 1313 Philippe d'Anjou, hritier des Anjou-Sicile : Prince de Tarente, largement possessionn en Grce propre, il semblait un bon tremplin pour sauter sur Constantinople. Espoir vain ! Tout ce qu'aura Catherine, c'est la strile rgence de l'Achae pour le compte de son fils an Robert. Son insuccs la ramnent Naples o, aprs le meurtre opportun du premier mari de la reine (Andr de Hongrie), elle lui marie son autre fils, Louis de Tarente ( 1362), qui doit affronter l'invasion des Anjou hongrois.
Les descendants se pareront d'un titre imprial de plus en plus irrel, tout en s'agitant dans leurs possessions en Grce propre (More) qu'ils finiront par perdre.
***
Cette histoire appelle deux remarques.
1) Quoique vain en pratique, le titre d'empereur latin fait du Courtenay l'hritier des Csars romains (en concurrence avec l'empereur germanique), un Souverain, aux cts, voire au-dessus, des rois d'Europe. Sa dpossession ne change pas sa nature ni ses droits. Mme les filles ultimes appartiennent cet univers, dans lequel elles se marient et intriguent. Lors des tournes europennes d'un Baudoin aux abois, il est splendidement reu par Louis IX, par le pape, le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne qui lui accordent ou promettent des secours et le traitent selon son rang minent. Ils sont en dette l'gard de ce dfenseur de la chrtient romaine. A la sance d'ouverture du concile Ïcumnique de Lyon (1245), il sige la droite du pape : avec le comte de Toulouse et les reprsentants des rois de France et d'Angleterre, il tente d'empcher la condamnation et la dposition de Frdric II. La reconqute des Grecs (1261) et sa fuite ne changent pas son statut. C'est en empereur que le roi de Sicile l'accueille, scellant leur alliance par le mariage de leurs enfants.
2) Cet clat imprial rejette dans l'ombre les branches cadettes. Que Pierre II du nom soit le petit-fils de Louis le gros facilite son dcollage (Philippe Auguste), mais c'est par la Flandre et le Hainaut (Baudouin) qu'il devient empereur. Son ascendance royale n'est que la moindre de ses grandeurs. La dignit impriale, obtenue via Yolande, se transmet ds lors verticalement de pre en fils. En quelque sorte, la ligne ane se spare des autres. Le ms du Lignage de Coucy de Dreux, de Bourbon et de Courtenay, crit en 1303 d'aprs la Chronique de Baudoin d'Avesnes, ne connat de Courtenay que Pierre, mentionnant seulement que son fils Baudoin a perdu l'empire, que le fils de celui-ci a laiss une fille qui a pous le frre du roi. Point final. Pas d'autre lignage qu'imprial. Dans la semi-officielle Gnalogie de la Maison de France (1re moiti du XVIIe), les frres Sainte-Marthe, historiographes du roy, feront concider la fin des branches cadettes avec celle de la branche impriale : il n'y a plus rien aprs.
En effet, si Robert de Champignelles, le frre pun de Pierre, ne fut pas un mince personnage, il n'appartient pas l'univers des souverains et sa ligne se confondra avec la gentilhommerie, ne gardant de son origine qu'un toponyme transform en patronyme et le vague souvenir d'avoir t quelque chose.
Branche de Champignelles
Robert participe activement aux guerres contre Jean sans terre (1204-1206) qui aboutissent la rcupration de la Normandie et la conqute temporaire de l'Anjou et du Poitou. En rcompense, Philippe Auguste, son cousin germain, l'enfieffe des seigneuries de Conches et Nonancourt (en dfinissant minutieusement ses devoirs), qui s'ajoutent ses possessions propres (Champignelles etc.). Nanmoins, s'il soutient le roi, ce n'est pas sans ambigut. Philippe II affirme l'autorit royale, extensivement (domaine) et intensivement ("administration"). Son long rgne opre la transition du petit roi fodal au "proto-monarque". Les Grands du Royaume n'apprcient pas et, avant leurs grandes rvoltes de la minorit de Louis IX, exploitent les terrains encore ouverts : le roi restant l'cart des expditions languedocienne et anglaise, Robert, comme bien d'autres, avec ses chevaliers et leurs hommes, se joint la "croisade" des barons contre les Albigeois (sige de Lavaur, 1211) et, plus tard, la tentative du prince Louis de l'autre ct du Canal.
C'est surtout dans le conflit entre rois de France et d'Angleterre que, comme ses pairs, il joue une partie complique. En effet, sur le continent, les droits de ces rois, aussi enchevtrs qu'indfinis, s'affirment ou s'infirment au gr des combats ; dans cette vaste zone de dispute et ses alentours mouvants, la flexibilit s'imposait. A l'instar de la plupart des puissants, la fidlit de Robert est floue.
La bataille de Bouvines (1214) claire, la fois, les faits et les rumeurs. La vassalit est une relation plus opportuniste que le proclame son idaltype et, Bouvines, les "tratres" ne manquaient pas. Pierre, le futur empereur, avait un pied de chaque ct, l'un Nevers avec le Roi, le second avec l'Empereur en tant que comte de Namur par sa femme Yolande. Robert a flott (ou en est souponn) puisqu'on le trouve, aprs la bataille, inclus dans la liste des punis. Comme bien d'autres, il doit donner des rpondants pour cautionner qu'il servirait fidlement le seigneur roi, au mpris de tous biens terrestres : une trentaine de Grands s'engagent payer au total quelque 6000 marcs au cas o Robert ne tiendrait pas sa promesse. Si la victoire fut difficile obtenir Bouvines, sa liquidation le fut encore plus car elle devait apurer maints calculs lgitimes, dicts par des soucis offensifs ou dfensifs. Chacun savait que les intrts comptaient plus que les suzerainets, et chacun balana entre l'Empereur Othon, le roi Jean, le comte de Flandres et le roi Philippe. Ils avaient raison avant, ils ont tort aprs, du fait de cette bataille fortuite, gagne grce au recul de Jean sans terre la Roche aux Moines, 600 kms de l.
Il y en avait tant, et si puissants, que Philippe, mme aprs sa victoire et l'emprisonnement de Ferrand Paris, dut les mnager. Le chapelain du roi, Guillaume le Breton crit : ... quoiqu'il et pu les condamner comme coupables de lse-majest, le roi ne leur infligea aucune punition, si ce n'est qu'il exigea d'eux le serment d'observer au moins l'avenir fidlit envers lui (Le Breton, aprs la liste des prisonniers de Bouvines). Dans le nouveau rapport de forces, ce serment insincre, permet Philippe de reprendre la main.
Cela explique-t-il que Robert prfre l'hritier prsomptif, Louis le lion (futur VIII) dont Philippe se sert et se dfie la fois ? Les barons anglais rvolts l'lisent Roi la place de Jean sans terre et Robert participe sa conqute de l'Angleterre (1216-1217). Il commande la dernire flotte de secours, dfaite la bataille des cinq les. Nanmoins, les envahisseurs, s'ils perdent l'Angleterre, gagnent en rputation et Philippe craint que le dsir de rgner ne pousse son fils Louis entreprendre quelque chose contre lui, avec le concours de ceux qui l'ont accompagn et qui regrettent de n'avoir pas t soutenus. Le roi exige donc encore de Robert un serment de fidlit de le servir contre tous et sans exception (nov. 1217). Et, en 1222, Robert doit se porter garant que sa nice Mahaut, veuve et trois fois comtesse (Nevers, Auxerre, Tonnerre), obira Philippe et ne se remariera pas sans sa permission et contre sa volont.
Louis, enfin roi (1223), le garde ses cts et le promeut bouteiller, l'un des grands offices de la Couronne, rmunrateur et prestigieux. Robert l'accompagne son expdition languedocienne (1226) o le sige d'Avignon se termine par le dpart du Comte de Champagne et la mort du roi. Toujours bouteiller sous son successeur Louis IX, Robert faisait-il partie des Grands auxquels la "rgence" de la reine-mre, Blanche de Castille, donne une chance de reprendre le terrain perdu ? Peut-on croire le contest Varillas (1687, Minorit de S. Louis, p.39) qui l'inclut dans la ligue de 1227 ? Le dernier Prince du Sang qu'attira le Comte de Boulogne, ce fut Robert de Courtenai. Il l'y trouva dispos par le dpit de ce que la branche de Dreux avoit t prefre la sienne, par le mariage de l'hritiere de Bretagne: & l'on acheva de le gagner par les sommes de deniers Roiaux, dont on lui permit de se saisir. Une chose est sre : Robert appartient, avec les Comtes de Boulogne, de Dreux, de Macon et le Duc de Bourgogne, la coalition de barons qui, selon l'expression de Tillemont (Vie de saint Louis), dclarent la guerre au comte de Champagne pour la faire au roy, attaquent et dvastent plusieurs reprises son comt, car l'ambigu Thibaut, en trahissant ses allis, a sauv le gouvernement de la "rgente".
Indice de son implication dans les troubles, la dernire action de Robert consiste se joindre la dsastreuse croisade des barons que dirige ce mme Thibaut de Champagne, dsormais roi de Navarre, qui, ayant fait vÏu de croisade en 1238, a d s'excuter en 1239 aprs l'chec de sa dernire entreprise contre Louis IX. Robert y trouve la mort, avec beaucoup d'autres.
Postrit de Robert
Vers 1198, il a pous Mahaut, Dame de Mehun, en Berry. Ils ont huit enfants vivants, dont deux filles. L'ane pouse le Comte de Sancerre ; la seconde, d'abord un Montfaucon, puis le Comte de Bourgogne et de Chalon. Parmi les garons, le quatrime et le cinquime seront clercs : l'un, vque d'Orlans (1258), survit la dernire croisade de S.Louis ; l'autre, lu archevque de Reims (1264), contest mais confirm par le pape Clment IV (1266), meurt la mme croisade (1270). Outre les avantages matriels et crmoniels attachs au sige de Reims, son titulaire sacre les Rois. Le neveu du prcdent, archevque de 1300 1323, aura le rare privilge de voir dfiler tous les fils de Philippe le Bel (Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel).
Quant aux quatre garons restant, l'an hrite de Conches, le pun de Champignelles, le suivant part la conqute du royaume de Naples avec Charles d'Anjou, et, la fin, leur dcs sans postrit assure Champignelles et les terres associes au petit dernier, Guillaume, qui n'avait rien et tait, comme les quatrime et cinquime fils, destin l'glise. C'est par ce cadet que se poursuivra la ligne. Guillaume ( autour de1280), sera de la dernire croisade de S.Louis et participera celle (avorte) de son successeur (1276).
Son premier fils renonce son privilge d'anesse pour entrer dans l'Eglise. C'est lui qui, trente ans aprs son oncle, sera archevque de Reims (1300-1324).
Le second fils, Jean, hrite de Champignelles et son mariage y ajoute Saint-Brion (Saint-Brisson-sur-Loire,
prs de Gien). Il participe aux guerres de Philippe le
bel et, par son frre, devient gouverneur du temporel de Reims. Les filles sont maries trs honorablement.
A la gnration suivante, le successeur augmente son hritage de Blneau qui vient de son pouse. Ses trois frres sont chanoines de Reims dont l'un d'eux deviendra archevque mais dcdera la mme anne (1352).
La branche ane est teinte, et les Champignelles s'obscurcissent. Dj, quand les Captiens directs disparaissent, on ne se soucie pas d'eux. La liste des vingt (princes) en ge de se faire craindre dont, en 1328, Philippe de Valois devait obtenir le ralliement pour se faire roi, cite 5¡. Les Branches de Dreux & de Courtenay, dont il n'y avoit que les Ducs de Bretagne (issus des Dreux) qui tinssent rang de Princes. Voil leur pitaphe. Et, nous le verrons, malgr leurs efforts, ils ne ressusciteront pas car ils n'appartiennent plus la ligne qui porte la couronne.
1. Offensive
Gibbon
crit
un peu trop malicieusement (il sera abondamment cit) : Aprs
la mort de Robert, grand-bouteiller de France, ils descendirent du rang de princes celui de barons ; les gnrations suivantes se confondirent avec les simples gentilshommes, et dans les seigneurs campagnards de Tanlai et de Champignelles on ne reconnaissait plus les descendants de Hugues Capet. Les plus aventureux embrassrent sans dshonneur la profession de soldat ; les autres, moins riches et moins actifs, descendirent, comme leurs cousins de la branche de Dreux, dans lÕhumble classe des paysans. Durant une priode obscure de quatre cents ans, leur origine royale devint chaque jour plus douteuse, et leur gnalogie, au lieu dÕtre enregistre dans les annales du royaume, ne peut tre vrifie que par les recherches pnibles des gnalogistes (1788, la fin du Chap. LXI de Dclin
et chute, Digression sur la famille de Courtenay).
De lÕhumble classe des paysans, on ne s'adresse pas au roi pour tre reconnu (1603) ! Si les Courtenay tombent dans la gentilhommerie et si leur origine s'obscurcit, quelque chose les pousse essayer de remonter. Il est remarquable que ces seigneurs campagnards conservent le nom de Courtenay dans leurs chartes et leurs contrats. A l'instar des Courtney anglais rsiduels, dplorant la chute de leur maison, les Courtenay franais auraient pu adopter la "devise plaintive" (plaintive
motto) : Ubi
lapsus ?
Quid feci ? O
me suis-je tromp ? qu'ai-je fait (de mal) ?
En effet, les sires de Champignelles, descendants directs de Robert, ne disparaissent pas. Il
leur
arrive encore de faire des mariages intressants et, bons barons, lorsqu'on les semond, ils rejoignent l'ost royal avec quelques chevaliers et cuyers. On en voit Mons-en-Pvle (1304), Poitiers
(1356), Sainte Svre (1371), Rosebecque, (1382) etc.
Le
dernier
d'entre eux, Jean IV de Champignelles ( 1472), se distingue aux batailles de reconqute de Charles VII (Pontoise,
1441 ;
Normandie, 1449)
au
point de figurer dans l'Armorial de Bouvier (hraut et roi d'armes de Charles VII), avec, outre son cu (f¡24, V¡), son effigie en baron
de Courtenay, monseigneur de S.Brion (f¡38,
R¡). Pour financer ses entreprises militaires, il vend ses terres, l'une aprs l'autre, mme Champignelles ( Jacques CÏur). Il a pous une fille de l'Amiral de France (Jacques, Sr de Dampierre), puis en 1444 Marguerite de Droizy, la veuve d'Etienne de Vignolles (la
Hire). Il meurt en 1472 sans postrit et sans biens (mais non sans avoir dot son btard).
Aprs
l'extinction
de la branche ane qui emporte la visibilit de la maison Courtenay (1283), aprs celles de Tanlay en 1383 et d'Yerre en 1384, aprs la perte de la terre de Champignelles, est-ce le tour de la branche de Robert ?
Non, car le pre de Jean sans terre avait un frre cadet, mari (1424) la riche Catherine, fille de Franois de L'Hpital, seigneur de Soisy-aux-Loges (Choisy), Conseiller & Chambellan du Roi. Lors du partage successoral (1415), ce frre a reu Blneau, la Fert-Loupire, Chevillon et autres terres. Le sans terre mort (1472), la branche Blneau succde celle de Champignelles. Du Tillet crit : Par le decez dudit Iehan de Courtenay, pour tout heritage les pleines armes de la maison de Courtenay vindrent son oncle (1580, p. 90).
Pleines armes car, dornavant, Blneau est la branche ane, quoique du Tillet se trompe. En ralit, la substitution s'opre en reprsentation car l'oncle du sans terre tait mort avant lui (1460). Aprs 1472, les armes
pleines passent fictivement l'oncle pour arriver son fils, cousin germain du dfunt. L'oncle s'tait employ reconstituer le patrimoine en rachetant la Fert-Loupire et en tentant de retraire Champignelles vendu par Jean IV CÏur. Les biens de ce dernier ayant t saisis, la procdure de Blneau l'oppose dsormais au Procureur du roi. La Chambre du Trsor rend un arrt favorable Blneau (11 oct. 1454) dont le Procureur appelle au Parlement : au lieu d'un jugement, nous trouvons un accord (16 aot 1455) par
lequel icelui seigneur de Bleneau eust renonc ladicte sentence par lui obtenue de nosdits conseillers du trsor et tout procs, et aussi au retraict lignaigier par lui prtendu (cit par Buchon, 1838, Chroniques et mmoires du XVme sicle).
Comme
le
problme qui nous occupe dpasse la gnalogie (cf. Annexe 2), ne discutons pas le schma qui justifie les Courtenay tardifs : Louis VI, Pierre (branche impriale), puis Champignelles, puis Blneau. Le premier fils de l'oncle Blneau poursuit cette sous-branche, le second engendre une branchette Chevillon qui survivra la prcdente et se fera prince (sans consquence).
En 1603, les descendants de Jean de Blneau supplient Henri IV de les admettre prouver la qualit royale que leur obscurit a fait oublier. Voil, nous nous sommes absents quelques sicles ! nous sommes de retour ! c'est nous ! H, cousins ! faites-nous un peu de place sous les lys ! Nous aussi, nous sommes des Captiens, des Robertides ! les tout derniers cadets de Louis le gros, maintenant que ce qui restait de Robert de Dreux a disparu avec la mort de Jean de Morainville en 1590 !
Le petit-fils de Jean de Blneau participe la "guerre folle" du ct du roi, ce qui ne l'empche pas de cultiver les Valois-Orlans dont le chef, Louis, devient roi par l'accident de Charles VIII (1498). Blneau nomme Franois son premier fils, le seul en dix gnrations de Courtenay, n (1495) un an aprs celui d'Angoulme, alors que rien ne permettait de prvoir que les circonstances donneraient la couronne celui-ci (1515). Le jeune Blneau, enfant d'honneur (apprenti
page) de Louis XII, fut
lev la Cour avec
son frre Esme (Edme). Lorsque Franois Ier part la conqute du Milanais, il lui donne de quoi faire son quipage et l'arme chevalier Marignan, sur le champ de bataille. En 1527, notre Franois pouse Marguerite de la Barre le plus riche parti de son temps. L'anne suivante le roi le fait bailli, capitaine et gouverneur dÕAuxerre, contre, dit-on, une
grande
somme de deniers. Lorsque le roi se remarie (lonore de Habsbourg, 1531), Franois est panetier
de la reine. Rest en faveur sous Henri II, il meurt trois ans avant lui, en 1556, laissant de son second mariage (1547), un fils, Gaspar, que son bas-ge, la mdiocrit de ses biens et les troubles dans le royaume empchent
de tirer parti de la position de son pre. C'est ce Gaspar qui, cinquante ans plus tard, prsidera la premire requte (1603), en tant que chef de la Maison.
Entre temps, trois choses se sont produites qui, lorsque l'occasion poussera les Courtenay revendiquer, leur fourniront tout la fois le moyen, la raison, et l'exemple.
Le moyen, la raison, l'exemple
Le moyen : la gnalogie des Courtenay tardifs a t valide (i) ; la raison : le rang suprme des Princes du sang a t fix (ii) ; l'exemple : l'avnement de Henri IV semble attester que le sang se rit des sicles (iii).
Si les lys sont connus comme fleurs sans pines, ceux des Courtenay en ont, comme le note Gibbon : leur
gnalogie, au lieu dÕtre enregistre dans les annales du royaume, ne peut tre vrifie que par les recherches pnibles des gnalogistes. Comme,
de
plus, la longueur de la priode multiplie les incertitudes, leur issuance restera toujours contestable. Au contraire, les Bourbon, au cours des sicles, sont rests grands et actifs, avec des biens considrables et des alliances prestigieuses au point que, mme si Henri III ne dclarait pas Navarre premier prince du sang, la lgitimit de sa position successorale resterait indubitable. C'est la personne de Henri qui est rcuse, pas le droit des Bourbon, comme l'attestent les Liguards eux-mmes en prenant pour roi le cardinal Charles I, un autre Bourbon, oncle de Henri (Charles "X"), ainsi que les manÏuvres du cardinal Charles II, cousin de Henri. Quoique leur habilet la Couronne remonte loin en arrire, elle est publique et notoire. Les difficults sont politico-religieuses, pas dynastiques.
Au
contraire
nos Courtenay n'ont pour eux qu'une tradition familiale. Les zigzags de leur descente psent moins que son obscurit. Leur gnalogie Ñau demeurant difficile tablirÑ est d'ordre priv. Il faut aller fouiller les Trsors des chartes des chteaux familiaux pour retrouver des actes (convocations l'ost ou tats de paiement, partages, contrats de mariage, cautions etc.) et, grce eux, reconstituer les liens et leur succession (cf. Annexe 2).
C'est
la
chance de nos sires que le quasi officiel Recueil
des Rois de du Tillet les authentifie.
Les Commissaires dsigns par Franois Ier (1539) pour inventorier et mettre jour le Trsor des chartes du royaume ayant chou, le roi (1541) confie le travail Du Tillet, greffier en chef du Parlement de Paris, alors soutenu par le chancelier Poyet. Le greffier du Parlement devient celui de la Royaut. En 1548, il est reconduit par Henri II dans sa fonction d' "antiquaire royal", pour fournir au roi les informations et les preuves dont il a besoin. En particulier, Henri II le charge de rassembler plusieurs choses mmorables pour l'intelligence de l'estat des affaires de France, savoir la gnalogie des Rois et l'Ordre du Royaume. Justifi par les Registres que l'auteur a consults dans le Trsor des Chartes, le sminal Recueil des Rois (1555) sera copi et recopi par les historiens et gnalogistes ultrieurs. Il ne s'agit pas d'une liste des rois comme il y en a eu depuis le XIIIe sicle (Lamarrigue, 1999) mais d'un catalogue de la famille royale.
Le chapitre ddi Louis le gros inclut un paragraphe sur les comtes de Dreux, un sur les Dreux de Bretagne et un sur la branche de Courtenay. L, quelques pages trs denses, voire confuses, balaient la descente de Pierre, fils de Louis le gros, et, notamment, la branche de Robert de Champignelles qui dure encore en la personne du contemporain Franois de Blneau (dj rencontr) et de ses fils, encores mineurs d'ans, les futurs solliciteurs, Gaspard de Blneau et Jean des Salles (d. 1580, p. 90). Voil leur origine certifie !
En effet, l'autorit de du Tillet est absolue jusqu' l'Histoire gnalogique de la maison de France des frres Sainte-Marthe (1619). Il
rcuse
les fables et n'admet en foy d'histoire que les chartres, tiltres & autres lieux autenticques marqus & datts... auxquels lui seul a accs.
Cependant,
nous,
nous ne saurions nous contenter de cette proclamation. Nous ne pouvons exclure ni la complaisance, ni l'erreur ou l'tourderie car, loin de "laisser les textes crire l'Histoire", du Tillet jongle avec les archives (lesquelles, au demeurant, taient dans un tat matriel lamentable). Par exemple, il arrime les Saint-Simon aux comtes de Vermandois carolingiens en modifiant un document postrieur d'un bon sicle la dpossession de Eudes l'insens (Boislisle, 1879, p. 385). A partir de l, les gnalogistes aux gages travailleront si bien que le petit Claude de Rasse fera reconnatre par le Roi, dans les lettres d'rection du duch-pairie de Saint-Simon (1635), qu'il est issu en ligne directe des comtes de Vermandois. Un exemple suivre !
Le Recueil des Rois, quoique non imprim, est largement connu : du Tillet en a solennellement offert le manuscrit Henri II, puis Charles IX en 1566, ce qui en a diffus le contenu la Cour, et des copies ont circul. Aprs sa mort (1570) le Recueil connat deux ditions subreptices en 1578 (trois, en incluant la traduction latine imprime en Allemagne), puis, par permission de Henri III, une premire dition licite en 1580. De plus, en 1579, parat la compilation de Belleforest (Les Grandes Annales et histoire gnrale de France) qui emprunte ses Courtenay du Tillet (Livre 3, Chap. XLV).
Pour la premire fois, le chemin est trac et balis, de Louis le gros aux Blneau contemporains. Les voil fleurdeliss. Juste au bon moment.
La royaut consolide par Philippe Auguste, ses premiers successeurs (Louis VIII et IX), commencent distinguer leurs fils en les levant au-dessus des grands seigneurs.
Une gnration aprs Philippe IV le bel, l'absence d'hritier mle teint les Captiens directs et une ligne collatrale accde au trne (Valois, 1328) et le conserve, non sans difficults ("guerre de cent ans"). Maintenant, les cousins comptent : seigneurs du sang, ils sont successibles et, de ce fait, participent de la Couronne.
Au XVIe, le proto-absolutisme magnifie le sang royal que la disparition de la plupart des branches issues de S. Louis rend plus rare. La grandeur des Guise excite la revendication identitaire des Princes dont le rang est la manifestation et le symbole. Les rois hsitent trancher les multiples conflits qui, l'occasion des sacres ou du Parlement, opposent un Bourbon-Montpensier qui est du sang Guise, Nevers et Nemours, simples Ducs & Pairs.
Par le fameux dit de dcembre 1576 le crmonieux Henri III, peine roi, rgle enfin l'ordre au sein des Pairs. Traditionnellement, le rang suivait l'anciennet de la pairie, mais les Princes excipent du lien insparable qui les unit au Roi, n'tant ensemble qu'un corps et un sang. L'Edit leur accorde la prsance et les hirarchise selon leur proximit la Couronne. Loyseau le formulera ainsi en 1610 : les princes du sang constituent sans doute un corps part et un ordre de dignit suprme, & surpassent de beaucoup toutes les autres dignits de France (p. 84).
Le texte de l'Edit est le suivant : Savoir faisons que pour mettre fin aux procs et diffrends ci-devant avenus entre aucuns princes de notre sang pairs de France, et autres princes aussi pairs de France, sur la prsance cause de leursd. pairies, et voulant obvier ce que telles controverses et difficults n'adviennent ci-aprs. [...] Avons dit, statu et ordonn, statuons et ordonnons que les Princes de notre Sang, Pairs de France, prcderont & tiendront Rang, selon leur degr de Consanguinit, devant les autres Princes & Seigneurs, Pairs de France, de quelque qualit qu'ils puissent estre, tant s Sacres & Couronnement des Roys que s Seances des Cours de Parlement, & autres...
La suprmit du groupe royal suscite l'envie de s'y agrger. La dernire Courtenay crira dans son Mmoire au roi de 1737 (cf. infra) : Jusques-l, la Maison de Courtenay n'a eu aucune dmarche faire, parce que jusques-l elle n'a eu aucun Rang prtendre... L'Edit d'Henry III n'eut pas plutt paru, que la Maison de Courtenay se crut en droit de participer aux honneurs et aux prrogatives attachs aux Princes du Sang...
Si Gaspar, le fils de Franois de Blneau, se trouva trop dmuni pour affirmer son droit au milieu des troubles du royaume, quand des Guisards "carolingiens" traitaient les Captiens d'usurpateurs, tandis que des Rforms contestaient la monarchie dans son principe (monarchomaques), comment, prsent, nos sires, authentifis par du Tillet, ne se sentiraient-ils pas inclus dans cette "figure collective" de la Royaut ?
Pierre, le fils cadet de Louis VI ne fut rien car, sauf l'an-successeur, les fils de roi n'avaient aucune qualit propre. Maintenant que les Princes de la couronne sont constitus et institus, que leur dignit suprieure resplendit, assortie d'immenses privilges, Pierre est aspir rtroactivement, transformant ses descendants vivants en Princes potentiels. Il suffit de mettre le bton carr dans le trou rond pour inscrire les Courtenay prsents dans l'ordre royal. Le moment viendra de le tenter quand ils croiront voir dans le couronnement de Henri IV un reditus aux Captiens directs, aprs la longue parenthse Valois.
Malgr l'incise de du Tillet (qui dure encore), la crise de succession ouverte par l'extinction des Valois, aprs la mort d'Alenon (1584) et l'assassinat de Henri III (1589), ignore videmment Gaspar, tandis que s'affrontent le jeune duc de Guise, les deux cardinaux de Bourbon, le roi de Navarre, les fils de Louis de Cond (le Cardinal de Vendme et le comte de Soissons), et que les Espagnols, trs actifs dans la lutte des factions, revendiquent la couronne pour l'infante Isabelle, petite-fille de Henri II (Mousset, 1914).
Gaspar ! De quoi aurait-il l'air dans ce chaos que les plus habiles et les plus forts chouent ordonner depuis des annes ? un cavalier dans une bataille de chars ! un parapluie dans un tremblement de terre ! une boue non gonfle dans une ruption volcanique ! Rdhibitoire. Gaspar qui ? Gaspar combien ? En tant que personnes, les Blneau sont peu connus. En tant que maison royale, ignors. En tant qu'acteurs politiques et militaires, inexistants. D'ailleurs, loin de manquer de prtendants, il n'y en a que trop !
Mais, aprs le couronnement de Henri IV et la pacification du royaume, les Blneau-Chevillon se comparent au Bourbon dsormais rgnant. A l'origine des premiers Bourbon (resp. premiers Courtenay), un Aymard du Xe sicle (resp. Athon). Ces Maisons finissent en quenouille : Batrice de Bourbon (resp. Isabeau de Courtenay). La grenouille se transforme en princesse par le baiser d'un mari royal : Robert de Clermont, fils cadet du Roi Louis IX (Pierre, fils cadet de Louis VI), pouse Batrice (Isabeau) et, par substitution, devient Bourbon (Courtenay).
Aymard... Batrice × Robert, fils de Louis IX = Bourbon royaux
Athon... Isabeau × Pierre, fils de Louis VI = Courtenay royaux
Si, en 1598, la lgitimit du successeur remonte aussi loin que le XIIIe sicle et aussi haut en amont de la gnalogie royale, pourquoi exclure le XIIe ?
En effet, tant l'Edit de Henri III que l'avnement de Henri IV illustrent la transcendance du sang royal. Le Bourbon, aussi distant soit-il du dernier roi, partage le mme sang, d'une telle excellence qu'il absorbe et dissout tous les sangs collatraux qui s'y sont mls au cours du temps. Puisque ce sang sacr est perptuel, le droit de nos sires doit tre reconnu. En un sens, ils ont raison. Loyseau dira, aprs Balde : hrite de la Couronne le dernier parent le plus proche, ft-ce au millime degr ! Les Courtenay rsiduels, sduits par cette illusion, se seraient peut-tre contents de la caresser et de s'en flatter si, en 1602, le zle d'un Commissaire dput pour la recherche de la noblesse de l'Election de Melun n'avait pas manqu
de respect [leur] naissance.
En effet, au dbut de son rgne (1598), Henri IV ayant appris que durant les troubles il s'tait fait quantit de faux Nobles qui s'exemptaient de la taille, il ordonna qu'il en serait fait recherche (Prfixe, 1662). Un Commissaire assigne donc Esme (Edme), le fils an de Gaspar, communiquer ses titres de noblesse. Edme rpond qu'il n'a rien justifier, puisque d'extraction royale. Incrdule ou obstin, le Commissaire le poursuit devant la Cour des Aides qui l'oblige satisfaire la preuve comme les autres gentilshommes. Gaspar se plaint au Chancelier qui rprimande la Cour et annule la procdure. Mais, craignant l'insolence des magistrats, nos sires cherchent s'en protger pour l'avenir en obtenant une attestation publique de leur tat royal. C'est la demande solennelle au roi de les reconnatre pour Princes de la Maison de France (15 janvier 1603). Le moment parat propice car, jusqu' 1601 (naissance du premier hritier), le roi se trouvait fragilis ; il devait maintenir lÕcart les princes du sang qui risquaient de servir de caution aux mcontents et de leur paratre des successeurs ventuels. Dans ces conditions, lÕappartenance la famille royale pouvait sembler un handicap (Jouanna, 2022).
Requtes au Roi
Libellus Supplex Regi oblatus Dominis de Courtenay, 15. Ianuarij 1603, sic signatum: Gaspardus, Jacobus, Ioannes, Renatus, Ioannes. La requte est assume, dans l'ordre, par 1) l'an de la maison ane, Gaspard (Gaspardus) de Blneau ; 2) celui de la maison cadette, Jacques (Jacobus) de Chevillon ; 3) le frre de Gaspard, Jean des Salles (le premier Ioannes) ; 4 & 5) ceux de Jacques, Ren (Renatus), abb des Eschalis, et Jean de Frauville (le second Ioannes) que la mort de Jacques en 1617 fera Chevillon.
Dernier de la liste, ce Jean est le moteur de l'entreprise : il servit le roi Henri IV dans ses guerres, depuis le commencement de son rgne jusqu' la paix de Vervins : ce fut celui de toute sa famille qui agit avec plus de vigueur durant plusieurs annes pour obtenir le rang d leur naissance (Moreri, 1718, T2, p 589). C'est lui, plus tard, qui passera en Angleterre avec son cousin Jean des Salles, croyant obtenir par Cond ce que le roi refuse.
Le texte de 1603 affirme
leur
appartenance la Maison de France, honneur
que la nature leur a donn par le droit de naissance, garanti par la Loi de ce royaume et l'ordre
perptuel de cet Etat. Ils supplient le roi d'avoir
pour agrable qu'ils lui puissent reprsenter leur naissance et l'tat de leur fortune indignement abaisse et comme touffe.
Reconnaissant que V.M. sait beaucoup mieux qu'eux-mmes ce qui est convenable la dignit de la maison de France de laquelle ils ont l'honneur d'tre, ils demandent la permission de reprsenter leur naissance mais, dans le mme temps, l'nonc est performatif puisqu'il proclame leur royalit : ils ne sollicitent pas une faveur, ils requirent de la bont droiturire de Sa Majest la rparation d'une injustice.
Ils placent le roi devant une alternative indcidable : ou bien, nous considrer comme imposteurs et nous punir, ou bien nous reconnatre. La hache ou les lys ! Tout le monde alors se souvient de Franois de La Rame, excut (1596) pour s'tre prtendu fils de Charles IX. L'exemple (quoique trs particulier) sera abondamment utilis dans l'argumentation ultrieure.
Le chancelier leur dit qu'ils ne devoient point presser le roi sur cette affaire ; que leur qualit tait assez connue, & que leurs pres s'tant contents de la situation o ils se trouvoient eux-mmes, ils ne devoient point aspirer de plus grandes prrogatives. Cette rponse ne les satisfit pas; ils rpondirent que si leurs pres n'avoient rien demand, c'est que personne ne s'toit avis de contester leur tat... (Recueil de pices sur la maison de Courtenai, imprim Paris en 1613).
Voil nos Courtenay passs l'action. Nous verrons leur ambition soutenue (stimule ?) par de grands personnages qui, par eux, donneraient une couleur captienne leur ascendance : Sully et Richelieu, appuys sur les "preuves" et pangyriques dont fait commerce l'historiographe Du Chesne, aussi accommodant qu'inpuisable. Ces patronages ne suffiront pas mais leur donneront une posture de "mconnus" dont ils sauront tirer profit.
La requte de janvier 1603, intercepte, gare ou ignore, est ritre un mois plus tard, puis nouveau en dcembre, et encore aprs, l'initiative de Jacques de Chevillon, pouss par son frre Jean. Jacques avait particip aux guerres catholiques (sige d'Issoire en 1577, sige de la Fre en 1580) et, gentilhomme de la chambre du Roi Henri III, il aurait dj essay de le convaincre. Son pre, Guillaume, ( 1592) a t le premier mler sur son tombeau dans l'glise de Chevillon les armes de France et de Courtenay, avec l'inscription ci-gt illustre seigneur de sang royal.
Le Conseil du Roi examine la requte le 6 fvrier 1604 et ne dcide rien. Nouveau mmoire, nouvelle remontrance au Roi (7 janvier 1605). Nos sires obtiennent et rassemblent les avis des jurisconsultes de toute l'Europe (1607, De Stirpe) et, sur cette base, prsentent une nouvelle requte le 22 janvier 1608. Le chancelier (Silleri) l'adresse au Procureur gnral pour avis des avocats gnraux au Parlement. Aprs le rapport du Chancelier au Roi, les Courtenay sont aviss de laisser l leur affaire. La porte leur claque au nez.
Nos sieurs, ulcrs, menacent de se retirer hors du royaume. Le Chancelier comprend qu'ils rejoindraient une Cour trangre o, protestant de leur dignit mprise et de l'injustice subie, ils recevraient le soutien de tel ou tel comptiteur externe ou interne (comme il adviendra en 1614) ; au lieu d'touffer l'affaire, l'exil l'aggraverait. Aussi le Chancelier se calme et les calme. Il promet de prsenter nouveau leurs observations au Roi : nouveau mmoire, nouvelle remontrance (14 juin 1608). Le Roi s'abrite derrire l'importance du cas pour le renvoyer un Grand Conseil solennel o opineraient les Princes, les Prsidents du Parlement et plusieurs personnes notables, Grand Conseil qui ne se runira jamais. Que ceux de Courtenay, [disent les malveillants] soient du sang royal, qu'ils soient de la maison de France tant qu'ils voudront, mais qu'ils ne soient point reconnus.
Regardons de plus prs ce De stirpe qui constitue leur artillerie lourde.
De stirpe et origine Domus Courtenay (1607)
Pour combattre les hsitations du Roi et les manigances de leurs ennemis, nos sieurs, ds le dbut, se sont attachs un des fils de du Tillet, Elie (Discours sur la gnalogie et maison de Courtenay: issue de Louys le Gros, sixiesme du nom, Roy de France, Paris 1603 ; Reprsentation du mrite de l'instance faicte par Messieurs de Courtenay pour la conservation de la dignit de leur maison, 1603).
Dans le recueil de 1607 dont l'diteur est Castrain (L'Estoile, d. 1881, T.9, p 67), un homme de lettres tout faire, nos sieurs prennent l'Europe entire tmoin en s'adressant elle dans sa langue commune, le latin. Non sans efforts ni dpenses, ils se font approuver par vingt professeurs et jurisconsultes trangers, de Bologne Heidelberg, en passant par le Danemark, qui, la plupart docteurs in utroque jure, rdigent (ou signent) une srie d'arguments bibliques et romains. Ce spicilge de plus de mille pages, imprim in-8o Paris, empile les justificatifs : De stirpe et origine domus de Courtenay quae coepita Ludouico Crasso huius nominis sexto Francorum Rege Sermocinatio - Addita sunt responsa celeberrimorum Europae Iurisconsultorum (Discours sur les racines et origines de la maison de Courtenay qui commena Louis le Gros, sixime roi des Francs - avec les rponses des plus clbres jurisconsultes d'Europe), redoubl d'un "mmo" d'Elie du Tillet pour le Grand Conseil : Reprsentation du procd tenu en l'instance faicte devant le roy par Messieurs de Courtenay pour la conservation de l'honneur de leur maison & droit de leur naissance. Ensemble les noms des docteurs & iurisconsultes qui ont est consultez sur ce subiect auec un resultat abreg des advis qu'ils en ont donn, Paris, 1608.
Le De stirpe se compose d'un discours introductif d'environ 200 pages, suivi des consultations, chacune foliote part. Les 19 premires, entre 10 et 30 pages, proviennent principalement d'Italie, sans que nous sachions quelle est l'autorit et la notorit de leurs auteurs. La vingtime compte 298 pages ! Allant dans tous les recoins de la discussion, ce vritable trait a (aurait ?) pour auteur Dionysius Gothofredus, primaris juris professor Heidelbergae. C'est Denys I Godefroy (1549-1622) : docteur en droit de l'Universit d'Orlans et converti la Rforme, il migre Genve en 1579 o il ouvre un cours de droit. Il est clbre pour son dition commente de la codification de Justinien (Corpus juris civilis). En 1600, alors que Henri IV en fait l'un des six conseillers protestants au Parlement de Paris, il prfre se laisser attirer Heidelberg par l'lecteur palatin. S'y dplaisant, il rejoint l'universit de Strasbourg, alors foyer de lumires et de vertus. En 1604, Henri IV lui propose vainement la chaire de droit romain vacante Bourges depuis la mort du grand Cujas. Il choisit de retourner Heidelberg. Ce spcialiste reconnu, ami et cousin du Prsident De Thou, jouit de l'estime du roi. Son nom a du poids.
Voyons rapidement les trois parties de ce de stirpe : l'introduction, les 19 consultations et celle de Godefroy.
* Le rdacteur (Castrain) lance un dfi (p. 111) : Si falso, puniendum; si vere, non negandum (si c'est faux qu'on nous punisse, si c'est vrai, qu'on cesse de nier). Le Roi ne peut ni l'un ni l'autre. Et, bientt, les Courtenay apprendront tirer parti de ce dilemme.
L'introduction reprend les suppliques prcdemment adresses au Roi et rcapitule les dmarches effectues. La partie dmonstrative, base sur le Recueil de du Tillet pour la gnalogie, reprend les principaux arguments en faveur des Courtenay. Le fructueux parallle avec la maison de Dreux est dvelopp en dtails, et leur changement de nom discut l'infini : Pierre et Robert, les deux fils cadets de Louis le Gros, sont tout aussi royaux que l'anctre des Bourbon, le sixime et dernier fils de St Louis, Robert de Clermont ; seulement, ce dernier, quoique devenu Bourbon par son mariage avec l'hritire de cette Maison en 1272, a maintenu sa "royalit" en gardant les fleurs de lis dans ses armes. Rsultat : aujourd'hui ses descendants rgnent, tandis que, faute de cette prcaution, la royalit des Dreux et des Courtenay s'est dissoute. Pourtant, leur changement de nom et d'armes ne devrait pas compter : lorsque quelqu'un acquiert une terre (achat, hritage, mariage, don), il la prend en surnom. D'innombrables exemples l'attestent. Le "surnom" initial finit par servir de nom aux descendants (mme si, comme nos Courtenay, la terre toponymique leur chappe). Ces surnoms ne signifient rien, seules les qualits importent (fils an de..., fils de..., frre de..., unique hritier de..., hritier de..., seigneur ou dame de...) et elles ne se perdent pas quand le nom change. Il s'ensuit que la transformation de Pierre, fils de Louis VI, en sire de Courtenay ou de Robert en comte de Dreux n'a pas affect leur essence. On peut donc les nommer rtrospectivement Pierre ou Robert de France.
Plus subtilement, la rfrence Dreux rehausse Courtenay par ricochet. Puisque les Maisons de Dreux et Courtenay ont le mme sort, la premire parle de la seconde. Or, avant que, la fin du XIVe sicle, la Couronne rachte leur comt, les Dreux ont appartenu au Conseil des Pairs, jou un grand rle, rgn sur la Bretagne, et les chroniques mentionnent leurs hauts faits (et mfaits). Les Courtenay ressemblent aux Dreux, la chance en moins !
Voyons maintenant les consultations des docteurs.
* Quoique diverses, toutes postulent l'origine royale des Courtenay, prouve par les historiens (du Tillet), l'opinion commune (fama), et les monuments (tombeaux etc.). La discussion porte sur les droits qu'elle confre. Le thme principal des auteurs est que le sang ne se perd pas. Il se conserve in perpetuum, in infinitum : travers les gnrations, le sang royal coule toujours et continuellement de l'une l'autre (Nam jus sanguinis & consanguinitatis Regiae, de quo agitur, semper & continuo fluxit ab uno in alium, avis N¡7, p 5). Que le sang vienne de loin, voire de trs loin, il n'en est pas moins royal (ut si remotus, imo remotissimus, tamen Regius est, avis N¡20, p 253). Qu'il n'ait pas t revendiqu avant ne compte pas, le silence (taciturnitas) ne disqualifie pas, parce que le sang et la nature sont perptuels (propter sanguinis perpetuitatem & naturae, avis N¡15, p. 11 sq.) : que pendant longtemps on ne pche pas dans une mer, n'empche pas de lancer son filet un jour (etc.). Quiconque possde un droit peut le rclamer.
* Le long factum de Godefroy se divise en trois parties :
I. Le sang est-il prouv? (32 pages) : oui.
II. Qu'apporte-t-il ? (50 pages) : tout.
III. Rponses aux objections (207 pages) : en vrac, il y en a vingt (dont plusieurs redondantes) qui reoivent une attention variable, la plus farfelue (la 4e) tant longuement traite :
1. ils n'ont pas port de noms ni d'insignes royaux (nomen non ferre), 2 pages
2. ils n'ont rien dit jusqu' prsent (silentium), 10 pages
3. ils s'appuient sur de faux titres (falsos titulos), 3 pages
4. exhrdation par S.Louis pour refus de la rversion des apanages, 34 pages
5. praescriptionem & non usum, 38 pages
6. comme leurs anciens, ils doivent s'en tenir une vie prive et s'abstenir de revendiquer, 14 pages
7. principis nomen, gradum & titulum jamais uss jusqu' maintenant, 13 pages
8. leurs anctres n'taient pas tenus pour princes, 14 pages
9. on ne peut leur attribuer la qualit royale car le sang royal est natif, pas datif (Fieri regis agnati non possunt: debent enim nasci, non fieri), 2 pages
10. la Couronne n'a pas besoin des Courtenay, 5 pages
11. il n'est pas opportun de reconnatre de nouveaux princes (novos enim principes agnosci, non expedire), 5 pages
12. la simple noblesse leur suffit (maneant itaque nobiles tantum, nec principis titulum illustrem affectent), 12 pages
13. paupertas, 14 pages
14. leur origine est trop ancienne (vetustior), 3 pages
15. leur sang est trop lointain, 7 pages
16. on ne manque pas de princes et cela coterait trop cher d'en ajouter, 16 pages
17. leur reconnaissance serait dommageable pour la chose publique, 3 pages
18. l'intrt de l'Etat prime celui d'une famille (utilitatis publicae potius habenda est ratio, quam unius duntaxat familiae), 12 pages
19. en Angleterre et en Castille, on reconnat la naissance royale sans attribuer de ressources, 4 pages
20. les Courtenay n'ont pas t capables de protger leurs possessions, 1 page.
Sans qu'on sache quel intrt Godefroy prend au cas, la dernire phrase de la conclusion est celle qu'on attend (p. 298) : Tout cela ainsi pos, dduit et prouv, il faut conclure selon le jugement des experts : Que les seigneurs de Courtenay, ayant prouv leur origine royale par des moyens lgaux, doivent tre dclars et reconnus comme princes du sang royal, afin qu'ils puissent jouir des titres, rangs et honneurs de la reconnaissance royale malgr les allgations de leurs adversaires.
His omnibus ita positis, deductis, et probatis (saluo tamen quod dici solet, peritiorum judicio) videtur concludendum; Dominos de Courtenay agnationem suam regiam modis legitimis comprobasse, regis sanguinis principes dclarandos et agnoscendos esse, ut titulis, gradibus, et honoribus agnationis regiae fruantur: non obstantibus adversariorum allegationibus in hac controversa deductis.
Une affaire de grande consquence
Le Roi ne se laisse pas impressionner par Godefroy. Il n'accepte ni ne refuse une requte dont il regrette l'existence et qu'il voudrait oublier. S'il n'est pas sourd au cri du sang, la navet de celui-ci heurte l'volution institutionnelle et "iconique" de la royalit. Le sang royal de nos sieurs est appauvri : ils ne sont pas Bourbon, leur anctre ne naquit pas Prince puisque la position n'existait pas, ils n'ont rien excut depuis qui aurait manifest la vertu de leur sang. Ils ressemblent une vieille pice romaine en cuivre : on s'incline devant sa raret, elle n'a pas cours et ne vaut rien en tant que monnaie. En outre, promouvoir une Maison pauvre serait coteux : pour ne pas dshonorer la Couronne, il faudrait les mettre en capacit de tenir leur rang, donner pensions, provinces, charges etc., suscitant ainsi des jalousies, le tout inutilement puisque la Couronne ne manque, alors, ni de fils ni de princes du sang.
On comprend aisment que le Roi n'accepte pas cette requte venue du fond des temps, on s'tonne qu'il ne la rejette pas. Certes, Henri IV prfre promettre et ne pas tenir plutt que refuser, sachant que les cadeaux esprs rendent plus fidles que les cadeaux reus. Et quant au fond, le Roi ne peut ni dnier son sang ni avouer le leur : ces gens ne comptent pas, ne reprsentent rien, ne psent rien en termes de pouvoir, de biens, d'influence, de places fortes, de commandements, de rseaux et d'alliances trangres. Moiti par force, moiti par rhtorique, ils l'avouent ds la premire requte : les armes, les forteresses, les partisans qui accompagnent cette juste requte sont la juste confiance qu'ils ont de votre bont & justice, l'humble submission... & les trs humbles supplications que la Loi perpetuelle de votre royaume vous prsente pour eux...
Et, surtout, pense et dit le Roi, cette petite affaire est de grande consquence.
D'abord, voil une novelet. Jamais un tel "procs en paternit" n'a t ouvert (et jamais il ne le sera). Ces sieurs sortis de l'ombre demandent tre reconnus pour se faire connatre ! Et derrire eux, combien de rejetons oublis de branches teintes vgtent-ils dans les marges des arbres gnalogiques ? et, parmi ceux-ci, combien d'inavouables ? combien de redoutables ?
Le sang ! Quel sang ? Le sang royal est Bourbon (et le sera de plus en plus). Et le sang ne fait pas tout. La nature ne suffit pas. L'infertile Henri III n'a pas os transmettre la couronne son favori, fils btard de son frre Charles IX, Charles d'Auvergne, qui, plus tard paiera cher sa participation au complot d'Entragues (1604) visant promouvoir la royalit du fils de Henri IV et Catherine, le petit Henri Bourbon-Verneuil. Si Henri IV lgitime ses btards et leur accorde honneurs et prminences, ils sont fils du roi, non pas fils de Roi. Le mieux nanti, Csar Monsieur, duc de Vendme, se verra accorder (15 avril 1610) un rang intermdiaire, au-dessous des princes du sang, au-dessus des ducs-pairs et princes trangers.
Nos sieurs ont quelque chose de suspect. Quand bien mme on admet leur descente, les malheurs et la longueur des temps ont abtardi leur sang. Ils ne peuvent tre relevs que par une espce de lgitimation. On ne peut se contenter de les appeler "cousins" et de leur donner quelques cadeaux car les droits privs ne se dissocient pas des droits publics : tout vrai cousin royal relve de la Couronne. Or la gestion des Princes du Sang constitue une gageure, on ne cesse, on ne cessera de le constater. Il en faut pour alimenter le rservoir de successeurs qui garantit la continuit de l'Etat. Mais ce rservoir bouillonne et dborde trop souvent. Leurs droits constitutionnels chauffent les successibles et transforment les frres du Roi, le dauphin, les cousins, en comptiteurs. S'ils n'y pensent pas d'eux-mmes, des malcontents brandissent leur drapeau contre le Roi rgnant. Toute l'histoire de France montre et montrera que ce mal ncessaire reste un mal. Alors l'empirer ? en rajouter ? Le premier effet sera de mcontenter les autres.
Et de quelle autorit en rajouter ? Lorsque, en 1571, Charles IX a "reconnu" le Duc de Longueville, ce descendant du grand Dunois, ce fut en tant que Prince du Sang de la Maison d'Orlans, prenant rang aprs les Princes du Sang de sadite Majest. Le Roi dclare que, l'ayant trouv au rang des Princes, il ne pouvoit lui ter cet honneur. Inversement, il n'aurait pas pu le lui donner. Aprs l'assassinat de Henri III, on a vu les Guise, presque rois, dbouts par les droits des Princes du Sang qu'ils ne pouvaient pas devenir car cet tat n'est pas "datif". Les souvenirs de la Ligue sont encore vifs, les Guise toujours l, toujours puissants, la Lorraine "carolingienne" toujours entre France, Empire et Espagnols.
L'Estoile attribue ces dangers la prudence de Henri IV : ils [les Courtenay] ont j fait par plusieurs instances et requestes. Lesquelles, combien que Sa Majest ait acceptes et trouves raisonnables, si n'en a-il encores rien dclar ni prononc, les prtentions de ceux de la maison de Lorraine, qui ont tant suscit de remuemens et brouillis en son Roiaume, le retenans de faire justice ces seigneurs (Mmoires-journaux, d. 1881, T9, p 67 propos du De stirpe).
Contre Guise, mais la suite d'une longue cristallisation, s'est impos le "mythe historique" des descendants de St Louis (dont les Bourbon sont les derniers). Le sang lignager vient de Hugues "Capet", le sang divin de St Louis (cf. conclusion). Reconnatre les Courtenay ferait sauter ce verrou.
Capet demeure le gnant anctre, l'aventurier que tout le travail d'image de la royaut depuis Philippe le Bel a consist estomper. Et voil que, comme des chiens fous, nos sieurs dboulent dans ce jeu de quilles enfin ranges, criant "et nous ?", "et le Gros !" et "Capet !". Ne voient-ils pas que Jean-Baptiste n'est pas Jsus ? qu'il ne faut pas confondre le prophte et le messie ? les prcurseurs et les descendants ? Nos sieurs viennent comme le souvenir douloureux d'une jambe ampute. Ils portent avec eux l'usurpateur captien qu'on cherche oublier. On comprend que l'affaire de nos sieurs apparaisse de grande consquence. N'ouvrons pas cette bote, nul ne sait ce qui en sortirait, aujourd'hui et plus tard.
Ces raisons de fond sont amplifies par une circonstance : Sully soutient la prtention des Courtenay dans l'espoir de se rehausser lui-mme. Or, si le roi a besoin de lui et l'appelle parfois mon ami, il ne souhaite pas transformer en cousin ce ministre dont les ambitions dmesures l'inquitent.
Quel rapport entre Sully et Courtenay ? En 1583, Maximilien, alors pauvre guerrier huguenot vivotant avec ses frres de la maigre terre de Rosny, commence sa fortune en pousant Anne de Courtenay, dame de Bontin, elle-mme huguenote, qui sera la mre de son premier fils (Maximilien II). Dans ses Mmoires, Rosny, devenu duc et pair etc., publiera que, amoureux d'une autre, il suivit le conseil de raison de son homme de confiance qui le pousse vers Anne en lui disant : Monsieur tournez votre cÏur droit: car l, vous trouverez des biens, une extraction Royalle et bien autant de beaut lorsqu'elle sera en ge de perfection (Îconomies, 1638, d. 1664, T1, p 57).
Pour la suite, lisons Le Laboureur (Additions aux mmoires de Castelneau, Paris, 1659, T2, p 688) : Sully, restaurateur de sa maison et quasi homme nouveau, fut longtemps fixer son extraction... Ange Capel, sieur du Luat, plus clbre pour sa tmrit que pour sa doctrine, luy mit cette impression en la tte au sujet des Princes de Courtenay, dont ce Duc favorisoit les droits cause d'Anne de Courtenay sa premire femme, & fit une Genealogie pour le faire descendre de l'Ain de la Maison de Courtenay, qui nuisit dautant plus la cause qu'il protgeait, que le Roy Henry IV. qui commenoit se laisser persuader par la quantit des Titres de la Maison de Courtenay, s'offensa de sa prtention & n'en voulut plus oir parler: & ainsi pour avoir voulu mler la Fable avec la Verit par l'indiscrtion de cet Auteur, il rendit vain ce grand amas de pices justificatives dont les Princes de Courtenay espraient leur rtablissement.
2. Dfensive
Gaspard de Blneau meurt le 5 janvier 1609. Il a prpar son apothose en donnant pour instruction sa seconde pouse d'riger dans l'glise de Blneau, pour lui et la premire ( 1604), un monumental tombeau, avec leurs effigies genoux, vtues d'un grand manteau bord de fleurs de lys et doubl d'hermines, les armes de Courtenay carteles celles de France et surmontes d'une couronne releve de fleurons et de fleurs de lys L'inscription de Madame porte: ci gt Mme Eme du Chesnay, en son vivant femme et pouse du Trs Haut & Trs Illustre Seigneur du Sang Royal de France, monsieur Gaspard de Courtenay. La sienne, plus circonspecte, se limite : ci gt Trs Haut & Trs Illustre Prince Monseigneur Gaspard de Courtenay, seigneur de Blneau etc. Ce dfi posthume affiche les armes princires, combinant Courtenay et France, avec trois fleurs de lys en 1 et 4, et les trois tourteaux en 2 et 3.
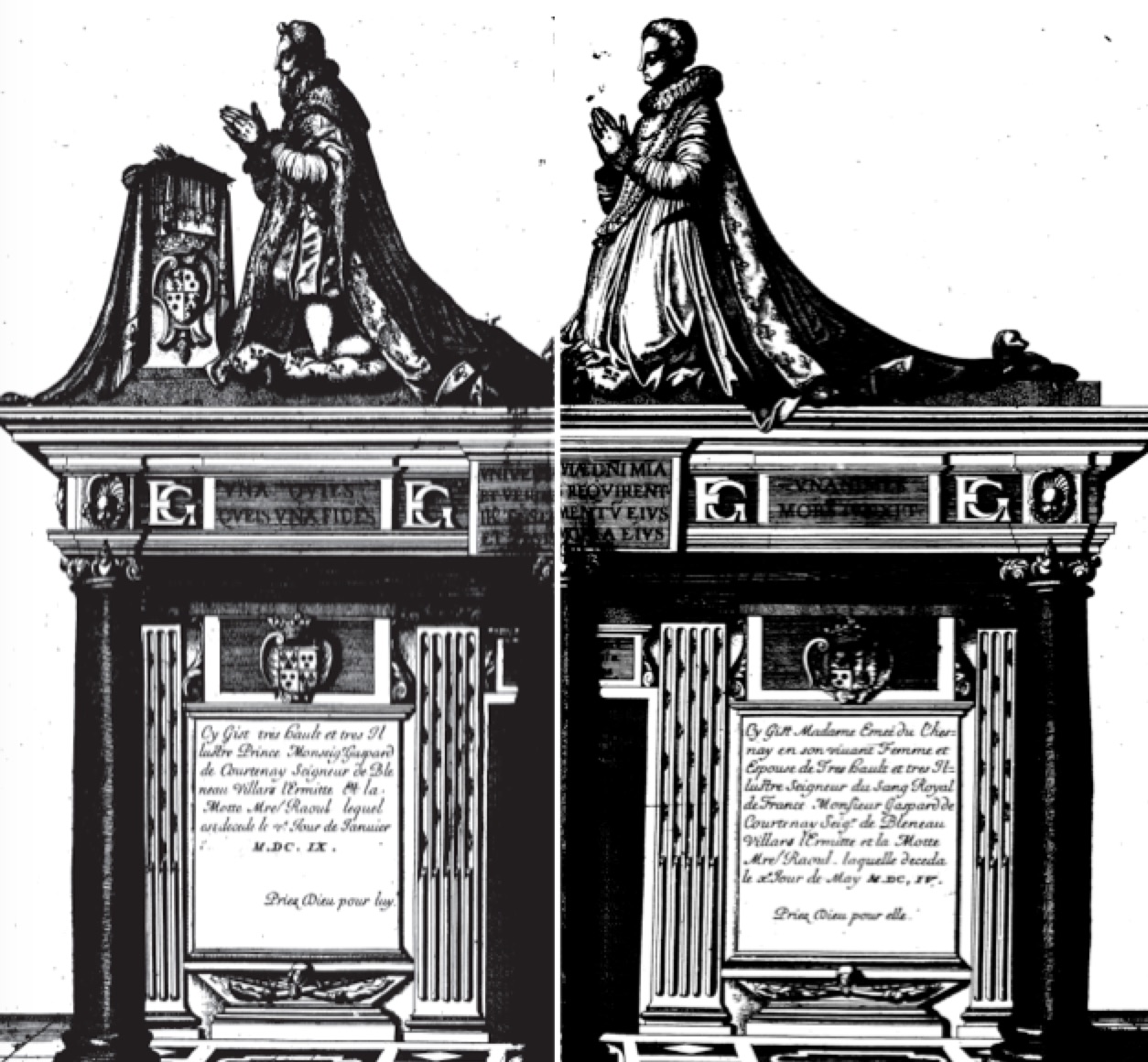
Le fils de Gaspard, Edme, lui succde comme chef de la Maison. Lass des longueurs & du silence de la Cour, il se resolut de donner quelque relache ses poursuites, puis qu'elles toient rendues inutiles auprs du Roy, par ses ennemis & les envieux de la grandeur de sa Maison, et avant que de les cesser, il presenta encore sa Majest avec son Oncle & ses Cousins de Chevillon & de Frauville, une Requte en forme de Remontrances [9 mars 1609], qu'ils luy donnerent en main propre...
Sans renoncer, ils suspendent leur action, attendant des circonstances plus favorables. Le Conseil n'ayant jamais t assembl, MM de Courtenay, las de solliciter inutilement, se dsistrent de leur poursuite sans cesser de soutenir qu'elle tait juste et lgitime. Peut-tre la mort de Gaspard clt-elle ce chapitre. Peut-tre comprennent-ils (ou les force-t-on admettre) qu'ils n'arriveront rien.
Depuis maintenant plusieurs annes, nos sieurs, Paris, sollicitent, s'agitent et dpensent beaucoup d'argent et d'efforts. Ils concluent ainsi cette Remonstrance de Messieurs de Courtenay, avec protestation de leur droit & origine par eux mise entre les mains du Roi :
Sire,
vos trs-humbles et trs obissants sujets et serviteurs ceux de la Maison de Courtenay, supplient trs-humblement V.M.... ils lui reprsentent avec toute humilit l'tat de leur condition: combien de devoirs ils ont rendu depuis six ans pour requrir sa protection et sa justice, et la ncessit laquelle ils sont aujourd'hui ports pour n'en avoir pu seulement l'obtenir l'ouverture. Dieu leur a fait cette grce [...] de les avoir fait natre du Sang Royal de France...
Ils
ont requis votre justice et votre protection pour le droit de leur Sang et de leur Origine, et pour tre maintenant en ce qui lgitimement leur appartient. Ils ont pour cet effet prsent six Requtes V.M., qu'ils ont plusieurs fois supplie d'avoir gard leur longue poursuite en laquelle ils ont continu six ans...
Et
voyant que leurs malveillants continuaient toujours de tenir votre justice en suspens pour nouveaux divertissements...
ils ont reprsent V.M. [...] que si l'on prtendait quelque intrt leur demande, ou que l'on pensait avoir quelques raisons ou moyens lgitimes selon le droit et les lois de votre royaume pour empcher la reconnaissance qu'ils requirent, il lui plt de commander que sa justice ft indiffremment ouverte...
Tout
cela ne leur ayant rapport, au lieu d'une protection assure et de la justice dont ils avaient eu confiance, qu'une perte de temps et d'y avoir consomm inutilement ce qu'il leur restait de biens, ils supplient V.M. qu'il lui plaise de leur pardonner si [...] ils protestent aujourd'hui de leur droit, et que vritablement ils ont cet honneur d'tre lgitimement issus en ligne masculine continue de pre en fils du roi Louis le Gros et, en consquence de ce, naturellement Princes de votre Sang. Que cet honneur leur est naturel, acquis et fait propre de naissance un chacun d'eux par le droit du Sang ; et que pour ce avec la mme humilit et rvrence, ils protestent de jamais ne s'en dpartir...
L-dessus, ils se retirent dans leurs terres.
Et tout rebondit quelques mois plus tard en raison de l'accident arriv en la personne de Monsieur de Courtenay Blneau sur le fait de la mort du Baron de la Rivire.
L'accident
En 1600, Edme de Courtenay fut mari Catherine du Sart, veuve de Claude de Saint-Phalle pous en 1586 (dont 3 enfants). Edme tait de dix ans plus jeune. Leur mariage produit Isabelle (1601) et Gaspard (1602). En 1609 Madame a dpass la quarantaine. On ne sait rien de sa sagesse, ni des circonstances qui l'abandonnrent au jeune Franois de la Rivire-Champlmy, ni du hasard qui permit Edme d'intervenir si vite.
Les Courtenay restant discrets sur l'accident survenu M. de Blneau, empruntons le rcit aux lettres que Malherbe crit son vieil ami Peiresc (Lettres de Malherbe, d. 1822, p 84-85) :
ce lundi 17 d'aot 1609. Il y a un nomm Courtenay-Blesneau qui a veng le cocuage cruellement. C'est un de ces Courtenay que vous savez qui prtendent d'tre dclars princes du sang...
ce 23 d'aot 1609. Je vous avois crit dernirement que le sieur de Courtenay-Blesneau avoit tu un monde de gens en sa maison; mais enfin il s'est trouv qu'il n'a tu que ce La Rivire, qu'il souponnoit d'adultre avec sa femme, et un portier qui fut un peu long lui ouvrir la porte, et lui donna la peine de la rompre. Tandis que l'on employa le temps cela, la dame descendit par une fentre, et au travers des fosss du chteau se sauva au village chez un greffier. Le galant en pensa faire de mme, mais il fut tu coups d'arquebuse dans le foss [...] Les parents du mort, qui sont grands et en grand nombre, en veulent avoir raison...
Le pre est Franois de La Rivire 1543-1610 (ou 1620 ?) seigneur de Champlmy, Lieutenant gnral pour le roi du Nivernais, capitaine de 50 hommes d'armes, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa Maison. Il a pour frre le capitaine et bailli de Sens.
Le prvt des marchaux d'Auxerre enqute et Franois de la Rivire rclame justice. Le cas pourtant simple (le dshonneur excusait l'homicide) devient une affaire car Blneau se prvaut des privilges des Princes du sang pour demander s-qualits une lettre de pardon du roi ou, dfaut, d'tre jug par la grand'chambre du Parlement, le roi sant, assist de ses princes et pairs, alors que Champlmy a saisi la Tournelle (chambre criminelle) selon la procdure ordinaire. Dans un tnbreux arrire-plan dont nous ne savons rien, amis et ennemis des Courtenay s'agitent.
S'ensuivent trois mois de procdure acclre : Blneau, soutenu par les quatre autres Courtenay, exige (du roi, du chancelier, du Parlement) des formes de justice conformes sa qualit. Il obtient un dbut de satisfaction : sur ordre du roi (22 oct.), la procdure prvtale est transmise au Chancelier qui la renvoie la Cour de Parlement.
C'est donc la qualit et non l'homicide qu'on juge. Nous n'entrons pas dans les complications judiciaires : le 30 janvier 1610 la Cour (grand'chambre, Tournelle et chambre de l'Edit runies) arrte que l'information et le jugement se feront la grand'chambre. Malgr cette concession, Blneau proteste, cause de l'oubli de sa qualit et en raison du consentement donn par la partie adverse : puisque ce droit dcoule de sa qualit, il faut expliciter celle-ci, et sa partie doit obir, non consentir.
Sa nouvelle requte excite encore les malveillants, et les gens du roi concluent brutalement que
dfenses soient faites audit sr de Bleneau de dire son origine et de s'en plus attribuer sur peine de la vie et de crime de lse-majest l'honneur et la qualit. L'arrt du 12 fvrier 1610 reprend celui du 30 janvier (grand'chambre) en l'aggravant puisqu'il ajoute : les
grand chambre, Tournelle et Edit assembles pour juger requte en annulation fonde sur ce que ledit suppliant a l'honneur d'tre du sang royal de France..., que ledit suppliant soutient qu'aucun dcret ne peut tre jug ni ordonn qu'en la prsence du roi sant la cour assist de ses princes et pairs... Ladite cour sans
avoir gard ladite requte et prtendue qualit mentionne en icelle ordonne qu'il sera procd l'instruction et jugement.
Dgot, en mars 1610, Blneau rentre la maison o le 14 avril un huissier de la Cour le relance. Il fuit : le 8 mai, dj rfugi en Flandre espagnole, Thionville, il crit au roi sur
le sujet de sa retraite hors du royaume... pour
n'tre forc de renoncer au droit et l'honneur de mon origine en m'oubliant moi-mme et ce que je dois la dignit de la maison de
France.
On s'interroge sur l'obstination de Blneau dont le roi aurait dit qu'on lui voulait faire toute grce et faveur et qu'il semblait que lui-mme la refust. Est-ce pure prsomption ? Espre-t-il obtenir contentieusement du Parlement la reconnaissance de qualit que la prudence du roi diffre ? Les malveillants l'accusent d'assassinat prmdit et couleur recherche de lui pour sur cette occasion se prvaloir de sa qualit et se faire dclarer prince du sang. Lui, retourne l'argument et dnonce l'animosit avec laquelle il tait poursuivi non pour ce qui tait du crime prtendu [mais] pour sous couleur d'icelui [...] le faire renoncer au droit de son origine. De fait, part le pre de la victime, nul ne soucie du crime.
Le roi assassin le 14 mai, l'instabilit politique subsquente ouvre de nouvelles opportunits. La retraite d'Edme ne dure que deux mois. Il rentre en France le 12 juillet avec le premier prince du sang et challenger de la Rgente, Henri II de Bourbon-Cond, l'exil volontaire, qui, pour revenir de Milan passe par Bruxelles (19 juin l610) remercier l'archiduc de son assistance. Cond rencontrant Edme reconnut publiquement ses droits et s'tablit son protecteur. Une fois Paris, Cond saisit le Chancelier qui ayant montr au commencement quelque disposition favorable... du depuis se trouva tout ouvertement loign et, pour sortir d'affaire, propose d'expdier une grce Blneau. Ce dernier s'insurge car ce n'est pas ainsi qu'on procde avec les Princes du Sang qui, le plus souvent, reoivent de simples lettres de pardon : l'on se servait de cette couleur seulement pour le forcer prendre une grce qui droget sa qualit.
Edme, alors, joue un coup difficile comprendre. Le 4 septembre 1610, pour se mettre couvert de la poursuite criminelle qui se continuait contre lui au Parlement il fut oblig de se rendre volontairement prisonnier dans la conciergerie du Palais pour se faire interroger. Curieusement, on ignore les suites judiciaires, vraisemblablement bnignes car peine en cas semblable y eut-il eu l'encontre du moindre particulier sujet ni d'accusation publique ni de peine ou amende quelconque criminelle. Mais l'essentiel reste en suspens : on
ne pouvait prononcer sur sa qualit sans l'avoir examine, ni l'en dbouter dans les formes sans le dclarer criminel de lse-majest comme imposteur, puisque ceux qui se disent Princes du Sang et ne le sont pas, mritent d'tre punis du dernier supplice.
En effet, nos Courtenay ont obtenu un rsultat, mme ngatif. S'ils ne sont pas reconnus, on ne leur interdit pas de prtendre. En sept ans, ils ont transform une lgende familiale en cas public, mme europen via les ambassadeurs. A Paris, tous ceux qui comptent le connaissent et beaucoup s'en sont mls, pour ou contre. En outre, nos sieurs croient pouvoir compter sur Cond, pour transformer l'essai.
La plupart des citations prcdentes proviennent d'un recueil sur la Retraite de MM de Courtenay hors du royaume en 1614. Ce manuscrit conserv la BNF (MS Courtenay. Franais 2759) combine documents (lettres officielles, requtes, arrts) et commentaires qui, soigneusement titrs et sous-titrs, dveloppent l'argumentation des Courtenay. Malgr quelques personnalits, leur dfense se veut de principe. Elle repose sur ce syllogisme : "les historiens" attestent que nous sommes du sang royal ; or les Princes de la Couronne jouissent de privilges qu'on nous a dnis ; donc, en nous, ils ont t attaqus, avilis, et l'Etat affaibli.
Donnons un chantillon :
* Apostrophe aux rois dfunts sur cette indignit faite leur postrit : eussiez-vous pens que votre sang ft venu ce mpris ?... l'injure faite la Maison de Courtenay redonde en la personne du roi, des princes, des trangers... ne disons point que [...] ce qui s'est pratiqu contre eux ne peut porter prjudice ceux qui sont reconnus [puisque nous avons les mmes aeux]...
* Avis MM les princes du sang de prendre en ce fait de l'intrt: qu'on vous rduit en nous au commun. [Voil] que
ce n'est plus la naissance seulement qui fasse les princes du sang mais que ces choses dpendent de la discrtion de ceux qui auront plus de pouvoir, de faveur et d'autorit.
* Les Pairs aussi sont concerns : vous avez ce privilge de ne pouvoir tre jugs pour ce qui touche votre honneur ou l'tat de vos personnes que par le roi sant en sa cour des pairs. Si telles procdures [que la ntre] sont approuvs, il dpendra l'avenir de la discrtion simplement d'un chancelier [...], il suffira d'ordonner entrer en connaissance de cause et sans vous our comme l'on a fait...
* Ncessit de conserver les princes du sang, capables de la Couronne : Comme
tels ils ne sont pas seulement eux mais la proprit de leur personne appartient tout l'tat public... il n'y a [donc] pas apparence de les vouloir comme personnes communes [...] si ce n'est qu'ils aient attent ou contre l'tat public ou contre le souverain administrateur d'icelui... La qualit de prince du sang est considrable [i.e., considrer] en fait d'action intente contre lui, la qualit d'un prince du sang tant jointe l'intrt qu'a le public en la conservation d'iceux.
* Et tous ces attentats portent atteinte Dieu qui les a fait natre de la Maison de France.
Retraite de Frauville
Cadet d'une branche cadette, Jean, sieur de Frauville, est depuis le dbut le moteur de l'action. Il avait de qui tenir : on se souvient du tombeau de son pre, Guillaume ( 1592), l'glise de Chevillon, sem des armes de France et de Courtenay, et charg de l'inscription ci-gt illustre seigneur de sang royal... Frauville a combattu les Espagnols avec Henri IV et, aprs la paix de Vervins (1598), pous une jeune veuve Magdelaine de Marle dont le pre Jrme ( 1590) tait officier des crmonies de France et le frre mari la fille de ce Elie du Tillet qui a contribu "documenter" la campagne des Courtenay. Aprs une fille en 1606, il leur vient enfin un fils, n en 1610. Frauville l'ambitieux lui donne un nom-programme, Louis. A l'extinction des Blneau, ce Louis, devenu chef de la Maison, s'il n'atteint pas l'objectif, en saisira l'ombre et s'affichera prince.
Fin 1613, l'honneur des Courtenay restant bafou, Frauville quitte le royaume pour l'Angleterre. Comme il a besoin d'un Blneau pour reprsenter le chef de Maison, l'oncle d'Edme se joint lui (Jean des Salles). Leur retraite durera jusqu'en 1617.
La prsence de Jean des Salles aux cts de Frauville traduit-elle une division du travail ? Frauville travaillera pour Cond en Angleterre, Blneau en France. Cond, premier prince du sang, dfend les Courtenay, les reconnat comme cousins et leur promet de s'employer pour eux. Malheureusement, les circonstances troubles de la Rgence italienne et du Remuement des Princes ne les servent pas. Cond se rvle un protecteur dangereux qui promet tout tous et se comporte de manire aussi indcise que brouillonne. Se voulant la tte de l'opposition des Princes la Reine-mre et ses favoris, il va jusqu'aux prises d'armes et l'affrontement. Si la paix de Loudun (3 mai 1616) est son triomphe, il prcde de peu sa chute (1er septembre 1616) et son emprisonnement de trois ans.
En janvier 1613, Frauville et des Salles crivent la reine rgente, contraints de l'oppression que nous ressentons avoir t faite l'honneur de notre maison en la procdure criminelle que l'on a tenue l'encontre de Mr de Courtenay-Blneau de demander cong de se retirer hors du royaume. A ce stade, il s'agit d'une bravade : si on ne nous fait pas droit, nous en appellerons aux princes souverains d'Europe, pour faire voir un chacun quel est le droit de notre origine, qui nous sommes.
Aprs le dcs du deuxime fils de Henri IV (1611) et du comte de Soissons (1612), Conti tant moribond et les Guise trop puissants, le moment semble opportun pour tenter la Rgente, comme l'explique Zeller (1897, pp. 110-2) partir des lettres des ambassadeurs italiens :
C'est ce moment qui parut favorable la production de certains titres dont la reconnaissance et impos une limite aux prtentions trs grandes de la maison de Guise...
s'il [Conti] venait
manquer, comme on pouvait le craindre, la maison de Bourbon et toute la gnalogie royale se trouvaient rduites quatre ttes seulement, dont trois taient de petits enfants [le roi, 12 ans ; son frre, 2 ans ; le fils Soissons, 8 ans], et le prince de Cond, qui ne paraissait pas avoir grande esprance de postrit. Cette situation donnait beaucoup rflchir, cause des consquences trs grandes qui pouvaient en driver, et poussa les seigneurs de la maison de Courtenai, qui prtendait descendre, comme la maison de Bourbon, de Louis VI, mettre en avant ses droits la couronne [...] Ils rsolurent, pour accomplir un acte qui remit en vigueur leurs droits presque annihils et rduits nant par suite de la longueur du temps coul depuis qu'on les avait laisss dans l'ombre, de sortir du royaume avec l'agrment de Sa Majest. Ils donneraient comme prtexte qu'ils ne pouvaient y demeurer pendant la prsente minorit, sans un prjudice formel pour leurs prtentions, cause de la trop grande puissance de ceux qui, pour leurs propres fins et desseins, leur faisaient opposition. Tels sont les termes mmes d'une supplique remise par eux la reine. Ils attaquaient ainsi indirectement la maison de Guise, dont, pour tous les vnements qui pouvaient se produire, ce n'tait assurment pas le compte que le succs des revendications de la maison de Courtenai. Car, aprs la maison de Bourbon, celle de Guise tait plus grande et plus forte que toutes les autres.
La reine fit venir les principaux conseillers du Parlement et d'autres pour les consulter sur la rponse faire la supplique. A vrai dire, la tentative des Courtenai n'tait pas pour lui dplaire. Car l'espoir de la succession se partageant entre beaucoup de prtendants, si la maison de Bourbon venait manquer, la reine se trouverait mieux l'abri contre les piges qui pourraient lui tre tendus. L'opinion gnrale tait qu'en vrit la prtention des Courtenai tait juste et bien fonde; et ils montraient en effet beaucoup de titres. Mais le fait qu'elle avait t pendant un si long temps nglige par leurs anctres, qui, cause de leur pauvret, n'avaient pu soutenir le rang de princes; la ncessit o tait le roi de leur donner le moyen de se maintenir; et l'intrt d'autres devaient leur tre toujours un grand obstacle.
Quoi qu'il en soit, ils firent une tourne de visites dans laquelle ils informrent plusieurs personnages de la rsolution qu'ils avaient prise de partir avec l'agrment de la reine, pour revenir ensuite lorsque le roi serait devenu majeur. Ils firent cette dmarche auprs des ambassadeurs, et notamment de l'ambassadeur de Venise, afin de se mnager les bonnes grces de la rpublique, dans le cas o, au cours des divers voyages qu'ils avaient l'intention de faire, ils se rendraient dans ses tats. La question restait ouverte.
Des Salles et Frauville attendent toute l'anne une rponse qui ne vient pas et mettent leurs affaires en ordre. Au lieu d'entreprendre une longue et dispendieuse tourne europenne, ils choisissent l'Angleterre de James I dont leur protecteur Cond espre alliance et soutien. D'Abbeville, ils demandent asile (12 dc. 1613) et, par la chance d'une bonne mer, reoivent l'acceptation prvue le 21 dcembre. Au moment d'embarquer, de Calais, le 29 dcembre, ils crivent au Parlement les motifs de leur exil.
En Angleterre, James les reoit solennellement, la cour assemble, et, reprenant leurs mots, dclare : je sais que c'est un devoir envers votre honneur et non une lchet qui vous a fait sortir sortir de votre pays. Je reconnais l'honneur que vous avez d'appartenir la couronne de France.
De l, ils multiplient lettres et explications, protestent de leur bonne foi et des ncessits de leur honneur. James qui aime se mler de tout les recommande au roi et sa mre (9 juillet 1614) : ayant toujours affectionn la Maison de France de laquelle les histoires font foi qu'ils sont issus par mles lgitimement... recommandation de notre part pour vous prier de mettre la justice leur cause en considration... ne doutons pas que vous ne jugiez toujours plus convenable d'apporter quelque modration ce qui leur a donn sujet de leur loignement, que de les voir errans dans les Cours des autres Princes faire leurs plaintes. Il donne des instructions dans ce sens son ambassadeur, lequel, trs actif dans la politique franaise, combat le projet espagnol de la Rgente (le double mariage par change des Princesses) que Cond, et plus encore ses allis huguenots refusent aussi.
Jean de Frauville est l'agent de Cond auprs de James : jugeant que son Party avoit besoin d'tre appuy d'une puissance Royale pour le rendre considerable, [Cond] se servit de l'estime que le Prince IEAN DE COVRTENAY Seigneur de Frauville, s'toit acquise aupres du Roy d'Angleterre pour obtenir son assistance (du Bouchet, p. 288). Leur correspondance en tmoigne.
Loudun et Blneau
Cond cherche l'alliance des Rforms, l'extrieur (Angleterre, Provinces-Unies) comme l'intrieur.
En 1615, Blneau est son missaire Saumur auprs de Duplessy-Mornay, chef respect du parti, auquel il tente de "vendre" la rvolte. Mais aprs avoir lu le manifeste, il [Duplessy] demanda froidement Courtenai, si M. le Prince avoit une bonne arme pour le faire valoir [...] Le Prince, rpondit Courtenai, est assur de quinze mille hommes de guerre, Sa Majest Britannique en donne six qui sont embarqus ; le Prince Maurice [de Nassau] en fournit quatre, & le reste viendra d'Allemagne. Monsieur, reprit du Plessis en riant, ce n'est pas moi qu'il faut dire ces choses... (Levassor, p. 438).
On ignore la part que prend Edme aux escarmouches militaires mais on le voit omniprsent la confrence de paix de Loudun, ds les prliminaires, comme le montre le compte-rendu trs factuel de l'un des trois dputs du roi, Pontchartrain, corrobor par les documents dcouverts et publis par Bouchitt (1862). Avec le Duc de Bouillon, le Duc de Sully, de Thianges (et Desbordes pour la RPR), M. de Courtenay fait partie des commissaires que les Princes et Cond dsignent pour porter leur parole. Quoique moins actif que de Thianges, il accompagne frquemment les grands personnages (Comtesse de Soissons, Sully, Cond lui-mme) et il lui arrive de reprsenter Monsieur le Prince auprs des dputs du roi et mme, une fois, de la Rgente et du Roi.
Quoique les Grands, eux-mmes diviss, admettent mal la prpondrance de Cond et apprcient peu ses commissaires, Blneau est rcompens par l'inclusion des droits de sa Maison dans les conditions de paix (art. 9). Levassor (pp. 504-5) : Les Seigneurs de Courtenai ayant embrass de bonne grce le parti de Cond, il crut devoir leur tmoigner sa reconnaissance, en demandant "quÕon leur fit droit..." sur les requtes quÕils avoient prsentes plusieurs fois pour la conservation de lÕhonneur de leur Maison. LÕaffaire toit assez dlicate : car enfin ces Messieurs veulent tre Princes du Sang. Ils ont fait imprimer un volume considrable pour montrer quÕils descendent du dernier fils de Louis VI. surnomm le Gros. Mais tout le monde nÕen convient pas...
Dans les 31 demandes des Princes cet article 9 est inclus dans les points fondamentaux parce qu'un Prince du sang, personne publique, intresse la survie de l'Etat. Il vient aprs les 1. & 2. recherches sur la mort du roi, le 3. 1er article du Tiers, le 4. annulation des sursances des arrts du Parlement de Paris relatifs au parricide, le 5. autorit de l'Eglise gallicane, le 6. concile de Trente, le 7. droits de la RPR, le 8. maintien des offices, tats, charges etc., et avant le 10. maintenir et conserver les cours souveraines...
Par ailleurs, dans les Articles secrets sur lesquels les dputs ont savoir la volont du Roi, Blneau est inscrit avec les seigneurs copartageants pour une demande de gratification, encore honorablement place, entre Rosny et Luxembourg : Pour M de Courtenay: un brevet de conseiller d'Etat; augmentation de six mil livres de pension. Mais il n'aura rien.
De mme l'art. 9 est refus ou lud. Les Princes n'insistent pas et les discussions ultrieures portent sur l'art.1 du Tiers, la question d'Amiens (Concini vs Longueville) et les Rforms, ainsi que la suspension d'armes et ses violations.
Lisons cet article 9, au demeurant prudemment rdig : Que droit soit faict MM de Courtenay, suivant l'ordre et les loix du royaume, suivant les requestes par eux plusieurs fois prsentes pour la conservation de l'honneur de leur maison, tant du vivant du dfunt Roy que depuis; et pour le regard de certaines procdures criminelles faictes l'encontre du sieur de Courtenay-Bleneau, que ce qui pourroit avoir est faict contre les formes et la justice soit rpar.
Les trois dputs de la Cour (Villeroy, Pontchartrain, de Thou) rpondent en marge : au 9¡. Ce fait n'est du pouvoir des depputez et renvoient au Roi. Selon une autre version du document des dputs (ms de la bibliothque Mazarine) le ¤9 serait d'emble rejet : Il est vray que les sieurs de Courtenay ont prsent ceste fin plusieurs requestes au feu Roy, pre de S.M. ; mais il les a toujours rejettes aprs meure dlibration, comme les jugeant prjudiciables au bien de sa couronne et la dignit de sa maison.
De Thou assure son ami Jean de Thumery quelques jours aprs les ngociations (lettre du 6 mai 1616) que l'article a t ignor d'un commun accord : Quant aux demandes des Sieurs de Courtenay, qui toient contenus dans le huitime [neuvime] article, & qui ont t si souvent agites dans le Conseil de Henri le Grand, & au Parlement, on n'y fit aucune rponse. Ceux qui les avoient proposes par considration pour un Seigneur de cette maison qui s'toit attach au Prince de Cond [Blneau], toient eux-mmes fort loigns d'appuyer ces prtentions; car l'exception du Prince de Cond, il n'y avoit personne qui ne souhaitt que le nombre de Princes du sang diminut, plutt que de le voir augment (p 604 du tome X de l'dition Scheurleer de l'Histoire universelle, 1740).
Nanmoins, si l'art. 9 est renvoy au roi, la question reste ouverte et Cond, prsent chef du Conseil, promet une suite favorable. Hlas, opposant maladroit Concini et la Rgente, ses erreurs, excs et prtentions, conduisent quelques mois plus tard au coup de majest de son arrestation. Il reste enferm trois ans, La Bastille puis Vincennes.
On suppose qu'Edme retourne dans ses terres, cherchant se faire oublier. Quant Frauville et des Salles, les exils volontaires, ils n'ont plus rien esprer.
Sa prison [de Cond] & les desordres dont elle fut suivie, rompirent toutes les mesures que le Prince Jean [Frauville] avoit prises pour finir les disgraces de sa Maison, & la faire jour des avantages qui sont dus au Sang Royal dont elle tiroit son origine. De sorte, que se trouvant dchu de ses esperances [...] Il se rsolut de retourner en France (du Bouchet, p. 291), retour d'autant plus opportun que, par la mort de son frre an Jacques au dbut de l'anne 1617, il est dsormais sieur de Chevillon, chef de sa maison.
Surpassant son pre, Jean fait, de son vivant, riger un mausole fleurdelis sur le modle du double tombeau de Gaspard, destin lui et son frre, non plus dans l'glise de Chevillon mais dans l'abbaye ancestrale des Courtenay (Fontainejean), avec l'inscription : ci-gt trs illustre et trs vertueux prince du sang royal de France...
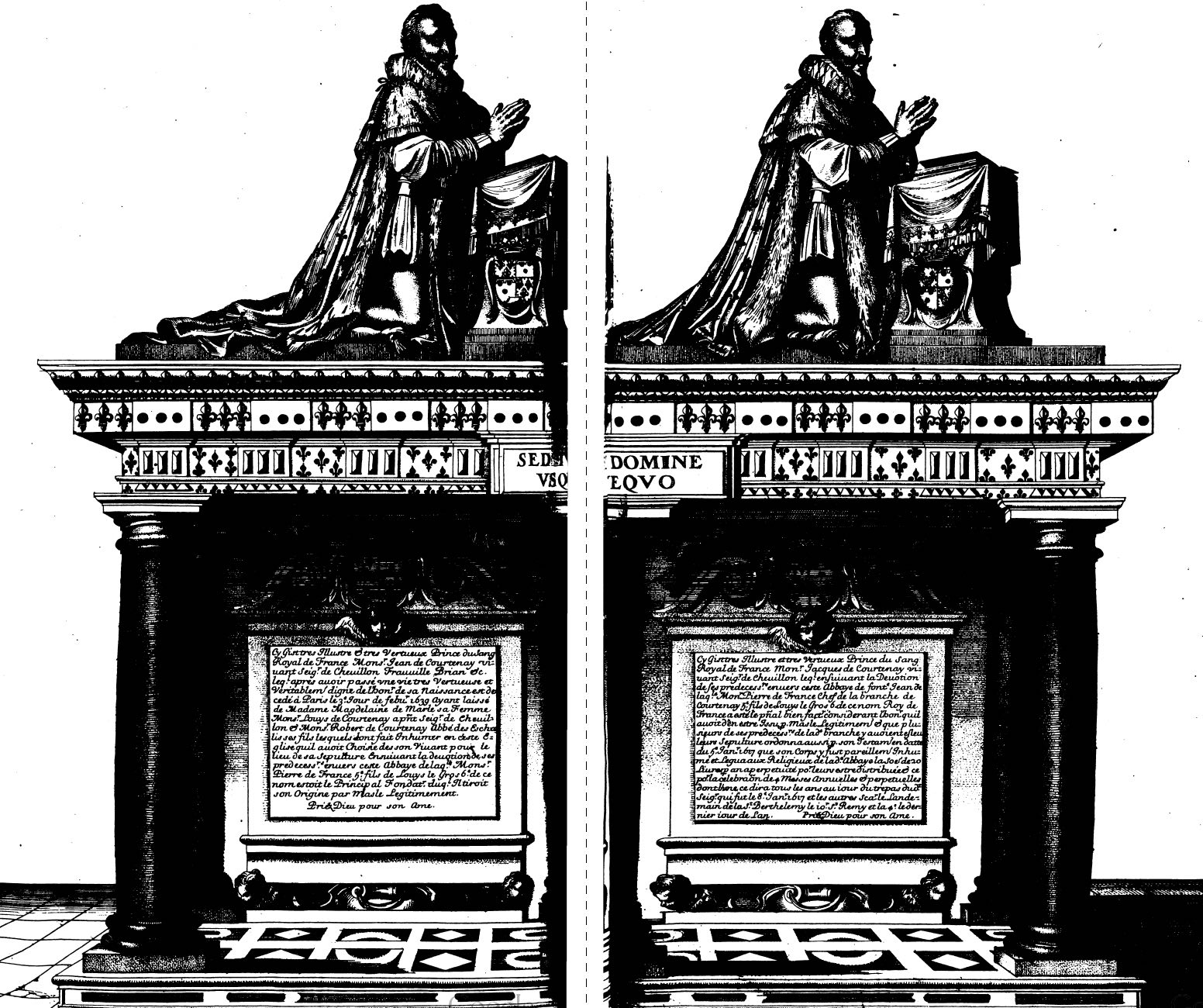
Les deux Courtenay rentrent donc en France. L'excution de Concini (24 avril 1617) redistribue les cartes sans profit pour eux. Non seulement leur cas irrite, mais comment leur pardonner Cond et les Anglais ?
Eradication
En 1618 parat pour la dernire fois, chez Mettayer imprimeur et libraire ordinaire du Roi, le Recueil de du Tillet. Le texte n'a pas chang depuis 1555 : nos Courtenay tardifs sont leur place, arrims Louis le Gros (pp. 91-2).
Un an aprs, ils ont disparu : dans la nouvelle mouture de la gnalogie royale, l'Histoire de la maison de France des frres Louis et Scvole de Sainte-Marthe, historiographes du Roi, nos sieurs n'existent plus.
Du Tillet poussait jusqu'aux Blneau et Chevillon de son temps la postrit de Guillaume, fils de Robert le Bouteiller (lui-mme second fils de Pierre) dont se rclament nos sieurs. Les frres Sainte-Marthe, eux, la rubrique des enfants de Robert, indiquent seulement Guillaume de Courtenay, seigneur de Champignelles (Tome 2, p 1375), sans aucune mention de postrit. De mme, dans l'dition suivante (1627, Tome 2, p 545). L'dition 1647 qualifie Guillaume de sr de Champignelles, Baillet, Cloye, Fert-Loupire, identifie son pouse, liste enfin leurs enfants, y compris Jean (Jean I), sr Champignelles et Fert-Loupire, mais ignore sa descendance.
La raison est simple : les Sainte-Marthe dont le travail est norme (prs de 2000 pages) ne s'intressent pas aux dtails. Rorganisant, corrigeant et rationalisant la lourde et confuse prsentation de du Tillet, ils laguent les branches mortes ou insignifiantes.
Du Bouchet, l'historiographe des Courtenay, en fera un roman, celui de la perscution du Procureur (du Bouchet, 1661, p 191-2) qui, aprs avoir maltrait Edme, supprimerait son ascendance en interdisant aux Sainte-Marthe de la mentionner.
Il crit : Si ce Prince [Jean II Champignelles] n'a point paru dans les trois diverses Editions de l'Histoire Genealogique de la Maison de France des Illustres Gemeaux de Sainte-Marthe, ce n'est pas que sa Personne leur ayt t inconnu, & qu'ils ayent manqu de Preuves pour luy donner rang & sa Postrit parmy les Princes de la Maison Royale aussi bien qu' son Pre [Jean I] Mais c'est qu'on les a obligez au silence, dans la pense qu'on a eu, que la descente du Prince GVILLAVME DE COVRTENAY Seigneur de Champignelles, petit fils de ROBERT DE FRANCE, se trouvant destitue de leur temoignage, pourrait devenir douteuse.
En effet, nous l'avons not la suite de Gibbon, la faiblesse gnalogique des Courtenay, au-del des dtours de leur descente, rside dans son obscurit. La liste des rois et de leurs lignes successives s'apprend l'cole. Les Princes du Sang sont notoires. Un Cond, par exemple, est publiquement le fils d'un Cond : on ne le reconnat pas, on le connat, on l'honore et on le traite comme tel. Au contraire, la filiation de nos sieurs est d'ordre priv, essentiellement inconnue, et donc improbable. Quand ils disent les historiens font foi..., si on leur demandait qui ?, ils ne pourraient citer qu'un fragment de du Tillet (repris par Belleforest et d'autres). Et voil qu'ils ne figurent pas dans le nouvel annuaire, celui des Sainte-Marthe, celui qui a cours prsent ! Les historiens font foi ne vaut plus rien. Tous ceux qui s'intressent ont du Tillet dans leur bibliothque o on lit qui dure encore. Mais du Tillet est dclass par les Sainte-Marthe et, destitue de leur temoignage, la prtention des Courtenay perd sa base.
Du Bouchet qui, nous le verrons, consacre de grands efforts la rtablir, cite une dclaration des Sainte-Marthe, crite de leur main en 1620, attestant que lorsque, en mai 1619, ils soumirent leur lettre de privilge au Parlement pour enregistrement... le Procureur General remarqua en la page 1375 de la feuille cotte MMMMmmmm qu'en parlant de Guillaume de Courtenay Seigneur de Champignelles, ces termes estoient portez "fut destin l'Eglise & ne voulut suivre cette profession selon du Tillet, qui fait descendre de luy les Seigneurs de CHAMPIGNELLES & DE BLENEAU": et lors mondit sieur le Procureur General nous auroit [avait] dit; Que pour quelques considerations, il n'estoit propos d'insrer les dits termes..., lesquels taient pourtant prudents (selon du Tillet, qui fait descendre de luy les Srs de Champignelles & de Bleneau).
Certes, les Sainte-Marthe ne rsisteraient pas un tel conseil du procureur gnral du Parlement. Toutefois, on s'tonne. Par quel hasard un Procureur gnral surcharg d'affaires tombe-t-il sur la p 1375, feuille MMMMmmmm, l'occasion d'une lettre de privilge dj accorde par "le roi" dont le censeur n'a pas tiqu, et juge-t-il l'affaire assez importante pour la transmettre au parquet ? Mme si Mathieu Mol (s'il s'agit de lui car du Bouchet ne nomme pas) est attentif son devoir de police, il faut qu'il ait t l'afft ou que quelque malveillant l'alerte.
Certes, trois ans aprs Loudun, alors que Cond n'est pas encore rhabilit, on se souvient des Courtenay et beaucoup restent irrits de leur prtention. Mais le selon
du Tillet tait dj assez vexant pour nos sieurs pour ne pas ncessiter ce coup de pied de l'ne. Et les Courtenay ne sont pas dangereux au point que les Sainte-Marthe veuillent se protger de leur courroux en s'abritant derrire le procureur. Comment et o du Bouchet dniche-t-il cette
lettre bizarre que personne d'autre que lui n'a vue ni ne cite ?
Du Bouchet a t en affaires avec les Sainte-Marthe, lorsque, la fin des annes 1640, ils ont ensemble invent les origines carolingiennes des Captiens, via un Childebrand, frre cadet de Charles Martel ! La troisime dition de Sainte-Marthe (1647), bouleverse par cette rvolution, renvoie abondamment du Bouchet (1646), pour dduire de ce Childebrand les Robertiens, anctres des rois rgnant. Du Bouchet ne profite pas de cette connivence pour rclamer aux Sainte-Marthe de donner une ascendance aux Courtenay rsiduels car, cette date, ils ne l'intressent pas. Il n'a pas encore t recrut par le Prince Louis pour le clbrer. Quand c'est le cas, les Sainte-Marthe sont morts. Mais, du coup, ils ne peuvent pas contester une lettre attestant l'ordre d'un procureur de censurer les Courtenay, lettre plusieurs fois trange : par son existence, son contenu, sa conservation pendant 40 ans, sa transmission miraculeuse. Cui
prodest ? qui profite le coup ? Du Bouchet surmonte ainsi le fcheux silence des Sainte-Marthe et rcrit l'histoire des checs des Courtenay.
A-t-il fabriqu la lettre ? Ni lui, ni ses confrres, ne craignent les arrangements. Du Bouchet, sans tre un faussaire insigne comme son secrtaire de Barres (de Bar), ne manque pas de "crativit". Infligez-vous la lecture de La vritable origine de la seconde et troisime ligne de la Maison Royale de France justifie par plusieurs chroniques et histoires anciennes (1646), et vous verrez. Quand on connat ses accointances avec Duchesne et le trop fertile Combault, on ne se laisse pas impressionner par les preuves.
Le silence trois fois rpt des respects Sainte Marthe choque car ils font autorit. Ainsi, dans ses populaires Tableaux
gnalogiques de la Maison royale (1652, p. 190), le RP Labbe se rfre eux pour ne pas filer la descente des Champignelles (le
greffier du Tillet et quelques autres ont pass plus avant, je me contenterai de suivre l'exemple de MM les frres jumeaux de S.Marthe qui n'ont point poursuivi cette descente si avant), ignorant donc les Courtenay contemporains.
Le "procureur" permet du Bouchet de blanchir ses clients et de les montrer victimes d'une longue perscution. La malchance s'appelle procureur ! Ce mchant, ternel et anonyme, bloque les requtes au Roi en 1603/1609, maltraite Edme en 1610, censure Sainte-Marthe en 1619, nouveau en 1627, et encore en 1647 ! L'histoire alors se raconte comme un complot : on nous aurait rendu justice depuis longtemps sans l'intervention permanente d'un esprit malin...
L'ide a pu tre inspire par la msaventure des mmes Sainte Marthe en 1656, quand leur Gallia Christiana, soutenue et finance par l'Assemble du clerg, a rencontr une difficult de ce type. L'Assemble, examinant les volumes dj imprims grand cot, est saisie d'une plainte de la Duchesse d'Aiguillon, l'ex nice chrie de Richelieu, choque par les louanges de Saint-Cyran qui attentent la mmoire du Cardinal perscuteur. L'Assemble ordonne la suppression de la notice ou au moins qu'elle soit recouverte d'un placard, et obtient la sanction de sa dcision par lettres du roi et de la Reine-Mre (Poncet, 2009).
3. Si falso, puniendum...
Jean de Frauville, rentr d'Angleterre en 1617, sieur de Chevillon par la mort de son frre an, attend dix ans pour recommencer ses poursuites pour la gloire de sa maison. Le 16 mars 1626, une requte au Roi sollicite la cassation de tout ce qui a t fait contre eux au prjudice de leur qualit. Vainement. La voie directe n'apporte rien. Dsormais, nos sieurs, dans l'ombre de Richelieu, suivront une stratgie oblique, exploitant l'alternative pose dans le De stirpe : si c'est faux, qu'on nous punisse (si falso, puniendum) ; si c'est vrai, qu'on ne le nie pas (si vere, non negandum). L'absence de chtiment vaut reconnaissance de fait.
Richelieu
Irrsistiblement, Edme de Blneau ( 1633) et son fils Gaspard II, passent au service du cousin Richelieu. Quel rle jouent-ils auprs du Cardinal qui, au moins une fois, selon Le Laboureur, qualifie le Courtenay de prince du sang ? quelle assurance en reoit-il ? dans quelle intention ? Le cousinage d'Edme et de Richelieu est la seule chose certaine, via leurs grand-mres, les sÏurs Claude et Franoise de Rochechouart...
Mutatis mutandis, Richelieu, comme jadis Sully, voit dans les Courtenay un petit fer parmi tous ceux qu'il a au feu pour assurer sa fortune et sa gloire. Mathieu de Morgues qui, aprs avoir quitt son service, retourne sa plume contre lui, l'accuse d'un projet tordu (Lettre de Mr le cardinal de Lyon Mr le Cardinal de Richelieu son frre, l'an 1631) : se donner une origine royale grce sa parent avec les Courtenay ! Mr de Lyon est suppos reprocher son frre l'effronterie avec laquelle vous vous faites descendre de Louys le Gros & tomber dans la branche de ceux de Courtenay, lesquels vous avez resolu de faire dclarer Princes du sang afin de vous faciliter l'excution de vos desseins... (p. 35) quoi Richelieu aurait rtorqu : notre gnalogie... me fournira, aprs que j'auray esteint toute la race Royale, renvers la Loy Salique, & chass ces morfondus de Courtenay, conquerir le Royaume... (p. 38). Richelieu se servirait des morfondus pour ajouter leur descente mle de Louis le gros celle qu'il s'attribue. Plus que la perversit du Cardinal, ce texte montre que, ds 1630, ceux de Courtenay ont accd la notorit.
Richelieu avait-il besoin d'eux pour, comme tant d'autres, mettre le pass la hauteur de son prsent en ajustant sa mdiocre ascendance sa neuve magnificence ? Il se fait inscrire par les Sainte-Marthe dans la descente de Louis VI (Maison de France, 1627, T. 2, p 1016). Il charge le complaisant Duchne de dvelopper le thme (1631) : le Cardinal sort de Louis le Gros, par femmes, via son arrire-grand-mre, la bien nomme Anne Le Roy. Cette quenouille n'empche pas Duchne d'accorder Richelieu une royalit entire en raison de la grandeur du Sang des descendantes d'un Roi, grandeur qui ne se divise pas, ne se dilue pas et confre tant d'excellence & de Splendeur tous ceux qui ont mrit l'honneur de descendre d'elles. La plus minime fraction de royalit, mme fminine, suffit pour tre tout royal !
Ne craignant plus le Cardinal ( 1642), Le Laboureur crit malicieusement en 1659 qu'il empila les gnalogies afin qu'il parut comme par l'effet de Cylindre, qu'il estoit l'extrait d'un nombre presqu'infiny des Rois, d'Empereurs & de grands Princes, dont chacun avoit fourny sa portion de son estre. Les ascendances se cumulent et l'effet de cylindre traduit l'additivit de la Splendeur ! Dans ce temps, le discours gnalogique est une forme de la rhtorique de l'loge, comme en tmoigne la clbration emphatique du Cardinal par Duchne : ... la splendeur de cette extraction avec laquelle il est venu dans le monde est la moindre partie des Grandeurs qui galent maintenant la gloire de son Nom l'tendue de l'Univers...
Laissons la grandeur prtendue du Cardinal et celle qu'aurait ajouter un Courtenay Prince du sang. Prenons la chose sous l'angle politique : le Roi malade et sans fils (jusqu'en 1638), l'ternel brouillon qu'est le frre du Roi, Gaston, trop longtemps hritier naturel, et les non moins agits Cond convoitent la Couronne. Richelieu est-il tent de leur opposer un Courtenay dont il tirerait les ficelles ? ou d'utiliser cette ventualit comme moyen de pression ou de ngociation ?
Mme si nos Courtenay s'exagrent le soutien de Richelieu, ils ont espr en tirer quelque chose. Richelieu meurt trop tt. C'est le refrain qui enterre tout ceux qui leur auraient voulu du bien.
Plus tard, Louis de Chevillon comptera-t-il sur Mazarin pour assurer son fils Louis-Charles un double triomphe ? Le Cardinal, cherchant des nids dans les cieux pour caser ses nices chries, aurait song en faire un prince du sang et lui en donner une, Hortense, la plus belle de ses nices, qui il donnait tant de millions. Peut-on croire l'abb de Choisy ? Il crit bien plus tard : Il [Mazarin] avoit balanc quelque temps entre le grand-matre [de l'artillerie, La Meilleraye] et le prince de Courtenay, qu'il et fait reconnotre prince du sang, s'il avoit t capable de soutenir une si grande naissance (Mmoires p. servir l'Hist. de Louis XIV, 1727, T1, 98-99), repris par Saint-Simon (XIII, 9). La chose n'est pas avre et, d'aprs les Mmoires d'Hortense (1675), elle n'tait pas en cause car Mazarin voulait marier La Meilleraye, non elle mais sa sÏur Marie : [Meilleraye] refusa ma sÏur, et conut une inclination si violente pour moi, quÕil dit une fois Mme dÕAiguillon que pourvu quÕil mÕpoust, il ne se soucioit pas de mourir trois mois aprs. Aux premires nouvelles que M. le cardinal apprit de cette passion, il parut si loign de lÕapprouver, et si outr du refus [...] de ma sÏur, quÕil dit plusieurs fois quÕil me donnerait plutt un valet. Louis-Charles est-il ce valet ? ou bien Mazarin pensait-il vraiment lui pour Hortense puisque Meilleraye tait pour Marie ?
Revenons Louis de Chevillon.
Le prince Louis
En 1653, Gaspard de Blneau, chef d'une Maison Courtenay que sa mort sans postrit va teindre (1655), la confie son arrire petit-cousin, le fils de Jean de Frauville, notre Louis de Chevillon (leur aeul commun est Jean de Blneau, 1460), la charge de la transmettre Louis-Charles, son fils, et de la conserver ceux de son nom et armes et de payer ses dettes jusqu' concurrence de 80000 livres. La Maison passe alors au Chevillon, ce Louis qui a trouv sa feuille de route dans son berceau.
Edme de Blneau avait appel son hritier Gaspar, comme son pre. Jean de Frauville ( 1639), l'ambitieux cadet de la branche cadette, a color son premier fils de royalit en le nommant Louis comme Clovis et les autres : outrecuidance ? bluff ? espoir ? sentiment que le temps est venu ? Pour la premire fois en cinq sicles, un descendant de Pierre reoit ce nom sacr. Dans une famille qui prtend aux lys, Louis fait drapeau et trompette. Depuis le dbut, les ans accumulrent les Pierre, les Champignelles les Robert, les Blneau les Jean... Louis est rest tabou, ou du moins absent de la liste o l'on puise. Ce nom pse lourd, il signifie le Roi. Beaucoup l'ont port, celui qui rgne est le quatorzime en comptant partir d'Hlodowig (Clovis). Dornavant, il dcore l'un de ces Chevillon qui descend, en zigzag, de Louis le gros : Louis VI => Pierre => Champignelles => Blneau => Fert-Loupire => Chevillon.
Le pari de Jean russira : Louis, prsent chef de la Maison, s'intitulera prince du sang royal et dfendra son droit la Couronne contre les nouveaux "fils de France" lorrains. Aprs lui, son fils Louis-Charles, de grande mine et parfaitement bien fait, exploitera au mieux la position. Demi-succs fragile ! Le dernier Courtenay se dtruira en 1730, et les prtentions de la fille rsiduelle seront renvoyes au nant.
Regardons comment Louis s'y prend pour merger. Aprs avoir servi (aux barricades de Suse en 1629 et, en 1635, vraisemblablement en Valteline), Louis pouse Lucrce (1638) : son pre, Philippe, cadet de la puissante famille de Harlay, trente ans ambassadeur du roi auprs du Grand Turc ; sa mre, Marie de Bthune, cousine des Sully. Lucrce a t leve par les parents pimontais de sa mre. A moins que ceux-ci ne l'aient dote, ce mariage n'apporte gure d'argent car l'ambassade et les ngligences de Philippe de Harlay le ruinent. Mais cette alliance achve le "dcrassage" parisien du Courtenay et, pour prix de ses longs et pnibles services, Harlay obtient l'rection en comt de sa terre de Csy dont, finalement, Lucrce hritera de ses frres. La Grande Mademoiselle la compte parmi ses connaissances et se rjouit de la trouver, en voisine, lors de son exil S.Fargeau : elle a tout fait l'air de celle d'une femme de grande qualit et qui a t nourrie la cour (Mmoires, d. Chruel, T2, 1858, p. 475, l'anne 1656). Mademoiselle la prend avec elle lors de son glorieux voyage en Dombes et lui fait donner des harangues et des prsents (id., T3, pp. 339 sq., l'anne 1658).
Louis qui tait dans la clientle (et probablement au service) de Richelieu, passe Mazarin, ce qui ne l'empche pas de flirter brivement avec Cond pendant la Fronde, tandis que son frre, abb des Echalis, rejoint le cardinal de Retz en exil Rome (il le paiera d'un mois la Bastille, selon Patin : lettres Charles Spon, 9 avril et 7 mai 1658).
Louis, son ascendance prsent universellement admise, s'intitule Prince. Cela brille mais ne pse gure. Le coup d'clat, c'est que, cette occasion, il prend les armes de France, les trois lys royaux cartels de Courtenay, avec la couronne. Jusque l, ce n'tait que dans la pnombre d'glises de campagne, sur des tombeaux, ou dans des contrats privs que quelques uns avaient os cette annexion. Louis l'affiche ostensiblement.
Si fils de France (famille du roi) ou prince du sang (hritier de secours) relvent de catgories dfinies dont les membres sont rpertoris, hirarchiss, et les privilges codifis ; si, depuis que le Roi a renvers la "pyramide fodale" en se faisant la source de la noblesse, il la multiplie et la nomenclature en forme (lettres-patentes, brevets etc.) ; si les princes trangers ont une dfinition et un rang ; si, enfin, certains seigneurs particuliers, sans tre princes pour autant, sont dsigns ainsi (sans consquence) cause de certaines de leurs Terres que le droit ou la coutume qualifient de Principauts ; pour tous les autres, prince n'est qu'un qualificatif indtermin, souvent employ pour dsigner les cadets de grande maison, comme on appelle baron le fils d'un simple gentilhomme. Ce prince, tiquette sans labellisation, sonne comme le registre soutenu d'un monsieur qui a perdu sa fonction de marqueur de noblesse.
L'annuaire de la Cour, le semi-officiel Etat de la France, aprs avoir list les enfants de France et princes du sang, ajoute un codicille : Quelques autres Princes ou Princesses issus de la Maison de France ont besoin de Lettres de lgitimation, ou d'un acte public, par lequel ils soient reconnus tels. L'dition de 1672, reprise par celle de 1687, inclut (ngativement) nos Courtenay dans cette catgorie btarde. En effet, la fin du chapitre, on lit : Nous avons nomm cy-devant ceux qui sont Princes en France, sans en avoir obligation qu' leur naissance. Parmy lesquels prtendent tre compris Messieurs les Princes de Courtenay, qui en firent de grandes instances sous le rgne de Henry le Grand [...] Mais jusques icy ils n'ont pas encore t reconnus (1687, p 759). Plus tard (d. 1712, T. 2, p. 209), eux dont le nom et la terre appartiennent aux Boulainvilliers, comtes de Courtenay, tomberont dans les princes de courtoisie (ou de fantaisie) et seront placs entre les princes imaginaires de Tarente en Italie et Soyon en Vivarais.
Saint-Simon, imbu des rangs, ne chicane pas un Louis-Charles qui n'en a pas et qui, sagement, se tient sa petite place. Les "princes" Courtenay ne donnent pas matire jalousie, ils n'ont (et n'auront) jamais ni grces, ni titres, ni dignits, ni honneurs. A un moment o de simples gentilshommes (et d'autres qui ne le sont pas) s'intitulent marquis, o le roi prodigue les titres brevet purement honorifiques, beaucoup se disent : qu'est-il besoin de tels brevets pour porter ces titres ? Louis a profit et particip de cette inflation gnralise. Sa princerie (porte par la lgende Louis le gros) ne choque pas.
Du Bouchet traduit cette acceptation en crivant (dans ses Preuves) : Louis de Courtenay premier du nom, surnomm communment par un concert universel, le Prince de Courtenay. A dfaut d'un acte public, il est "titr" par l'opinion publique.
Mais, si Prince ne tire pas consquence, adjoindre ostensiblement les lys aux tourteaux des Courtenay est un coup de partie. Louis imite ce Jean de Perusse dÕEscars (1500-1595) qui, lointain descendant de Saint-Louis par sa mre, osa carteler ses armes de fleurs de lys et se fit prince de Carency. Henri III ferma les yeux et, une gnration plus tard, l'usurpation oublie, les lys et le prince taient avaliss par l'habitude.
Comme les rangs, les honneurs et les distinctions sont peu peu tombs en pillage en France, aussy ont fait les noms, les armes, les Maisons ; s'ente qui veut et qui peut, crit Saint-Simon, sans penser son propre pre, Claude de Rasse, qui s'enta de la sorte aux Vermandois carolingiens.
L'innovation de Louis, prpare depuis cinquante ans, ne suscite pas d'tonnement. Prince de Courtenay s'emploie couramment, a n'engage rien. Aucune exclamation ou rprobation ne salue l'apparition d'une minuscule toile l'extrme priphrie du ciel royal. Lorsqu'on en parle, c'est comme si elle tait l depuis toujours. Et, rtrospectivement, on qualifie de prince ou princesse le moindre Courtenay depuis Pierre "de France", le fils du Gros.
|
|
|
C'est probablement de 1655 que date cette autopromotion, quand le dcs de Gaspard de Blneau met en scne la recomposition des biens et honneurs familiaux au profit de Louis de Chevillon. Il se fleurdelise et, pour consolider cette avance, recourt du Bouchet, gnalogiste professionnel alors non dpourvu de rputation. Le De stirpe du temps de Henri IV, cette lourde plaidoirie en latin, avait rat son but, ne dmontrait rien et tait absolument dmode. L'Histoire gnalogique de la Maison royale de Courtenay parat en 1661, l'anne mme de la mort de Mazarin et du dbut du rgne personnel de Louis XIV auquel elle est ddie.
Du Bouchet
Quelques annes suffisent du Bouchet, entrepreneur expriment dont l'atelier fonctionne depuis longtemps et les armoires dbordent de justificatifs, originaux, copis ou forgs, pour assembler et mettre en forme cette Histoire gnalogique, malgr le nombre des ramifications, la taille de l'ouvrage et l'abondance des preuves qui proviennent en partie du travail d'archive initi par les Courtenay sous Henri IV. Du Bouchet ne livre pas un factum juridique comme le De stirpe, mais un catalogue historiographique, avec un imprimeur (Preuveray), un libraire (du Puis) et un privilge royal (du 7 fvrier 1661).
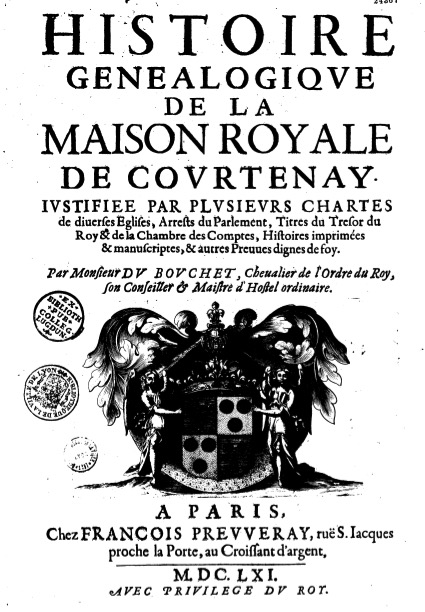
L'Adresse au Roi commence ainsi : Voicy
des Princes issus d'un de vos Augustes Ayeux, & que la Renomme & le bruit de Vos incomparables Actions & de vos vertus heroques, obligent de quitter leurs Tombeaux pour revivre sous votre Empire.
Ainsi veills, comme malgr eux, par la gloire du Roi, ils esprent la glorieuse Protection de votre Majest, & que vous leur accorderez en faveur de ceux qui restent encore de leur Posterit, les marques d'Honneur, qui doivent tre inseparables de leur Extraction Royale. C'est un Droit, SIRE, qu'ils tiennent en partage de la Nature ; qui ne se peut prescrire par le Temps ; & que vous ne leur sauriez refuser sans affoiblir l'Appuy de Votre Couronne, puisqu'il n'y a que les Princes du sang qui soient nez pour la soutenir, & qui ayent la facult de produire les Roys... Il est de votre gloire aussi bien que de la grandeur de l'Etat que ceux qui ont l'honneur d'avoir une mme origine de V.M.... ne demeurent pas parmi le vulgaire, sans clat et sans rang.
Une prface de treize pages s'emploie convaincre le lecteur que les Courtenay ne souffrent pas d'un vice gnique mais d'un accident de l'Histoire : ils ne sont pas tituls
princes du sang parce que cette distinction n'existait pas du temps de leur anctre royal. Ce n'a pas t une naissance douteuse ou incertaine qui les a retenus dans la condition o ils sont prsent, mais seulement l'ancien usage de l'Etat... Que si la Fortune a eu assez d'injustice jusqu' cette heure pour refuser l'entre du Louvre leur Carrosse, la Nature & la Loi fondamentale de l'Etat leur ont donn l'avantage de mriter cet honneur et d'tre les seuls qui peuvent succder la Couronne aprs la Maison de Bourbon [qui est ane].
Le droit de nature est une fausse vidence : c'est l'Histoire, la construction de l'institution royale, qui au cours des sicles a dlimit et thoris le statut de successeur. La nature, c'est le cuivre de la monnaie des pauvres : mme astiqu, il ne vaut pas de l'or ! Aprs le dcs de Louis XIV, ses btards se rclameront de la nature pour s'galer aux princes lgitimes. A leur suite, Hlne, l'ultime Courtenay, en abusera.
Plus astucieusement, Du Bouchet attribue la primaut de la Maison de Bourbon sur celle de Courtenay leur origine : les premiers descendent du fils an de Louis VI le gros, et les seconds d'un cadet (Pierre). Nous examinerons dans la conclusion cette tentative d'ancrer la Monarchie au Gros, translation qui, en plaant au XIIe sicle l'anctre commun (gnarque), mettrait Bourbon et Courtenay sur le mme plan, quoiqu' des hauteurs diffrentes.
Le contenu de l'Histoire de du Bouchet rvle les difficults auxquelles il se heurte. Ses 400 pages de texte (plus 262 pages des Preuves, foliotes sparment) ne nous apprennent pas grand chose, les chroniqueurs du pass ayant oubli les Courtenay. Ceux-ci apparaissent surtout dans les partages successoraux qui fournissent dates, noms, parents et rpartitions de terre. Je n'ai pas eu le courage de procder un comptage prcis : approximativement, les Courtenay n'occupent qu'une centaine de pages de leur Histoire. Le reste est rempli par les gnalogies des conjointes, supposes illustrer la grandeur des alliances. Certes, plus il y a de beaux noms, plus a brille, mais aussi ces digressions qui embrouillent le lecteur permettent du Bouchet de pallier conomiquement le manque de donnes en remployant le contenu des cartons dans lesquels il collectionne les Maisons.
Quoiqu'apparemment trs dtaill, l'ouvrage a d sembler frustrant au "Prince" Louis, s'il l'a lu (il lui suffisait qu'il existt). On le rencontre, comme dissimul, entre Fert-Loupire et Bontin. En effet, du Bouchet n'ose pas produire un schma synthtique le dduisant de Pierre "de France" et se limite des tableaux partiels, branche par branche. La dmonstration reste donc implicite et opre par embotement. L'auteur suit les branches directement issues de Pierre (l'impriale, puis celle de Champignelles) et, aprs, celles issues des issus (Bleneau, puis Fert-Loupire, Chevillon, Bontin). Si l'on trouve un index des maisons allies, on cherche vainement une table des matires. J'ai d en reconstituer les mandres. Les dates (que l'auteur ne justifie pas) correspondent habituellement, pour la premire celle du partage successoral qui a dot le "fondateur", et pour la dernire la mort du dernier hritier, d'o le flambeau passe une branche cadette. Le livre V accueille ceux dont on ne sait pas quoi faire.
Livre 1, Partie 1 branche ane (empereurs) 1160-1307 : Chp.1 Louis VI ; Chp.2 Pierre, fils du prcdent ; Chp.3 Pierre II, fils du prcdent ; Chp.4 Robert, fils du prcdent ; Chp.5 Baudoin, frre du prcdent ; Chp.6 Philippe, fils du prcdent ; Chp.7 Catherine, fille du prcdent.//
Livre 1, Partie 2 branche Champignelles 1197-1271 : Chp.1 Robert, petit-fils de Louis VI ; Chp.2 Pierre, 1er fils du prcdent ; Chp.3 Raoul, 2nd fils ; (Guillaume, 6me fils et successeur report au Livre 2, Chp.1).
Livre 2 Champignelles et S.Brion 1246-1472 : Chp.1 Guillaume ; Chp.2 Jean I fils du prcdent (x S.Brion) ; Chp.3 Jean II, fils du prcdent (x S.Verain-Blneau) ; Chp.4 Jean III, fils du prcdent ; Chp.5 Pierre II son frre ; Chp.6 Pierre III, fils du prcdent (son frre Jean "II" de Blneau poursuivi au Livre 3) ; Chp.7 Jean IV sans terre, fils du prcdent.//
Livre 3 Blneau 1415-1655 : Chp.1 Jean "II", frre de Pierre III ; Chp.2 Jean "III", fils du prcdent ; Chp.3 Jean "IV", fils du prcdent ; Chp.4 Franois, fils du prcdent ; Chp.5 Gaspard, fils du prcdent ; Chp.6 Edme, fils du prcdent ; Chp.7 Gaspard II, fils du prcdent.//
Livre 4
Fert-Loupire, Chevillon, Bontin, de 1461 jq prsent :
Chp.1 Pierre Fert-Loupire et Chevillon, 3e fils de Jean "II" (dont le 4e fils est en Chp.7) ; Chp.2 Pierre, 1er fils du prcdent (dont Ren, dont filles par lesquelles se perd la Fert-Loupire) ; Chp.3 Jean Chevillon, 2e fils ; Chp.4 Guillaume, fils du prcdent ; Chp.5 Jean Frauville, 4e fils et successeur ; Chp.6 "Prince" Louis, fils du prcdent.
Chp.7 Sgrs de Bontin: Louis (4e fils de Pierre Fert-Loupire et Chevillon du Chp.1 de ce L4) ; Chp.8 Franois (RPR), fils du prcdent ; Chp.9 sa fille Anne x Sully.
Livre 5 Sgrs d'Arrablay, anciens Fert-Loupire, Tanlay
Pour simplifier la transmission, tons la branche ane (impriale) dont nos sieurs ne descendent pas et cartons les scories du Livre V. La continuit rsulte de la substitution d'une branche cadette une branche ane lorsque celle-ci finit. Le plan de l'expos est suppos convaincre :
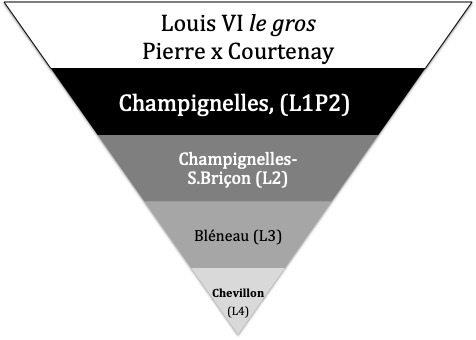
Du Bouchet imprgne le lecteur de la royalit des Courtenay, par l'appellation de prince et princesse qu'il distribue abondamment en tous temps aux diffrents sires, leur pouse et leurs enfants.
Les preuves incontestables n'existent pas, les contre-preuves non plus. La mission de du Bouchet consiste rtablir la descente bloque par les Sainte-Marthe : il rend sa postrit Guillaume (6e fils de Robert de Champignelles) et la pousse jusqu' prsent. La reconstruction et le renforcement de la passerelle lance par du Tillet, prend la forme d'une succession de ponts. Du Bouchet offre Louis le monument de sa grandeur et fournit des matriaux aux gnalogistes futurs. Une entreprise de communication russie !
En effet, l'ouvrage impressionnera et alimentera les auteurs de gnalogies royales qui, autrement, se seraient contents des Sainte-Marthe, excluant par l les Courtenay. De mme que la valeur d'une lettre de change augmente avec le nombre des signatures qui la garantissent, de mme chaque reprise de du Bouchet accrot sa crdibilit et celle des Courtenay ! Cela se voit vite, ds l'Histoire gnalogique et chronologique de la maison royale de France du Pre Anselme (1674), maintes fois rdite et complte. Au sicle suivant, c'est le tour de La Chenaye-Desbois (Dictionnaire de la Noblesse 1757-1765). Tous les compilateurs de catalogues de la maison royale ou de dictionnaires de la noblesse auront leur chapitre "Courtenay" bas sur du Bouchet. Ainsi, capturant les gnrations futures, Louis surmonte le "Gibbon's problem" et russit a posteriori inscrire son origine dans les annales du royaume.
Le "prince" sent-il qu'en passant de la statique (ni reconnus, ni dnis) la dynamique (j'avance, me ferez-vous reculer ?), il exploite l'indcidabilit, en assimilant l'absence de raction une approbation ? On le pense lorsqu'on lit le prambule de sa Requte solennelle de 1666 : Avant que de presser V.M. par leurs plaintes ; ils ont creu, SIRE, estre obligez d'exposer l'examen de toute l'Europe, les Preuves invincibles de leur Extraction Royalle: L'histoire Gnalogique, qui contient leur filiation & ses Preuves authentiques, est imprime depuis cinq ans avec la permission de V.M. Et cette vrit est confirme par le tesmoignage de tous les Historiens.
Les Courtenay tardifs s'affirment aussi Captiens que le roi, tout en restant prudents. Dans ses additions aux Mmoires de Dangeau, Saint-Simon dvoile leur ruse : Ces messieurs-l... ont vit de rien faire volontairement qu'on pt opposer leur droit (Dangeau, d. 1855, T.4, p. 18, la date 3 fv. 1692). Louis n'enfonce pas les grilles du Louvre avec son carrosse. Il joue ses rares cartes avec habilet, et non quitte ou double comme un Pranzac dont le Parlement condamna la prtention la royalit (Guillard, 1689, T.4). Pour bien montrer la diffrence, Du Bouchet lance en 1667 une Responce la requeste que M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, s'est persuad avoir prsente au Roy.
Louis a l'impertinence cauteleuse. Sully, Richelieu, Mazarin, ont encourag ou excit les prtentions des Courtenay. N'en doutons pas, Louis, avant de se fleurdeliser, savait qu'on le laisserait faire. Mme si les faux princes prolifrent et si la "socit" du temps est beaucoup plus fluide que l'Etiquette de Versailles et les querelles de rang le suggrent, prendre les armes royales, c'est tenter la hache.
Rsultats
Quand, en 1661, Louis XIV commence son rgne personnel, il trouve notre Louis "royalis" et affecte de l'ignorer. Matre des distinctions et des rangs, le roi qui accorde ou refuse un tabouret de grce celles qui ne l'ont pas de droit, abandonne Louis son fauteuil virtuel, condition qu'il ne s'assoie pas, et sans accompagner cet honneur d'honneurs ni d'aucun avantage pratique. En un mot, il le reconnat comme mconnu !
Guy Patin crit ( Falconet, le 28 fvrier 1662) : La reine est grosse et sur cette nouvelle, le roi a dit : Nous ne manquerons pas de petits Courtenay, cÕest--dire de pauvres princes, et incommods. Tout est l et rien de plus : sans prjudice ni implication, le roi cousine la mode de Bretagne avec ce lointain parent que tout le monde considre comme tel. Saint-Simon le note : les Courtenay portaient de France... sans qu'on les en ait empchs, et ont toujours drap avec le roi, ce qui jusqu' sa mort n'a t souffert qu'aux gens qui en avoient le droit (Saint-Simon, add. Dangeau dj cite). Draper sa maison de noir pour marquer la mort d'une personne royale, s'associer ainsi au deuil du roi, cela signe l'appartenance la famille.
L'indiffrence est peu probable, de la part d'un roi si soucieux de l'tiquette. Ces fantomatiques cousins respectueux semblent lui inspirer une ombre d'indulgence. Il est vrai qu' ses yeux, son sang personnel a une telle prminence sur le sang royal en gnral que ce dernier ne compte plus gure.
Une illustration : ds le dbut de son gouvernement, en 1662, le jeune roi laisse agrger sa famille royale les Princes Lorrains qui n'en sont pas, niant la biologie du sang. Ce faisant, il transgresse les "lois fondamentales", pour lesquelles, si le Roi fait la Loi, si le Roi est la Loi, il ne dispose pas de la Couronne ; Dieu seul y pourvoit par les voies naturelles du mariage lgitime ; agir autrement revient se substituer la Providence, et remplacer les voies de droit par des dcisions arbitraires ! Du Tillet l'avait dit : les Rois ne peuvent engendrer des Princes du Sang & des successeurs la Couronne par Lettres patentes.
Mais la politique ne se soucie pas de la Constitution du royaume. De Lionne, exploitant la situation dsespre du duc de Lorraine, Charles IV, le cauchemar de Richelieu, l'oblige lguer la Lorraine Louis XIV pour dguiser en fusion l'annexion dj ralise (cf. Spangler, 2003) : les princes du sang de Lorraine, dsormais rputs princes du sang de France, en auraient les privilges et donc accderaient la Couronne au cas (improbable) o les Bourbon s'teindraient jusqu'au dernier. Charles en rit, disant que plus habile qu'aucun Roi qui et jamais t, il avait fait vingt-quatre Princes du Sang dans un jour.
Ce Trait de Montmartre, sign le 6 fvrier 1662, les Princes et les ducs-pairs de France n'en veulent pas plus que le Parlement de Paris dont le Roi force l'enregistrement (27 fvrier). Le trait est invalid d'avance puisqu'il ne peut esprer la ratification de tous les Princes lorrains. Nanmoins, il blesse ceux dont la promotion putative des Lorrains affecte l'honneur, car il dispose que les Princes lorrains, s'ils marchent derrire les Princes du sang de France, passent devant tous les autres Princes issus de Maisons Souveraines trangres, ou enfans naturels des Rois & leurs descendans, & jouissent des privilges & prrogatives des Princes de son sang. Vendme, btard lgitim de Henri IV, qui jouit d'un rang intermdiaire entre les Princes et les ducs-pairs, rtrograderait d'une case, comme ces derniers. Quant nos Courtenay, ils seraient remplacs par les Lorrains comme roue de secours de la Monarchie.
Le Duc de Vendme prsenta une Requte, par laquelle il supplioit de considrer, qu'Henri quatre avoit rgl qu'il auroit le pas immdiatement aprs les Princes du sang, & que Sa Majest elle-mme le lui avoit conserv ; aprs-quoi il forma son opposition. Le Prince de Courtenai en fit autant. II ft suivi des Duc & Pairs, qui remontrrent, que la grce accorde aux Princes Lorrains blessoit leur dignit...
Vendme et les ducs & pairs remontrent contre l'augmentation du nombre de ceux qui les prcdent. Le Prince Louis, ds le 12 fvrier, crit au Roi pour la prservation des droits de sa Maison.
Le Mmoire prsent au Roy par Monsieur le Prince de Courtenay en suite de sa protestation, le 13 Fvrier 1662 ne conteste pas, il se dsole que ce trait rouvre une vieille plaie jamais gurie. Lorsque, au sicle prcdent, les Guise "carolingiens", cadets de Lorraine, voulaient tout avaler, on les a contenus en bloquant St Louis la "proximit la Couronne", ce qui, par ricochet, annihila les Courtenay. Et voil que, d'un coup, les Lorrains sautent par dessus St Louis et entrent dans le Sang dont les Courtenay restent exclus ! Voil un dernier outrage et une dernire injustice. Le Prince Louis s'attriste : des Captiens, il ne reste plus aujourd'hui que la famille du Bourbon rgnant... et les Courtenay oublis. C'est eux que la Couronne devrait revenir, si les Bourbon venaient manquer, non aux Lorrains, trangers au Sang et au royaume :... ne restant plus de la Maison Royale, que celle de BOURBON, qui Rgne heureusement en la Personne de Vostre Majest, & celle de COURTENAY, laquelle on veut faire le dernier outrage & la dernire injustice. Car SIRE, quoy qu'elle soit seule capable de succder la Couronne aprs la Maison de BOURBON, On a stipul au prjudice du droit de sa Naissance, dans le Traitt que V. M. vient de faire avec Monsieur de Lorraine, Que la Maison de BOURBON venant dfaillir, celle de Lorraine succderait la Couronne...
Cette "protestation" reste sans rponse. L'tonnant, c'est que Louis ose crire cela, le signer du titre de Prince, le prsenter au Roi, imprimer la lettre et la diffuser en toute impunit. En ce sens, cette "protestation" marque la fois l'apoge et le prige du satellite Courtenay qui, repouss encore plus loin par les Lorrains, arrive au point le plus avanc d'une offensive centenaire : cinquante-deux ans, le "Prince" Louis a publi ne restant plus de la Maison Royale, que celle de BOURBON... & celle de COURTENAY et on ne l'a pas sanctionn parce qu'il sait jusqu'o aller trop loin et prend garde de ne marcher sur les pieds de personne au-dessus de lui.
Avant de mourir dix ans plus tard (1672) il a le temps, en 1669, de marier son successeur, Louis-Charles, l'an de ses sept enfants vivants, alors g de vingt-neuf ans.
Louis-Charles, n en 1640 avec un prnom doublement royal, continuera son pre et bnficiera d'une exceptionnelle longvit ( 1723). Lui aussi sait se tenir, ne dispute le pas personne et ne prtend pas entrer chez le Roi en carrosse. Il hante la cour, comme une ombre, sans autre qualit que le vague cousinage admis par Louis XIV qui, l'occasion de la mort au combat de son fils, l'alla voir, ce qui fut extrmement remarqu, parce qu'il [le Roi] ne faisait plus depuis longtemps cet honneur personne et que M. de Courtenay n'avait ni distinction ni familiarit auprs de lui. Quand Louis-Charles essaie de marquer de nouveaux points, on l'carte sans mchancet : en 1695, tout incommod qu'il toit, il chercha payer les 2000 francs de capitation tarifs aux Princes du sang : On ne les voulut pas recevoir. Il soutint qu'il les payeroit en entier, ou rien du tout, et oncques depuis il ne l'a paye, mme depuis qu'elle fut rpartie autrement (Saint-Simon, ibid.). Bref, il peut dire, non faire ; affirmer, non confirmer. Quoiqu'il soit aussi (ou plus) habile que son pre et enrag procdurier, il n'obtient pas davantage. Dans le contexte de la querelle des lgitims, la protestation qu'il adresse au Rgent (1715) est un geste aussi ncessaire que vain.
Retraons rapidement la vie de Louis-Charles. J'ai dj mentionn Hortense Mancini et ses millions. Louis-Charles participe aux premires guerres de Louis XIV : on le voit la dsastreuse campagne d'Algrie (Jijel, 1664), en Flandres en 1667 ; bless au sige de Douai, il se signale encore celui de Lille & la guerre de Hollande en 1672.
En 1669, son pre le marie Marie de Bussy (Bucy), d'une branche cadette des Lamet (Lameth), ancestrale noblesse d'pe picarde. Avec sa sÏur Catherine, elle a hrit des biens et terres paternels par le dcs de leur frre et de leur mre en 1666. Marie ( 1676) donne deux fils Louis-Charles, Louis-Gaston (1669) et Charles-Roger (1671) : l'avenir de la princerie semble assur.
Louis-Charles reste veuf douze ans et, le 14 Juillet 1688, se remarie dans la robe. Il pouse la riche Hlne (1649-1713), veuve d'un prsident au grand conseil, Jean Le Brun ( 1676), une femme assez bien faite, mais qui n'est pas trop jeune dont Lauzun faisait l'amoureux. On dit qu'elle se moquait fort de lui (Mmoires de Mademoiselle). Elle est fille de Bernard du Plessis-Besanon (1600-70), grand serviteur de Marie de Mdicis, puis de Richelieu et de Mazarin. Sa famille est des plus nobles & plus anciennes & mieux allies de Paris, & qui a eu l'honneur d'avoir produit sept Conseillers du Parlement de pere en fils, depuis Hugues de Besanon qui l'estoit en 1314 (Blanchard, 1647, Catalogue des conseillers). Hlne, pouse d'un Louis-Charles qui tait fort inquiet de ses affaires et en tourmentait les autres, engendre, malgr son ge, une fille nomme Hlne comme elle (1689-1768).
L'espoir de Louis-Charles, son fils an, Louis-Gaston, fut tu mousquetaire au sige de Mons en 1691, sans postrit. Avec lui disparat l'avenir de la Maison. La porte se ferme, que les gnrations prcdentes avaient pein entrebiller. C'est peut-tre le vrai sens de la visite de condolance du Roi : finis. En ce qui concerne le garon, il n'y avait pas grand chose en dire, comme l'expriment joliment les Mmoires apocryphes du cardinal Dubois : C'tait un beau jeune homme de vingt et un ansÑ Je viens de faire en neuf mots toute son oraison funbre.
Familier mineur de la Cour, Louis-Charles voit ses moyens financiers rduits par le dcs de son pouse en 1713 : Madame de Courtenay mourut Paris aprs une longue maladie ; elle ne paraissait point en ce pays-ci [la Cour]. Elle avait un bien considrable qui faisait subsister M. de Courtenay qui va tre prsentement fort mal dans ses affaires car le bien de sa femme revient aux enfants qu'elle avait de son premier mariage avec le prsident le Brun (Dangeau, T.15, la date du 29 novembre).
Il fut sauv de son affreuse pauvret par les libralits de la Rgence. Dangeau ( la date 6. fv. 1720, T.16, p. 229) : Le roi a donn 200,000 francs M. de Courtenay le pre; on lui a donn le choix de cette somme ou de 20,000 francs de pension; il a mieux aim prendre les 200,000 francs. "Le roi", i.e. le Rgent, i.e. Dubois qui, commente Saint-Simon, quand il n'tait encore qu'un petit abb, avoit t reu familirement chez lui ; il s'en souvint, et lui procura cette grce sans qu'il et song en demander aucune. A peu prs en mme temps, le dernier fils, Charles-Roger reut aussi une gratification de Dubois qui se piqua de lui donner une part de ses gains dans la spculation du Mississipi : 200 000 francs d'actions. Ces cadeaux inattendus rpondent-ils la Protestation de 1715 ou cachent-ils quelque chose (cf. infra) ?
M. Charles-Lois, Prince de Courtenay, est mort Paris le 28. Avril dernier... Il tait fils de Louis Prince de Courtenay... crit Le Mercure de Mai 1723 (p 1005-6) qui termine sa notice ncrologique par : Les Gnalogistes font descendre la Maison de Courtenay de Pierre de France, premier du nom, septime & dernier fils du Roy Louis le Gros. Dcevante pitaphe !
A quatre-vingt trois ans, Louis-Charles expire avec la Rgence, en 1723, la mme anne qu'Orlans et Dubois, des suites d'une chute qu'il avait faite dans l'escalier du prsident Nicolay. Reste Charles-Roger, le fils cadet dpourvu du Louis magique, mari en 1704 Marie Claire Genevive, fille de Claude "de Bretagne", Marquis d'Avaugour, Comte de Vertus et Gollo. Quand Louis-Charles disparat, le couple n'a pas d'enfant. Il n'en aura pas. Charles-Roger ne reprend pas le flambeau : il servit peu et fut un trs pauvre homme et fort obscur quoique riche (Saint-Simon). Ce pauvre riche se suicide sans raison apparente en 1730 et, pour l'honneur, l'on affecte de croire un accident. Ainsi fine la seconde Maison Courtenay, alors que, en Angleterre, la premire Maison, oublie depuis deux sicles, va bientt rmerger.
4. La chute
Charles-Roger, l'ultime Courtenay, apparat comme l'homme de l'chec et du renoncement. C'est peut-tre pour corriger cette image et conserver ses droits que sa demi-sÏur Hlne aurait prtendu qu'il adhrait fidlement aux revendications familiales. Elle-mme, magnifie par son mariage avec Bauffremont, les affirmera hautement.
Le bavard Danjan, garde des archives du duc d'Orlans, tiendrait d'Hlne l'histoire suivante : le grand ge de Louis-Charles rapprochant le moment qui ferait de Charles-Roger l'hritier du nom et des droits, on (Dubois ?) proposa ce dernier de renoncer, pour lui et ses descendants, ce fantme de gloire. En compensation, il recevrait une pluie de bienfaits (dont les 200000 francs d'actions seraient les premires gouttes). Charles-Roger refusa avec indignation de sacrifier l'honneur de sa Maison. L'anecdote est publie par La Place qui Danjan l'aurait raconte (1786, Pices intressantes et peu connues, pour servir l'histoire, T. 2, p 182 sq.). Le rcit, avec quelque fantaisie, montre un Louis-Charles, inquiet, rassur firement par son fils.
Les faux Souvenirs de la marquise de Crquy (Courchamps, 1834-1835) en rajoutent sur le rcit de la Place, brossant du vieux "prince" un tableau gothique aussi spectaculaire que farfelu : dans un chteau mdival, sous une tente impriale entoure de symboles byzantins (auxquels il n'a jamais prtendu !), Louis-Charles met l'preuve la fermet de son fils. Tout est fictif, mais le rcit trop amusant pour ne pas le citer :
Le vieux Prince de Courtenay vivait encore... il entendit raconter au fond de son Auxerrois que... le Prince Charles-Roger s'tait engag par crit retrancher de ses armoiries l'cu de France... Le pre en tomba malade de chagrin ; il se coucha sous la tente de l'Empereur Baudouin de Courtenay, qu'ils faisaient toujours dployer pour achever les pousailles et pour se faire administrer l'extrme-onction. On crivit au fils de la part du malade, et le voil parti pour Czy. Il entra sous la tente impriale de ses grands-pres, qui se trouvait tendue dans le milieu d'une salle immense dont toutes les ouvertures taient fermes la lumire du jour. On entrevoyait un vieux Labarum, ou je ne sais quelle bannire de Byzance, au chevet de la couche. Le vieux prince tait couvert d'un grand linceul ; il avait l'air et la voix d'un mourant, et la scne tait claire seulement par quelques cierges qui taient placs sur une sorte d'autel avec des reliquaires...
Le vieux Prince se mit le sermonner sur la ncessit de ne plus se raidir contre les Bourbons, qui ne consentiraient jamais lui former un apanage, moins qu'il n'et rduit ses armoiries l'cusson de Courtenay proprement dit...
Ñ N'achevez pas, Monseigneur ! n'achevez pas ! ...
Ñ Mais s'il en est ainsi, reprit le vieillard, vous ne consentirez donc point diffamer nos armes...
Ñ Jamais ! jamais !
Ñ Monsieur, rpliqua vigoureusement son pre en se mettant sur son sant, c'est une rsolution qui vous fait honneur, et, du reste, elle est heureuse pour vous ; car, ajouta-t-il en tirant un pistolet de dessous son linceul, si je vous avais vu faiblir, j'allais vous faire sauter la cervelle...
Charles-Roger, le dernier Courtenay mle, se la fit sauter lui-mme en 1730, sept ans aprs la mort de son pre. Il tait riche, se portait bien, et sa tte et son maintien faisaient plus craindre l'imbcillit [la sottise] que la folie. Cependant un matin tant Paris, et sa femme la messe aux Petits-Jacobins, sur les neuf heures du matin, ses gens accoururent dans sa chambre au bruit de deux coups de pistolet tirs sans intervalle qu'il se tira dans son lit, et l'y trouvrent mort, ayant t encore la veille fort gai, tout le jour et tout le soir, et sans qu'il et aucune cause de chagrin. On touffa ce malheur qui teignit enfin la malheureuse branche lgitime de Courtenay (Saint-Simon, XIII, 9) car ce qui reste ne compte pas : le vieil abb des Echarlis ( 1733) et Hlne, blouie de sa fausse qualit de princesse.
Le glorieux Bauffremont et la folle Courtenay
M. de Baufremont, avec bien de l'esprit et beaucoup de bien et de dsordre, tait un fou srieux, trs sottement glorieux, qui se piquait de tout dire et de tout faire, et qui avait pous une Courtenay plus folle que lui encore en ce genre (Saint-Simon, XIV, 13).
Hlne de Courtenay, futurement hritire de son nom par la mort du prince Charles-Roger de Courtenay, son frre, nat du second mariage de Louis-Charles. Elle a 23 ans quand son pre la marie en 1712 Louis-Bnigne (1684-1755), chevalier de l'ordre espagnol de la Toison d'or, grand bailli d'Aval, marquis de Bauffremont, prince de Listenois, seigneur du duch de Pont-de-Vaux, vicomte de Salins et de Marigny, etc.
Dj bien pourvu de titres et de biens en Franche-Comt, il a hrit de son frre an, Jacques-Antoine ( 1710), et s'est enrichi de la succession Gorrevod, complexe affaire de double substitution dispute par les Bauffremont depuis 1681 et enfin tranche par le Parlement de Paris en 1712. Il trouve dans le paquet maintes possessions, ainsi que la dignit de Prince d'Empire de Gorrevod, aussi creuse que magnificente. On suppose que le prince Louis-Charles et Hlne de Besanon, sduits par tant d'clat, ont vid leurs caisses pour doter Hlne. D'aprs les registres de baptme, ce mariage produira, de 1712 1720, sept enfants vivants, dont quatre garons.
Le premier, n en novembre 1712, nomm Louis, a pour parrain son grand-pre, le prince Louis-Charles qui, n'esprant rien de son fils Charles-Roger, oint de royalit la richesse, l'illustration et l'orgueil des Bauffremont.
Ecartons-nous un instant de notre sujet pour examiner ces derniers.
Le pre, aussi haut que puissant seigneur en Bourgogne comtale espagnole, s'est ralli la France quand elle annexa le pays. Le rgiment Bauffremont-Dragons fait partie des armes du Roi.
Son fils an, Jacques-Antoine, prince de Listenay, pouse en 1706 Louise-Franoise, la seconde fille du comte de Mailly-Rubempr. Aussi relev qu'ait t le dfunt Mailly (menin du dauphin, mestre de camp gnral des dragons de France), c'est la mre qui compte, Sainte-Hermine, proche parente et protge de la toute-puissante Maintenon. Veuve depuis 1699, la comtesse de Mailly, sans biens et charge d'une troupe d'enfants (Saint-Simon, II, 24), trouve ses filles de riches poux grce la marquise. Louise-Franoise, Jacques-Antoine la prend sans dot. Il se rattrape l'anne suivante en escroquant sa belle-mre sous prtexte de se racheter d'une captivit imaginaire. Deux ans aprs, il en obtient la Toison d'or : Mme de Mailly, qui n'avait pas donn grand'chose Mme de Listenais [pouse de Jacques-Antoine] en mariage, fit en sorte, par Mme de Maintenon et Mme la duchesse de Bourgogne, de faire donner la Toison Listenais son gendre, malgr la belle quipe dont j'ai parl et dont elle avait t la dupe... Cette Toison parut assez sauvage, non pour la naissance, mais par toutes autres raisons (Saint-Simon, VII, 20, anne 1709). Jacques-Antoine est tu en dfendant Aire.
Son frre, le mari d'Hlne, Louis-Bnigne, militairement actif depuis 1701, lui succde la tte du rgiment familial et dans ses honneurs. En 1711, il se rend en Espagne restituer la Toison vacante par la mort de son frre et se la faire attribuer. Aprs les siges de Douai et du Quesnoy (sept., oct. 1712), Louis-Bnigne ne participe plus aux oprations de la guerre de succession d'Espagne.
La mort du roi en 1715 entrane un grand remue-mnage. La Rgence et la mauvaise sant du petit roi Louis XV rendent aigu la question successorale. Les Princes du sang rclament contre les lgitims. Ceux-ci dnient la comptence du Parlement. Les Ducs-Pairs prtendent gouverner. Les simples ducs se soulvent contre eux. Dans cette confusion, la "noblesse" s'agite contre les Ducs, s'assemble et demande les tats-gnraux. Bauffremont se prcipite dans cette petite Fronde dont le Rgent refuse de recevoir le manifeste contre les ducs et princes. Orlans rappelle svrement cette noblesse qu'il est son chef au nom du roi et qu'elle n'a pas le droit de s'assembler d'elle-mme. Si d'aucuns sont impressionns et abandonnent, nombre d'irrductibles (excits en sous-main par la duchesse du Maine) envoient au Parlement de Paris le 17 juin 1717 un acte sign de 39 gentilshommes, par lequel ils protestent de nullit de tout ce qui s'est fait dans l'affaire des Princes au conseil de Rgence et de tout ce qui sera fait sans l'assemble des tats gnraux, attendu qu'il s'agit de la succession la couronne et que le droit d'y nommer appartient la noblesse (Mathieu Marais, d. 1863, T.1, p 206-7). Les six meneurs emprisonns (dont notre Bauffremont), qui la Bastille, qui Vincennes, sont librs rapidement le 16 juillet, aprs l'Edit dgradant les lgitims. Pendant ce mois, la plupart des femmes de MM. les gentilshommes prisonniers ont permission de les voir; mais on l'a refus schement madame de Bauffremont qu'on accuse d'avoir tenu des discours trs-forts (Dangeau, T 17, p 116-7, la date du 25 juin).
Saint-Simon s'emporte contre Bauffremont et ses amis qui prtendent reprsenter la Noblesse que, pour lui, seuls les Ducs-Pairs incarnent. Il s'exclame : avec de l'esprit et de la valeur et un des premiers noms de Bourgogne, il serait difficile d'tre plus hardi, plus entreprenant, plus hasardeux, plus audacieux, plus fou, qu'il l'a t toute sa vie.
En effet, Bauffremont accumule les provocations : il mortifie les marchaux de France, puis agite la Bourgogne contre son gouverneur, le Prince de Cond.
Quoique le nom de Louis-Bnigne ne soit pas cit, comment ne serait-il pas ml aux intrigues embrouilles de la duchesse du Maine ? La conspiration de Cellamare qui clate en dcembre 1718, vient point pour justifier la guerre contre l'Espagne (janvier 1719). Bauffremont, arguant de sa Toison, en fait dispenser son rgiment par le Rgent (L'obissance et la reconnaissance prtendent avoir mme empire sur moi). Exclus par consquent de la promotion d'officiers gnraux du 1er fvrier destine remplir les cadres, il sera promu le 16 juillet et, l'automne 1719, rejoindra Berwick en Catalogne. Ensuite, la longue parenthse pacifique Dubois-Fleury met les guerriers en vacance. Bauffremont cde son rgiment son fils en 1730 et prend part la guerre de succession de Pologne qui commence en 1733. En 1734, il est nomm Marchal de Camp, puis en 1738 lieutenant-gnral des armes du roi, sans servir en cette qualit. Il mourra en 1755.
Nous nous sommes un peu loign d'Hlne pour caractriser son entourage et donner le contexte de l'incident de 1737 qui, fortuitement, condamne la revendication courtenaise.
Le coup d'arrt de 1737
Dans les annes 1730, en Franche-Comt, Louis-Bnigne est assign justifier la qualit de Haut et Puissant Seigneur qu'il a prise dans un acte nommant le juge d'une de ses baronnies, acte soumis pour validation la chambre de Vesoul dont le procureur objecte : les Edits de nos anciens souverains [espagnols] portent qu'il ne sera loisible qui que ce soit de se qualifier noble, s'il ne l'est d'anciennet ou par patentes du Prince ; que nul ne pourra se qualifier de "haut et puissant Seigneur" s'il n'est issu de Maison tenue de toute antiquit pour illustre et principale.
Il semblerait pourtant que la hauteur de Bauffremont soit si notoire dans la comt qu'elle n'ait pas produire ses preuves chaque procdure, mme si l'on doute que la Maison de Bauffremont tire son origine de Baufremontius Roi des Bourguignons vers l'an 417. Y-a-t-il de la malice dans l'exigence du procureur ou simple routine de procdure ? Chaque Maison tient prt son dossier de pices justificatives. Vingt ans plus tard, Louis, le fils, aura la mme affaire avec, cette fois, la chambre des comptes de Dle. On l'enjoindra le 22 mars 1753 ; ds le 26, il fournira ses pices et le 30 la chambre rendra un arrt qui le maintient dans sa qualit : une semaine. Mais son pre, le glorieux Louis-Bnigne, s'irrite, peut-tre cause de contingences locales dont nous ignorons tout. Son dfenseur, Pouhat de Tallans, avocat au Parlement de Besanon, rpond longuement, de manire circonstancie, en rcusant le droit du procureur contester sa qualit (Mmoire pour messire Louis-Bnigne, marquis de Bauffremont... contre le sieur Jean Champion, procureur du roy au bailliage et prsidial de Vesoul).
Jusque l, rien qui nous concerne. Mais le mmoire de Pouhat de Tallans fuite et se publie Paris, comme portant sur un dtail curieux qui intressera les lecteurs. De larges extraits de ce monument la grandeur du Bauffremont paraissent dans les Observations sur les crits modernes (1736, Lettre 99) dont le directeur, Desfontaines, est friand de polmiques. Entre autres illustrations de l'excellence de son client, l'avocat mentionnait que, pour l'admission de ses fils au sein des chevaliers de Malte, les preuves de noblesse furent remplaces, du ct paternel par la liste des alliances pures et distingues de sa famille et pour ce qui est du ct maternel, ils n'ont eu qu' vrifier que Madame leur mre est Hlne de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France. Au moyen de cette filiation et par le respect qu'on porte partout ce Sang auguste, il a t dcid dans un Chapitre Gnral... qu'ils taient dispenss de toute autre preuve.
Rappelons le secret du vieux Louis, ne rien faire volontairement qu'on pt opposer leur droit. Hlne
a dj pris la qualit de princesse du sang royal dans des actes privs, son contrat de mariage, certains actes baptistaires de ses enfants. Ici, le zle de l'avocat la lui donne dans une pice judiciaire que la presse diffuse. Si les mots problmatiques taient rests enfouis dans les armoires du greffe de Vesoul, au fond d'une Province, l'extrmit du Royaume, nul ne s'en serait souci. Mais les voil exposs au grand jour, les salons bavardent et nul doute que Hlne et Louis-Bnigne ne s'en vantent.
Princesse
de sang royal passerait la rigueur : c'est ainsi que sera qualifi le duc de Penthivre, dernier
reprsentant
mle des Lgitims dbouts. Mais du sang royal est rserv aux Princes capables de la couronne, leurs enfants lgitimes et, par extension mtaphorique, leur pouse. Hlne n'est rien de tout a. S'agit-il d'une provocation ou d'une bvue de Pouhat de Tallans ?
Le premier avocat-gnral du roi au Parlement de Paris s'offusque : Gilbert de Voisins (1684-1769), en poste depuis vingt ans (1718), prcdemment membre du Conseil des Finances du Rgent, et plus tard conseiller dÕEtat (1740), 1er Prsident du Grand-Conseil (1744), conseiller dÕEtat ordinaire (1747), membre du Conseil des Dpches (1757). Un personnage important et expriment, rput pour sa rectitude, son dvouement au roi et sa connaissance de la procdure. Il a vcu l'affaire des Lgitims et subi les arguties sur le sang et les droits de nature dont elle a t l'occasion.
Il saisit le Parlement et requiert que les mots Heleine de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France soient biffs du mmoire, interdits d'emploi Bauffremont et tous autres, et que la lettre 99 des Observations soit supprime. Gilbert de Voisins, en homme srieux, reprend toute l'affaire depuis Henri IV. S'agissant d'un cas qui intresse le Roy, l'Etat, & la Cour, il porte lui-mme la parole des gens du roi. Des choses qui, hasardes au loin resteraient indiffrentes, ont t mises sous nos yeux ; nous ne pouvons pas garder le silence. Voisins argumente sur la forme (usage illicite d'une qualit non reconnue), sans luder le fond de la question : il rappelle (et tous les mots font mouche) les tentatives de quelques personnes de la maison de Courtenay pour s'arroger, s'il et t possible, quelque commencement de possession d'une pareille qualit ; il souligne l'enjeu : que le caractre auguste qui distingue en France les Princes du Sang Royal ne puisse au gr de l'opinion et des conjectures, devenir l'objet d'ambitieuses prtentions... et le danger d'un tel prcdent : l'exemple demeurerait toujours capable de tirer consquence pour d'autres Maisons.
Lisons en entier l'Extrait des Registres du Parlement que publie le Journal Historique sur les Matires du temps, 1737, T.41, p 180 :
CE JOUR [7 fvrier 1737], les Gens du Roy sont entrez, & Matre Pierre Gilbert de Voisins, Avocat dudit Seigneur Roy, portant la parole, ont dit :
Qu'il ne leur est pas permis de se taire sur un Mmoire imprim du sieur Marquis de Bauffremont, qui d'ailleurs leur seroit tranger par son objet dont la connoissance est soumise un autre Tribunal : mais dans lequel ils trouvent ce qui intresse le plus ncessairement leur ministere, & ce qui appartient le plus immdiatement l'autorit de la Cour.
Qu'on y lit la page 7. que la Dame Marquise de Bauffremont est effectivement Heleine de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France : & que comme si ce n'toit pas assez qu'un tel Mmoire et t hasard au fond d'une Province, l'extrmit du Royaume ; un Ecrivain qui met au jour des feuilles successives, sous le titre d'Observations sur les Ecrits modernes, vient de lui donner un nouveau degr de publicit Paris, jusques sous nos yeux, par l'extrait qu'il en a fait dans ses feuilles du 12 Janvier, dans lequel il a transcrit les propres termes de l'endroit o est employe cette qualit,
Qu'ils [les gens du roi] ne s'tendront point sur ce qui se passa en la Cour au commencement du dernier sicle, aux premires tentatives de quelques personnes de la maison de Courtenay, pour s'arroger, s'il et t possible, quelque commencement de possession d'une pareille qualit. Que les monumens qui reposent dans le Greffe de la Cour en font foi : & que ce qu'on y voit ce sujet sera jamais une preuve mmorable du zle de ceux qui exeroient alors le Ministre, dont ils ont l'honneur d'tre revtus.
Mais que ni la mmoire des choses passes, ni l'exemple de leurs Prdcesseurs, ne sont ncessaires pour autoriser une dmarche qu'ils ne pourroient omettre, sans manquer au plus sacr de leurs devoirs, & sans tre responsables de leur silence au Roy, l'Etat, & la Cour.
Qu'on ne peut trop sentir de quelle extrme consquence il est, que le caractre auguste qui distingue en France les Princes du Sang Royal, ne puisse au gr de l'opinion & des conjectures, devenir l'objet d'ambitieuses prtentions. Qu'autrement, plus une Maison seroit illustre, plus les traces de son ancienne origine se perdroient dans la nuit des tems reculez, & plus il lui seroit facile de se laisser blouir aux ides flateuses dont la tmrit ou l'artifice chercheroient repatre son ambition : & que lors mme qu'elle viendroit s'teindre, son exemple demeureroit toujours capable de tirer consquence pour d'autres Maisons.
Que ce sont ces considrations, dont la Cour saura mieux peser encore toute l'importance, qui leur ont dict les Conclusions qu'ils ont l'honneur de lui remettre, avec le Mmoire, & les Feuilles imprimes, qui en sont l'occasion, & le sujet.
La Cour dlibre et rend un arrt conforme aux conclusions, interdisant d'employer lesdits Titres & Qualit pour ladite Heleine de Courtenay, & notamment tous Libraires & Imprimeurs, & tous autres, de les employer dans aucuns livres ou Imprimez &c., et condamnant les biffer dans le Mmoire et dans les Observations. C'est tout : aucune punition, juste un rappel la Loi pour Baufremont et tous autres.
Depuis Henri IV, les Courtenay tardifs rclamaient un jugement dont le Chancelier avait dit, menaant : l'on vous fera justice mais non pas telle que vous la demandez. Si, depuis, les Courtenay se sont fait connatre comme mconnus, la mort du dernier mle clt le dossier : impensable de s'arroger quelque commencement de possession d'une pareille qualit.
Hlne prend feu. Elle attend Louis XV au bas du petit escalier par o il rentre quand il revient de la chasse (Luynes), dmarche incongrue qu'aurait autorise le Cardinal Fleury. Elle lui tend la Requte de Hlne de Courtenay contre un arrt du Parlement de Paris, du 7 fvrier 1737, qui lui a ray la qualit de princesse du sang royal de France. Le roi ne la lit pas mais, travers le Roi, c'est au public qu'elle s'adresse, excitant l'intrt par son geste "hroque". Les gazettes hollandaises diffusent Paris ce qu'il serait imprudent de publier en France : la Lettre historique & politique concernant l'tat prsent de l'Europe d'avril 1737 (T. 102, pp. 454-472, Amsterdam), donne le texte intgral de cette Requte (repris en 1739 par le Supplment au corps universel diplomatique du droit des gens, T.2, pp. 589-592, La Haye-Amsterdam). Admirons la vitesse des ractions : les extraits du Mmoire Bauffremont sont publis Paris en janvier, l'arrt du Parlement date du 7 fvrier, Hlne porte sa requte au roi le 22 fvrier, le texte est diffus en avril ! On en parle beaucoup, comme en tmoigne le duc de Luynes (Mmoires, T.1, p. 198-9) : La requte de Mme de Bauffremont fait ici beaucoup de bruit. Elle est de la maison de Courtenay et prtend par cette raison tre princesse du sang de France, et ce n'est pas, ce qu'il paroit, sans beaucoup de fondement... elle paroit soutenir sa prtention avec beaucoup de vivacit.
J'allongerais trop mon propos en dtaillant cette plaidoirie habile et bien compose, si proprement crite que, mme quand Hlne, enrage, aurait imit la duchesse du Maine en couvrant son lit d'in-folios et en passant les nuits rdiger, trois semaines n'y suffiraient pas. Les Bauffremont et les Voisins habitent ct, les premiers rue Taranne, les seconds rue de Seine. Ils se rencontrent chez des tiers. Voisins les a-t-il informs par avance ? A moins que, en publiant le mmoire de l'avocat, Louis-Bnigne et/ou Hlne aient anticip la suite et prpar leur riposte avec Pouhat de Tallans ; ou bien enfin que, depuis la mort de son frre (1730), Hlne, prvoyant un clash, invitable prsent qu'aucun mle n'assume plus la posture, travaille sa dfense au lieu de s'occuper de broderie.
Hlne assimile subrepticement de sang royal et du sang royal. Elle crit de, au dbut, et une seule fois : [Le roi] n'a jamais dfendu aux Princes de Courtenay de se qualifier de Princes de Sang Royal de France, qualifications qui dsignent des Princes descendus d'une autre branche de la Maison de France que la Branche rgnante (p. 457). Soit. Mais ensuite, elle substitue constamment le du au de en nommant les Courtenay princes du sang royal, expression qu'elle croit justifier en la distinguant de princes du sang tout court (branche rgnante). Ce glissement trahit le caractre douteux de la formule qu'elle adopte et revendique.
Elle emploie l'ternelle astuce en deux temps : 1) le roi ne nous l'interdit pas, c'est donc qu'il le permet ; 2) s'il le permet, c'est donc qu'il le veut ! Les trois rois Bourbon, en nous refusant les honneurs, ont cependant "voulu" nous laisser la qualit : si lÕon pouvoit supposer dans ce grand Monarque une autre Volont, il leur auroit dfendu de prendre ces Qualitez.
Renonant aux honneurs inaccessibles, elle veut seulement ce que les rois ont "voulu", ce que le droit de nature les oblige vouloir :
...La Suppliante convient (quelque triste & douloureux que soit cet aveu pour elle) que ses Ayeuls n'ont p parvenir se faire accorder le Rang & les Honneurs attachez depuis Henri III. au Titre de Prince du Sang: Quoique, ni sous ce Regne, ni sous aucun autre, on ne leur ait jamais contest dÕtre descendus en Ligne directe de Pierre de France, dernier Fils de Lous VI... elle soutient, que jamais V.M. ni les Rois ses Prdcesseurs (seuls en droit de juger ce Point important) nÕont decid qu'ils ne fussent pas Prince du Sang Royal de France. Si votre Auguste Bis-Ayeul [Louis XIV], qui ils en demandrent les Prrogatives, en lui prsentant leur Gnalogie, les leur refusa, il leur en laissa du moins le Titre ; persuad, que rien ne pouvait leur ravir ce quÕils ne tenoient que de la Nature.
Notez les deux points essentiels :
1) la Nature lui a donn sa qualit : le sang royal est natif. Hlne prend cette condition ncessaire pour suffisante. Un pamphlet clbre de 1717 en faveur des Lgitims (Memoire instructif...) s'exclamait de mme : QuÕest-ce quÕun Prince du Sang, selon la nature ? CÕest un homme issu du sang dÕun Roi (p. 11). Hlne : il [le feu roi] savait, on le rpte ici, que la Nature les leur ayant donnes [ces qualits indicatives de leur Maison], la Nature seule pouvait les leur ter... Le Parlement n'a donc pu ter la Suppliante un droit qu'elle ne tient que de la Nature... parce qu'il n'est point d'Autorit suprieure celle de la Nature ou [se reprend-elle], s'il y en avait, ce serait la seule personne de V.M. qu'elle se trouvait dvolue ;
2) la filiation est une chose qui
vient de la nature, les honneurs associs une autre. Le roi n'a pas interdit aux Courtenay le titre de
Prince du sang royal lorsqu'il leur en a refus les prrogatives : Le feu Roi... Matre des rangs dans son Royaume, nÕa voulu en accorder quÕaux Princes de sa Branche : Princes, par cette Raison, qualifiez seulement de Prnces
du Sang. Ce grand Roi, persuad que les Droits de la Nature sont inviolables, persuad que lÕon ne peut descendre en Ligne directe & lgitime dÕun Roi de France, sans tre Prince
du
Sang Royal de France, nÕa jamais dfendu aux Princes de Courtenay de prendre ce Titre. Ils lÕont pris devant sa propre Personne... SÕil leur a donc refus les Honneurs accordez aux Princes de sa Branche, il a en mme tems voulu que les Princes de Courteney demeurassent en possession de prendre les Qualitez indicatives de leur Maison. Si lÕon pouvoit supposer dans ce grand Monarque une autre Volont, il leur auroit dfendu de prendre ces Qualitez: mais il savoit, on le repete ici, que la Nature les leur ayant donnes, la Nature seule pouvoit les leur ter.
Extrapolation audacieuse !
Avec une feinte navet, la suppliante demande "seulement" conserver la qualit indicative de sa naissance, une identit, non un tat : la Suppliante est en Droit de se qualifier Princesse
du Sang Royal de France. Cette Qualification forme la seule & simple Indication du Sang dont elle sort: elle nÕen reoit, ni Rang, ni Prrogatives : elle ne prend point la Qualit de Prncesse
du Sang laquelle ces Honneurs ont t accordez & qui nÕa t communique quÕaux seules Princesses de la Branche Regnante...
Nul doute que Hlne, au moins en priv, continue se dire princesse du sang royal de France, qualit illusoire qu'elle ne peut transmettre ses enfants, la descente "directe" par mles tant interrompue.
D'ailleurs, les Bauffremont eux-mmes frlent l'extinction. Louis, le fils an d'Hlne et de Louis-Bnigne, brillant soldat couvert de titres militaires, n'a qu'une fille. Son frre, Charles-Roger, le prince incomparable de Mmes du Deffand et de Boufflers, s'amuse la cour de Stanislas ; quoique toutes les mres le poursuivent, il ne se mariera pas. Le plus jeune, Franois-Auguste, disparat tt ou se rvle incapable. Seul le second frre, Joseph-Franois, pourrait engendrer le fils ncessaire mais, quarante-huit ans, chef d'escadre des armes navales, il n'est pas mari.
Louis-Bnigne mort (1755), Louis, le nouveau chef de la Maison, ne dispose pour la conserver que de mauvais moyens : une fille et un frre clibataire. Il rsout le problme en les mariant ! En 1762, il unit la gamine de douze ans Joseph-Franois, son vieil oncle, combinaison qui, alors, ne choque pas. Leur premier enfant natra en 1770 : une fille. Le garon (Alexandre) viendra en 1773. Il assumera la succession, et mourra en 1833, prince de Bauffremont et du Saint-Empire, marquis de Bauffremont et de Listenois, comte de l'Empire (1810), pair de France (1815), premier duc de Bauffremont (1817), chevalier de lÕordre royal et militaire de Saint-Louis. Par ses fils, la ligne des Princes de Bauffremont-Courtenay se continuera jusqu' aujourd'hui.
Mais, irrmdiablement, le suicide de Charles-Roger (1730) et son absence de postrit, ont mis fin la descente directe par mle de Louis VI par laquelle Hlne se prtendait "par le droit de la nature" princesse du sang royal de France.
Conclusion. Le droit et le fait.
Saint-Simon : L'injustice constante faite cette branche de la maison royale lgitimement issue du roi Louis le Gros est une chose qui a d surprendre tous les temps qu'elle a dur, [...] d'autant plus que nos rois ni personne n'a jamais dout de la vrit de sa royale et lgitime extraction (Mmoires, d. Chruel, 1874, XII, 13, p. 265).
La monarchie aujourd'hui dsacralise, il est facile d'apporter une solution cette nigme : la royale et lgitime extraction, quoique ncessaire, ne suffit pas.
En droit, oui, nos sieurs appartiendraient au sang
royal de France (¤1). Mais,
en fait, non. ætre exige de paratre : or, sans tat et sans consistance, ces Courtenay ne sont pas hommes
exister, et par consquent, compter. En outre, la
rduction du primtre de la dynastie est fatale ces fossiles indistincts, incrusts dans une couche sdimentaire primitive (¤2).
Inclus en droit
Justifier cette inclusion oblige examiner rapidement la dvolution de la couronne. Pour le lecteur qui, rebut par l'aridit du sujet, passerait directement au paragraphe suivant, je rsume sommairement : la Couronne, grandeur par excellence, n'est jamais vacante : le mort saisit le vif et s'empare instantanment du mle le plus proche, fallt-il, pour le trouver, remonter Louis VI. CQFD.
La lgitimit incertaine des premiers Captiens les poussa idaliser le sacre dont la mystique unit le roi Dieu, aux Grands et au peuple. En usant des moyens dont ils disposent de leur vivant, ils font sacrer par avance leur fils an, ainsi dsign et accept comme successeur (rex designatus). De Capet Philippe Auguste, ils travaillent imposer aux Grands l'hrdit de la Couronne, parfois dispute l'an par un cadet rebelle. Jusqu' Philippe le bel, ces rois engendrent, parfois laborieusement, au moins un fils lgitime survivant qui lui-mme obtient une progniture mle. Divorces et remariages contribuent au "miracle captien".
Il en va ainsi jusqu' l'hritier de Philippe le bel, Louis X le hutin, roi de 1314 1316. Ce Louis et-il dur plus longtemps, et-il eu un fils vivant, sa fille et-elle pu s'imposer, la succession serait reste verticale. A dfaut, elle passe l'horizontale, le frre pun du Hutin s'empare de la couronne : Philippe V rgne de 1316 1322, laissant seulement des filles que son frre, son exemple, ignore. Charles IV, son tour, meurt sans fils (1328).
Drame : voil la Couronne suspendue en l'air. Les rgles en vigueur ne savent pas traiter ce problme sans prcdent, choisir entre filles, fils de fille et cousin. Philippe V et Charles IV s'taient couronns sans dbat, par la force et la ngociation. Ils taient fils de roi et n'ont pas pos la question juridique de l'habilet des filles la couronne que d'autres royaumes (Castille et Navarre) admettent et que, plus tard, en Angleterre, quand le jeune Edward VI mourra (1553), la conjoncture politique imposera (Maria, rex).
Le cousin Valois s'assure le soutien des Grands et devient Philippe VI. Son accession provoque une longue et profonde crise qui conduira affirmer la perptuit du sang royal mle, distinguer la Couronne de son porteur, et reconnatre la transcendance de la premire.
Avant d'examiner l'argumentation "constitutionnelle", visualisons la transmission de la Couronne, du dbut des Captiens la fin ventuelle des Bourbons (¯?) : je marque en gras les rois, en traits pleins les successions de pre en fils, en pointills les transitions entre lignes et, avec des tirets, l'hypothse Courtenay.
La question des filles nous intresse ici parce que leur viction loigne encore le droit de la Couronne de celui des fiefs. De plus en plus, le fief est chose prive et la Couronne chose publique.
Si les Libri feodorum lombards (c. 1125) n'ont pas t reus en France, leur inscription dans le jus civilis au cours de la priode XIIIe-XVe et leurs clbres commentaires (Balde en particulier) en font une rfrence. La patrimonialisation des fiefs conduit leurs titulaires les lguer leurs descendants (s'ils en ont) au lieu de les laisser retourner aux seigneurs primitifs. Pour reculer cette chance, les familles tendent la successibilit aux collatraux, d'abord proches, puis lointains, jusqu'au septime degr. En 1393, Balde, dans un passage qui deviendra clbre (Arabeyre, 2003), donne en exemple le changement de ligne royale advenu en France en 1328 (Valois) mais va plus loin. En raison de la spcificit de la Couronne qui ne peut pas tomber en dshrence, il pousse la successibilit sa limite asymptotique : si toute la maison royale [Valois] mourait et qu'un homme du sang ancien se levait : supposons la maison de Bourbon, et qu'il n'y en ait pas d'autre plus proche, ft-ce au millime degr, et pourtant il succderait dans le royaume des Francs par droit de sang et coutume perptuelle...(esto quod esset millesimo gradu, tamen jure sanguinis & perpetu¾ consuetudinis succederet in regno francorum). Le "millime degr" (des centaines de sicles) renvoie des temps immmoriaux, c'est--dire au nant historique. Cette exagration rhtorique signifie la perptuit du sang royal, et de lui seul.
Cardin Lebret exprimera ainsi la diffrence (1632) : bien que rgulirement la consanguinit finisse au dixime ou au septime degr [...] d'autant que aprs une suite de tant de gnrations, la nature ne connait plus de parents, nanmoins cela ne s'est jamais gard en la succession de royaume (I, 4:12).
S'il y a plusieurs successeurs possibles, les degrs se mesurent par rapport, non pas au prdcesseur immdiat mais au premier dtenteur de la dignit (gnarque) auquel chacun, l'un aprs l'autre, a d la sienne : Y et Z se disputant la succession de X, on ne doit pas comparer le nombre de degrs (montants et descendants) entre chacun d'eux et le dfunt X, mais compter ceux qui les sparent de l'anctre commun. Ainsi, mme en supposant Isabelle capable de communiquer son fils le droit qu'elle n'a pas, Philippe de Valois, plus distant de Charles IV qu'Edward mais petit-fils de Philippe III, l'emporterait encore sur lui qui en est arrire-petit-fils.
Giesey, dans son article fondateur (1961), souligne que, pour Balde, chaque investiture raffirme la premire : le fils reprsente l'anctre, comme le fit le pre. Fin XVe, dbut XVIe, cette conception se renforce de la distinction romaine entre hritier dÕhritage (hereditas), qualit qui s'attribue ou non, s'accepte ou non ; et hritier du sang (suitas) : ce dernier est ncessaire, il ne peut, ni tre cart, ni refuser. Quel que soit le nombre de degrs, la substitution s'opre. Si le dfunt ne laisse pas de postrit, l'hritier, aussi lointainement collatral qu'il soit, prend la place du fils manquant. Plus encore, il se substitue lui. Une espce d'adoption posthume.
Une fille peut-elle tre ce fils ?
La biologie aristotlicienne qui domine alors privilgie le sperme, suppos driver du sang : Le
mle
fournit la forme et le principe du mouvement, la femelle le corps et la matire. Droit du sang signifie "droit du sperme" (Miramon, 2019) car, si les filles sont aussi du
sang, il finit en elles. Le fils d'une fille (Edward), "programm" par son pre (Plantagent), ne conserve pas le sang
de sa mre et ne le transmet pas. Au contraire, les garons, par leur sperme, projettent la force sacre reue de Dieu sur leurs fils, lgitimes ou mme btards, forgeant un nouvel anneau de la chane dynastique.
Au demeurant, c'est la force qui tranche, pas la controverse dans laquelle il est difficile de voir clair car nos historiens du Droit se rfrent des auteurs mdivaux, pour la plupart peu connus en leur temps et d'influence incertaine (tel Terrevermeille), qui n'mergeront qu'au XVIe sicle, quand l'imprimerie diffusera leurs Ïuvres et que les problmes auxquels ils rpondaient auront trouv leur solution au cours d'tapes cruciales. Les rgles de succession se sont fixes historiquement et pratiquement : continuit mle dans la ligne et, en cas d'extinction, transmission l'an de la ligne la plus proche. Quand viennent les "publicistes" du XVIe et les grands thoriciens de l' "absolutisme" du XVIIe, ils vulgarisent, formalisent et systmatisent ce qui est dj une vidence coutumire : la transcendance de la Couronne qui, d'un ct rend absolue l'autorit de son agent, et de l'autre le limite.
En effet, le roi, tout puissant vivant, ne compte plus mort. De quelque faon qu'il ait cru disposer de la Couronne et du Royaume, sa volont personnelle ne lui survit pas, comme en tmoignent la dnaturation immdiate des testaments de Charles V, de Louis XIII, de Louis XIV, ainsi que l'chec de l'exhrdation du dauphin par Charles VI, et de Navarre par Henri III. Si le roi se croit propritaire de la Couronne, les actes qu'il s'autorise sont nuls et disparaissent avec lui.
Seule importe la carte du sang qui identifie, positionne et hirarchise tous les mles capables de la couronne du fait de leur ascendance : les fils du roi dans l'ordre de leur naissance, ses frres, ses oncles, et ses cousins, des proches aux plus lointains, sans que jamais la consanguinit ne cesse. Au-del de l'ultime degr canonique, civil, et mme mmoriel, la perptuit de la Couronne (dignitas numquam moritur) entrane celle du sang.
Telle est la justification de nos Courtenay : en l'absence d'hritier mieux plac, la Couronne tomberait sur leur an.
Hlas pour eux, leur droit est purement thorique.
Exclus en fait
Deux raisons se renforcent l'une l'autre : ils sont sans tat (i) et sans attache (ii). Or le lien au "gnarque" doit tre apparent, constitu, rput et accept ; et ce gnarque lui-mme, qui est-ce ? Balde ne s'en soucie pas, restant dans l'abstraction (millime degr). Dans la srie des anctres royaux, auquel s'arrter ? Priam ? Pharamond ? Non : Les mdivaux construisent le sang partir dÕun point de dpart, pre, grand-pre ou personnage minent dÕune dynastie constituant un point de fixation mmorielle. Cette origine nÕest donc pas un anctre mythique ou lointain et le sang nÕest pas quelque chose de diffus dans une vaste population. Les membres du sang sont choisis parmi les descendants mles du point de dpart. En un mot, il sÕagit le plus souvent de frres, cousins germains, ou dÕoncles et de neveux paternels. Nanmoins, les rgles gnalogiques ne sont pas dÕairain ; un parent mme lointain peut tre associ au sang sÕil est un fidle particulirement apprci (Miramont, 2008, p. 40). Ajoutons que ce consensus mmoriel volue, dplaant l'origine. Ces translations n'annulent pas les "gnarques" antrieurs, elles les dvalorisent.
i)
sans
tat
Si les Courtenay ans avaient ce qu'il fallait pour paratre, leur disparition n'en transmet rien aux cadets survivants dont ils ont diverg. Pierre II, richement mari des hritires qui le font comte, ses descendants se glorifient du titre ronflant d'empereur d'Orient qui, tout illusoire qu'il soit, les met de pair avec les souverains europens. Aprs la mort du dernier mle (1283), Charles de Valois pouse sa fille. Ils donnent deux demi-sÏurs au futur roi Philippe VI : l'une se perdra dans les intrigues de la cour de Naples et l'autre dans les dboires de son mari, le fameux Robert d'Artois, tratre et flon.
Reste la ligne cadette. Son fondateur, frre de Pierre II, Robert de Champignelles, a jou un rle important, guerroy aux cts de Louis VIII et reu de lui l'un des principaux offices royaux. Mais son improbable successeur, Guillaume, n'en profite gure et les gnrations suivantes se rduisent leurs terres comme tant de familles qui furent un jour grandes. La rapparition de tel ou tel dans l'entourage royal est personnelle et ne doit rien son origine. Lorsque, partir de Henri IV, Blneau et Chevillon rclament une place au soleil, il leur faut s'identifier pniblement car ils n'ont pas de figure.
D'innombrables Maisons se sont ainsi vanouies dans leur obscurit. Les termites du temps rongent les arbres gnalogiques qui s'effritent et se dcomposent. Parfois, un baliveau voisin aura l'air d'un surgeon qui revivifie le vieil arbre, comme le petit Rasse avec Saint-Simon et Vermandois. Nos cadets Courtenay, eux, n'ont pas eu la chance de fournir un roi quelque favori, matresse ou hros, qui les aurait relanc et re-li leur origine.
Rares sont les Maisons qui, comme les Bourbon, rsistent l'usure des sicles. En 1272, Robert, fils cadet de S.Louis qui l'a apanag du comt de Clermont en Beauvaisis, pouse Batrice et l'hritage de Bourbon. Leur union forme la Maison de Bourbon-Clermont : ducs et pairs dans la branche ane, comtes dans les branches cadettes, ils participent aux vnements, nouent de grands mariages, accumulent charges, fiefs, clients et richesses. Si Franois Ier dpouille et honnit le trop riche et puissant Conntable, aprs la mort du Duc d'Alenon (1525), il dclare Charles IV de Bourbon-Vendme seconde personne du royaume (aeul commun : S. Louis). Le nom de Bourbon, rendu clbre par toute la terre (Du Tillet), ils sont, sinon prdestins comme on l'crira sous Louis XIV, du moins marqus aux yeux de tous de l'estampille royale. Prfixe, thurifraire de Henri IV, admire ...la vertu qui a toujours donn de l'clat leurs actions [des Bourbon] ; le bon mnage & l'Ïconomie qu'ils ont apporte conserver leurs biens & les augmenter ; les grandes alliances dont ils ont est fort soigneux... de sorte que les peuples les voyant toujours riches, puissans, sages, en un mot dignes de commander, s'toient imprimez dans l'esprit une certaine persuasion comme Prophetique, que cette Maison viendrait un jour la Couronne (Perefixe, 1662, Histoire d'Henri le Grand, Paris, ch. Jolly).
On est loin de nos Courtenay auxquels, en 1632, Cardin-Lebret, dans la mme phrase, ouvrait et fermait la porte. Il cite Balde (cette loi salique appelle les mles indfiniment la succession du Royaume) mais ajoute cette redoutable restriction : pourvu qu'ils aient joui des droits, des rangs, des privilges et des autres prrogatives qui leur sont attribues (Îuvres, d. 1643, p. 12).
Il faut avoir t pour tre !
En effet, contrairement aux illusions simplettes qu'inspire la pseudo-biologie du "sang" et de la "race", le sang reu de la nature par les voies lgitimes se conserve, se reconnat et s'enrichit par les Ïuvres. Il faut tenir son rang, peine de le perdre. Ne pas soutenir sa qualit la dgrade jusqu' tomber dans un profond prcipice (de la Roque, 1678, prface). Plus le sang est noble, plus il a besoin d'tre nourri : dignits, conqutes, victoires, reconnaissance publique, fortune, alliances, clientle etc. Sinon, il s'anmie. Or le cercle des dignits doit se fermer, la dignit de la personne galer celle de l'office qu'elle est susceptible d'assumer : une position honorable exige un homme honorable. Pour occuper une dignit suprieure, il faut tre la fois le plus digne et reconnu comme tel, crit Rossi, 2018 (only someone worthy of honour [in moral, social and legal terms] should occupy a honourable position.... the holder of a superior dignitas should not only be worthier [dignior], but also appear such). C'est encore plus vrai pour la dignit suprme.
Un roi ne tombe pas du ciel, tel le soliveau de la fable au milieu des grenouilles. Outre la lgitimit, il a besoin d'avantages matriels et immatriels : des rseaux, des amis, des obligs et, pour les entretenir, des ressources ; et surtout, rputation et grandeur, une grandeur admise par ses pairs et admire par ses infrieurs. Autrement, il ne s'imposera pas aux Grands dont les ambitions provoqueront dissensions, troubles, voire guerre civile.
La royaut y a pourvu : en mme temps qu'elle s'institutionnalisait, elle a appris chrir, magnifier et hirarchiser ses fils, puis ses cousins, capables de la couronne. On ne les laisse plus errer tout nus la recherche d'une hritire. On les habille, on les catalogue, on les dote, on les pensionne. La royaut devient une "figure collective", et les Princes des reprsentations du Roi.
Le Roi est le soleil, ses Princes les toiles qui brillent d'un monde d'Avantages &. de prrogatives, comme l'crit le flatteur du Chesne (1609, p. 650) sur le mode lyrique : Le train des Princes de France est admirable & tout Royal, aussi est-il que leur quipage monstre la grandeur des maistres qu'ils servent, qui sont les premiers & plus grans Monarques de la Chrtient. Le Ciel a son Soleil, & il a ses estoilles : aussi la France a son Roy, & si elle a ses Princes... en quelque part que se soient parquez ces Princes, ils ont est veuz & recognus brillans & eclatans d'un monde d'Avantages &. de prrogatives, qui les ont tousiours accompagnez, & qui les ont fait admirer de toutes les nations de la terre, & sur tous les princes des Couronnes estrangeres...
Dire ce qu'est un Bourbon, ce qu'est un Prince, montre tout ce qui manque nos Courtenay.
ii)
sans
attache
Le petit "bang" de leur origine n'a pas la force de les propulser pour les mettre en orbite, en raison de la prcarit d'une position royale alors inacheve, encore insre dans la comptition des Grands. Si Philippe Auguste met le pied de Pierre II l'trier, la branche ane court sa chance par elle-mme jusqu' puisement, laissant la branche cadette sa mauvaise fortune (gentrification et incertitude gnalogique).
La voie du sang se termine en cul de sac. Apparus trop tt, nos Courtenay ne pouvaient pas prendre un train qui n'tait pas sur les rails. Quand ils demanderont un ticket, ils n'auront pas les moyens de le payer : on les crditera d'une prime d'anciennet qui compense en partie leur dbit (mdiocrit et obscurit), sans rendre leur compte positif. Leur chque sans provision est rejet. Au bnfice du doute cependant, on ne les condamne pas. Possibles, ils restent non plausibles.
On leur reproche tort d'avoir reni leur origine, de s'tre fondus dans la baronnie par avarice (Belleforest), en prenant le nom et les armes de leurs femmes dont ils faisaient plus d'estat que de celles de la Maison de France qui leur appartenaient par extraction (Loyseau). C'est une illusion d'optique : au temps de leur origine, celle-ci ne valait pas grand chose, la royaut tant trop faible. Quatre sicles aprs, l'improbable a eu lieu : la branlante maison royale s'est consolide, organise et pure. Cela impacte la vision du pass qui apparat dans une lumire dore dont les Courtenay rsiduels cherchent capter quelques rayons. Cette fois, il est trop tard car les premiers Captiens sont dsormais noys dans les fondations de l'difice saint-louisien, domin par le clocher bourbonien sur lequel Louis XIV plantera sa flche.
Jadis, les rois s'ancrrent Charlemagne par des mariages et par des lgendes. Louis IX encore, transformant Saint-Denis en symbole, rinstalle les tombeaux : dans la croise du transept, huit carolingiens au sud, huit captiens au nord, et, au milieu Louis VIII, son pre, issu de l'union des sangs. Les deux "races" se joignent visuellement (Lewis)... pour en produire une nouvelle qui les dclasse. En effet, la vie et la mort difiantes de Louis IX, sa saintet, dplacent le point d'origine. La succession historique des Captiens devient une "autogense", mettant leur principe en eux-mmes. Philippe le bel y contribue activement pour sa propre gloire. Ensuite, le collatral Philippe VI (Valois), poursuit la construction du mythe qui le lgitime : fils de comte, certes, mais arrire-petit-fils du Saint !
Le reditus est prim. Foin de Charlemagne ! Le ntre s'appelle S.Louis. La direction du temps s'inverse miraculeusement : d'hritiers des discutables guerriers Robertiens, les premiers Captiens se mtamorphosent en prcurseurs (proportionnellement leurs mrites). Quant aux fils de St Louis, ils forment une race surminente, surmature, qui, fin XVIe, triomphera des derniers "carolingiens" (Guise).
Sont Princes tous ceux, et uniquement ceux, qui descendent de S.Louis dont l'iconisation est la fois la cause et l'effet de sa fonction sminale. Tous adoptent les symboles royaux, dont les lys qui, au dbut XIIIe, deviennent l'emblme, non seulement du roi mais de ses fils, une constellation de cadets qui sont la fois des princes territoriaux et des personnages de qualit royale (Lewis, p. 203). Ces Raux (regales) constituent encore un groupe familial dans lequel le rang rsulte de l'ge. Plus tard, il s'largira et s'organisera selon la distance la couronne jusqu' la nomenclature louis-quatorzienne (le dauphin, les autres fils de France, les petits-fils de France, le premier prince du sang, les autres princes, eux-mmes hirarchiss).
Nos Courtenay, s'ils appartiennent bien l'arbre commun, touchent aux racines, pas aux branches suprieures que caresse le soleil. Ils n'ont pas recharg leur royalit par des alliances. Ils la perdent quand elle s'ancre Saint-Louis. De Thou, crivant au tout dbut des tentatives Courtenay, affirme qu'on n'avoit jamais donn en France le nom de Prince, qu' ceux qui toient issus de nos Rois de mle en mle ; qu'on ne mettoit de ce nombre aujourd'hui que les descendans de S. Louis ; & que les seigneurs de Courtenai & de Dreux n'toient pas mme regardez comme Princes, quoiqu'ils eussent pour tige Louis le Gros (Livre XXV de l'Histoire universelle, T. 3 de l'd. Londres, 1734, l'anne 1560, p 515). Ces derniers ont t frapps d'obsolescence.
Par malheur, elle s'aggrave au moment o les Courtenay revendiquent, car le processus de concentration continue ! Issu de Saint-Louis, Henri IV, devenu post mortem le bon roi Henri, rinitialise l'origine. L'hritier est promu gnarque. Les primo-captiens ont t remplacs par les saint-louisiens dont sortirent les Valois, et enfin les Bourbon auxquels, jusqu' sa fin, s'identifiera la monarchie. Le sang royal est prsent Bourbon.
Ultime rtrcissement, le sang royal sera louis-quatorzien : Louis force la royalit de ses btards et, en mariant ses fils et filles illgitimes aux princesses et princes lgitimes, il les fusionne en un seul corps de famille. Il se veut, lui et lui seul, la fontaine du sang royal dont il ouvre le robinet (btards) ou le ferme (Anjou espagnols).
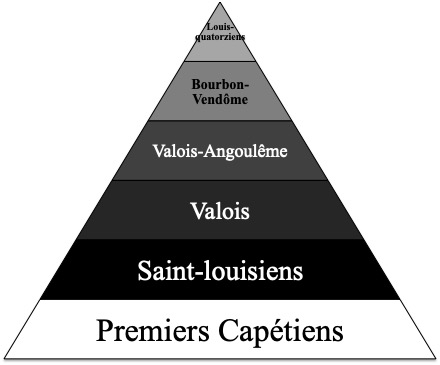
On le voit, des descendants de Louis VI le gros, fussent-ils prouvs, ne comptent pas. Ils n'ont pas su ni pu accompagner les transformations de la monarchie. Elle les a laisss en route : ils n'margent pas aux lys. Leur origine fait d'eux des hritiers sans hritage. La cause a t entendue et juge, le sang a coul, la bote est referme. Des mutations gntiques adaptatives ont rendu infranchissable l'cart avec les vieux anctres.
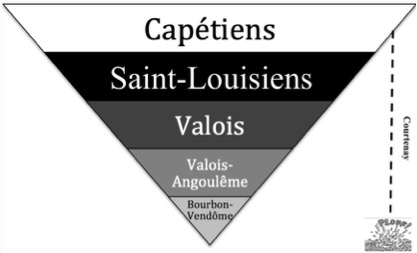
Rfrences
a) modernes
Ñ,
1978, "Charles V et le fardeau de la couronne", In: Annuaire
Bulletin de la Socit d'Histoire de France, vol. 98, pp. 67-75
Achaintre
Nicolas-Louis,
1825, Histoire gnalogique et chronologique de la maison royale de Bourbon..., Paris
Arabeyre
Patrick,
2003, "Le
statut royal", In :
ID., Les
ides
politiques Toulouse la veille de la Rforme : Recherches autour de lÕÏuvre de Guillaume Benot (1455-1516), PU Toulouse
Aubert
Flix,
1905, "Le Parlement de Paris au XVIe sicle", Nouvelle revue historique de droit, nov-dec 1905 et mars-avril 1906
Barnavi
Elie,
1984, "Mythes et ralit historique : le cas de la loi salique", Histoire,
conomie et socit, 3e anne, n¡3, pp. 323-337
Bguin
Katia,
2000, "Louis XIV et l'aristocratie". In: Histoire, conomie et socit, 19ᵉ anne, n¡4, Louis XIV et la construction de l'tat royal, pp. 497-512
Beik
William,
2005, "The Absolutism of Louis XIV as social collaboration", Past and Present, N¡188, Aug. 2005, pp. 195-224
Bonin
Pierre,
2003, "Rgences et lois fondamentales ", Annuaire-Bulletin de la Socit de lÕHistoire de France, Droz, 2003 [2005], p. 77-135
Bouchitt
Louis-Firmin,
1862, Ngociations, lettres & pices relatives la confrence de Loudun in Collections de documents indits sur l'histoire de France, 1re srie: histoire politique
Butaud
Pitri,
2006, Les enjeux de la gnalogie, pouvoir et identit, ditions
Autrement
Campbell
Peter
R., 1996, Power and Politics in Old Regime France 1720Ð1745, Oxford UP
Campbell
Peter
R., 2009, "La cour et les modles de pouvoir : bilan historiographique", Colloque, Les cours en Europe, Versailles, 24-26 septembre 2009
Campbell
Peter
R., 2011, "Absolute monarchy", In: Doyle, d., The Ancien Rgime, Oxford UP
Carbonnires
Louis
de, 2004, "Un magistrat des Lumires face aux Droits : Pierre Gilbert de Voisins", Droits, n¡ 40, pages 115-128
Carbonnires
Louis
de, 2006, "La vision de la procdure de Pierre Gilbert de Voisins, avocat gnral au Parlement", Cahiers de l'Institut d'Anthropologie juridique, n¡13, U. Limoges
Causin
Aurore,
2020, Penser le droit de la succession royale par les lois fondamentales (1661-1717), thse U. Paris 1 Panthon-Sorbonne
Cazelles
Raymond,
1958, La socit politique et la crise de la royaut sous Philippe de Valois
Charbonneau
Frdric,
2009, "Flonie et dmesure dans les Mmoires de Saint-Simon", tudes
franaises, vol. 45, n¡2, , p. 99-111
Chatenet
Monique,1992,
"Henri III et Ç lÕordre de la cour È Ñ volution de lÕtiquette travers les rglements gnraux de 1578 et 1585", In : Sauzet Robert, (dir.), Henri III et son temps, Paris, Vrin, p. 133-139
Clment
Pierre,
1853, Jacques Coeur et Charles VII, ou La France au XVe sicle
Cosandey
Fanny,
2008, "Prsances et sang royal", Cahiers de la Mditerrane, 77
Daussy
Hugues,
2021, "Le parti huguenot l'preuve de la rvolte de Cond (1615-1616)", Dix-septime sicle, n¡ 293, pp. 209-220
Dey,
abb, 1847, "Etudes historiques sur la ville de Blneau", Bulletin de la Socit des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne, Volume I, Auxerre
Dey,
abb, 1848, "Notice historique sur Champignelles", Bulletin de la Socit des sciences historiques et naturelles de l'Yonne
Duby
Georges,
1967, "Remarques sur la littrature gnalogique en France aux XIe et XIIe sicles", Comptes-rendus des sances de l'AIBL, 111e anne, N. 2, 1967. pp. 335-345
Fagniez
Gustave,
1900, "Mathieu de Morgues et le Procs de Richelieu", Revue des Deux Mondes, Tome 162
Giesey
Ralph E., 1961, "The Juristic Basis of Dynastic Right to the FrenchThrone", Transactions of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 51, No. 5, pp. 3-47
Giesey
Ralph,
Dali Kathleen, 1993, " Nol de Fribois et la loi salique", In: Bibliothque
de l'cole des chartes, tome 151, livraison 1. pp. 5-36
Guene
Bernard,
1978, "Les gnalogies entre l'histoire et la politique : la fiert d'tre Captien, en France, au Moyen åge", Annales. ESC, 33e anne, n¡ 3, pp. 450-477
Guerreau-Jalabert
Anita,
1981, "Sur les structures de parent dans l'Europe mdivaleÓ, Annales. conomies, Socits, Civilisations, 36e anne, n¡ 6, pp. 1028-1049
Guerreau-Jalabert
Anita,
1989, "La Parent dans l'Europe mdivale et moderne", L'Homme, tome 29 n¡110. pp. 69-93
Harsgor
Mikhal,
1975, "L'essor des btards nobles au XVe sicle", In: Revue
historique, T. 253, pp. 319-354
Hlary
Xavier,
2015, "Les Courtenay : la fortune dÕune branche de la famille captienne", In: Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres, 159e anne, N. 1, pp. 93-111
Isambert
et al, 1821-1833, Recueil gnral des anciennes lois franaises, depuis l'an 420 jusqu' la Rvolution de 1789, Belin-Leprieur (Paris)
Jackson
Richard
A. , 1971, "Peers of France and Princes of the Blood", French
Historical Studies, Vol. 7, No. 1 (Spring), pp. 27-46
Jobez
Alphonse,
1866, La France sous Louis XV, 3 vol, Paris
Joret-Desclosires
Gabriel,
1867, Procs de Jacques Coeur
Jouanna
Arlette,
2022, Le Sang des princes. Les ambiguts de la lgitimit monarchique
Klapisch-Zuber
Christiane,
2000, L'Ombre des anctres. Essai sur l'imaginaire mdival de la parent, Paris, Fayard
Krynen
Jacques,
1984, "ÇLe mort saisit le vifÈ. Gense mdivale du principe d'instantanit de la succession royale franaise", In: Journal
des savants, 1984, n¡3-4, pp.187-221
Krynen
Jacques,
1999, "Idologie et Royaut", In: Autrand & al, St
Denis et la royaut, pp. 609-620
Lamarrigue
Anne-Marie,
1999, "La rdaction dÕun catalogue des rois de France. Guillaume de Nangis et Bernard Gui", In: Autrand & al., Saint-Denis
et la royaut, pp. 481-492
Lambert
Eugne,
1886, Recherches historiques sur Tanlay, St des sciences de l'Yonne, Joigny
Le
Jan Rgine, 1995, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe -Xe sicle), essai d'anthropologie sociale, Paris, Publications de la Sorbonne
Leclercq
Henri,
1921, Histoire de la rgence pendant la minorit de Louis XV, 3 Volumes, Paris, Champion
Leferme-Falguires
Frdrique,
2011, "Les rangs et prsances des princes trangers et des princes lgitims", In: Cahiers Saint Simon, n¡39, pp. 73-88
Lemontey
Pierre-douard,
1832, Histoire de la Rgence et de la minorit de Louis XV jusqu'au ministre du cardinal de Fleury, Paris : Paulin, 2 vol.
Lewis
Andrew W, 1986, Le Sang royal. La famille captienne et l'tat. France, Xe-XIVe, Paris, 1986
Marijol
Jean-Hippolyte,
1904, La rforme et la ligue, Histoire de France, tome 6, Paris, Hachette
Martin
Chartier,
2000, Livre, pouvoirs et socit Paris au XVIIe sicle, Vol. 2
Miramon
Charles
de-, 2008, "Aux origines de la noblesse et des princes du sang. France et Angleterre au XIVe sicle", In: van der Lugt, de Miramon, LÕhrdit
entre Moyen åge et poque moderne. Perspectives historiques, Sismel Edizioni del Galuzzo, pp.157Ð210
Miramon
Charles
de, van der Lugt Maaike, 2019, "Sang, hrdit et parent au Moyen åge : modle "biologique et modle social. Albert le Grand et Balde", In: Annales de dmographie historique, n¡ 137, pp. 21-48
Monod
Gustave,
1892, "La lgende de la loi salique et la succession au trne de France", Revue critique d'histoire et de littrature, n¡52
Mousset
Albert,
1914, "Les droits de l'infante Isabelle-Claire-Eugnie la couronne de France", In: Bulletin Hispanique, tome 16, n¡1, pp. 46-79
Nassiet
Michel,
1994, "Nom et blason. Un discours de la filiation et de l'alliance(XIVe-XVIIIe sicle)", L'Homme, tome 34, n¡129, pp. 5-30
Nassiet
Michel,
1995, "Parent et successions dynastiques aux XIVe et XVe sicles", In: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 50ᵉ anne, N¡ 3, pp. 621-644
Petit-Dutaillis
Charles,
1874, La vie et le rgne de Louis VIII
Petitot,
1829,
Mmoires relatifs l'histoire de France, depuis l'avnement de Henri IV jusqu' la paix de Paris
Poncet
Olivier, 2009, "La Gallia Christiana (1656) des frres de Sainte-Marthe", In: Revue de lÕhistoire des religions, 2009/3, pp. 375-397
Rigaudire
Albert,
2012, "Un grand moment pour lÕhistoire du droit constitutionnel franais :1374-1409", In: Journal
des
savants, Juillet-Dcembre, pp. 281-370
Rossi
Guido, 2018, "Baldus and the Limits of Representation." Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'histoire du droit/The Legal History Review, 86/1-2, pp. 55-122
Saunier-St
Alice,
1998, Les Courtenay. Destin d'une illustre famille bourguignonne
Servois
Gustave,
1864, "Documents indits sur l'avnement de Philippe le Long", Bulletin
de la Socit de l'Histoire de France, Volume 2, p 44 sq.
Soyecourt,
Comte
de, 1855, Notions claires et prcises sur l'ancienne noblesse de France
Spangler
Jonathan,
2003, "A Lesson in Diplomacy for Louis XIV: The Treaty of Montmartre, 1662, and the Princes of the House of Lorraine", New College, Oxford
Stegmann
Andr,
1992, "Henri III et Henri de NavarreÓ, In : Sauzet Robert, (dir.), Henri
III et son temps, Paris , Vrin
Steinberg
Sylvie,
2012, "Genre, succession fodale et idologie nobiliaire (France, XVIe- XVIIe sicles)", In: Annales.
Histoire,
Sciences Sociales, 67e anne, N¡3, pp. 679-713
Stella,
2023,
The Libri feudorum, An Annotated English Translation of the Vulgata Recension with Latin Text
Swann
Julian,
2011, "Le Parlement de Paris et le roi dans la France de Louis XV", Parlement[s],
Revue d'histoire politique, 2011/1 n¡ 15, p 44-58
Thibault
Jean,
2010, "Familles royales, familles princires : lÕexemple atypique de la famille dÕOrlans au XVe sicle ou la Lgitimit assume par la Btardise", In: Raynaud Christiane, d., Familles
royales, PU Provence, pp. 131-143
Tricard
Jean,
1979, "Jean, duc de Normandie et hritier de France. Un double chec?", In: Annales de Normandie, 29ᵉ anne, n¡1, pp. 23-44
Trouv,
Baron,
1840, Jacques Coeur matre des monnaies
Viard
Jules, 1934, "Philippe VI de Valois. Dbut du rgne (fvrier-juillet 1328)", In: Bibliothque de l'cole des chartes, tome 95, p. 262 sq.
Viennot
Eliane,
2002, "Les crivains politiques et la loi salique", In: Wanegffelen (dir.), De Michel de LÕHospital lÕdit de Nantes. Politique et religion face aux glises, Clermont-Ferrand, PU
Viennot
Eliane,
2003, "LÕinvention de la loi salique et ses rpercussions sur la scne politique de la Renaissance", in Capdevilla et al., Le Genre face aux mutations, Rennes, PU
Viollet
Paul,
1895, "Comment les femmes ont t exclues en France de la succession la Couronne", Mmoires de l'Acadmie des Inscriptions & Belles Lettres, Tome XXXIV, 2me partie
Werner
Karl Ferdinand, 1974, "Liens de parent et noms de personne. Un problme historique et mthodologique", Famille et parent dans l'Occident mdival, Publications EFR, 30, 1977
Wild
Francine,
2011, Epope et mmoire nationale au XVIIe sicle, PU Caen
Zeller
Berthold,
1897, La minorit de Louis XIII Ñ II. Marie de Mdicis et Villeroy: tude nouvelle d'aprs les documents florentins et vnitiens
b) d'ancien rgime
Ñ,
1303, Lignage de Coucy de Dreux, Bourbon & Courtenay
Ñ,
1450, Grand trait de la loy salique, [c 1450-64], repr. in Seyssel, Grand'Monarchie, ed. 1557, pp 81-132
Ñ,
1589, Raisons qui ont meu les franois catholiques recognoistre notre Roy Charles dixime, Paris, Th. Rollin
Ñ,
1613, Recueil de pices sur la maison de Courtenai, Paris
Ñ,
1652, Recueil de maximes pour l'institution du Roy ..contre la fausse et pernicieuse politique du cardinal Mazarin, Paris
Ñ,
1712, L'tat de la France, contenant tous les princes, ducs et pairs et marchaux de France, les vques, les juridictions du Roaume, les gouverneurs des provinces, les chevaliers des trois ordres du Roy, les noms des officiers....
Ñ,
1717, Recueil general des pieces Touchant l'Affaire des Princes Legitimes et legitimez, 3 vols, Roterdam
Ñ,
1737, Matires du tems, mars, Tome XXXXI
Ñ,
1786, Encyclopdie mthodique. Histoire, Tome second, Panckoucke
Anselme
(Pre),
1674, Histoire gnalogique et chronologique de la maison royale de France, chez Etienne Loyson
Anselme
(Pre),
1725, Histoire gnalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la Couronne, de la Maison du Roy et des anciens barons du royaume...., continu par Du Fourny, 3me dition revue, corrige et augmente par les RP Ange & Simplicien
Beauvau,
marquis
de, 1688, Mmoires pour servir l'histoire de Charles IV duc de Lorraine & de Bar, Cologne, ch. Marteau
Belleforest
Franois
de, 1568, Histoire des neuf Rois Charles, Paris, L'Huillier
Belleforest
Franois
de, 1579, Les Grandes Annales et histoire gnrale de France, Tome 1, Paris, Gabriel Buon ; d. 1617, avec
la suite & continuation d'icelles depuis le roi CH 9e jq Louis 13 prsent rgnant par Gabriel Chappuys, Sonnius
Besongne
Nicolas,
1665, L'Etat de La France: concernant les dignits gnrales de tout le Royaume
Bonamy,
1745,
"Mmoire sur les dernires annes de la vie de Jacques Coeur", Acadmie
royale
des inscriptions et belles lettres, Volume 20 , Imprimerie royale, 1753
Boulainvilliers,
1737,
Histoire des anciens Parlements..., Londres
Buchon
(d.),
1838, Choix de chroniques et mmoires du XVme sicle, In collection le panthon franais
Cardin
Le Bret, 1632, De la souverainet des roys, Îuvres,
d. 1643, Paris, Toussainct du Bray
Castrain,
1607,
De stirpe et origine domus de Courtenay quae coepit a Ludouico Crasso huius nominis sexto Francorum Rege Sermocinatio
Chesnaye
Aubert
de la, 1770, Dictionnaire de la noblesse, nouvelle dition, Paris, Vve Duchesne
Choisy,
Abb de, 1750, Histoire de France, Tome 2
Cleaveland
Ezra,
1735, A Genealogical History OF THE Noble and Illustrious FAMILY OF COURTENAY, In three parts. the first giveth an account, of the counts of Edessa, of that Family. The Second, of that Branch that is in France. The Third, Of that Branch that is in England, Exon /Exeter, Edw. Farley
Clmencet
&
al, 1750, L'art de vrifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments, Revu et continu par un religieux de la congrgation de Saint-Maur (Dom F. Clment), rimprim... et continu... par M. de Saint-Allais, 1818
Courchamps
Cousin
de, 1834-1835, Souvenirs de la marquise de Crquy
Courtenay
Hlne
de, 1737, "Requte de Hlne de Courtenay contre un arrt du Parlement de Paris... qui lui a ray la qualit de princesse du sang royal de France", Mercure Historique, T CII, p 45
Courtenay,
1614,
manuscrits, BNF Anc. 8357(46), Dpartement des manuscrits, Franais2759
Dangeau,
Journal du marquis de Dangeau, publi en entier pour la premire fois par MM. Souli... avec les additions indites du duc de Saint-Simon, Paris, 1854-1860
Daniel,
Pre,
1756, Histoire de France depuis l'tablissement de la monarchie dans les Gaules, Observations...,"de la maison de Courtenay", Nouvelle dition, T. XII (1593/1610), Libraires associs
de
Luynes, Mmoires du duc de Luynes sur la Cour de Louis XV (1735-1758), d. Dussieux, Souli, 1860
du
Bouchet Jean, 1646, La vritable origine de la seconde et troisime ligne de la Maison Royale de France, Paris, ch. Vve Mathurin du Puy
du
Bouchet Jean, 1661, Histoire gnalogique de la Maison Royale de Courtenay, Paris, Preuveray
du
Bouchet Jean, 1667, Responce la requeste que M de Pranzac, prince du sang imaginaire, s'est persuad avoir prsente au Roy, Paris
du
Tillet Jean, 1566, Recueil des Rois, ms de Charles IX
du
Tillet Jean, 1578, Mmoires et Recherches de Jean du Tillet, Rouen, Ph. de Tour (dition non autorise)
du
Tillet Jean, 1580, Recueil des Roys de France, leurs Couronne et Maison, Paris, Dupuys
Duchne
Andr,
1609, Les Antiquitez et recherches de la grandeur et majest des roys de France
Duchne
Andr,
1631, Histoire gnalogique de la maison royale de Dreux, ch. Cramoisy
Dupuy
Louis, 1779, "Observations critiques sur la lgitimation de Jean, comte de Dunois, btard d'Orlans, sur les titres & rang de Prince du Sang, accords lui & ses descendans", In: Mmoires
de
littrature, tirs des registres de l'Acadmie Royale des Inscriptions et Belles-lettres, T. 43, Imprimerie royale, 1786, pp. 578 sq.
Dupuy
Pierre,
1655, "Du Trsor des Chartes du Roy", in Trait des droits du Roy, Paris, Courb
Ferriere
Claude-Joseph
de, 1749, Dictionnaire de droit et de pratique, ch. Brunet
Foucault,
1828,
Collection des mmoires relatifs l'histoire de France, Vol. 63
Furnes,
Vicomtesse,
1450 ca, Les Honneurs de la Cour, d. Sainte-Palaye, 1759, d. 1781
Gibbon,
1776/1788,
Histoire de la dcadence et de la chute de l'Empire Romain
Godefroy
Denis,
1661, "Recueil de diverses pieces justificatives qui concernent le Comte de Dunois & ceux de sa Maison", In: Histoire
de Charles VII, Imprimerie royale, p. 805 sq.
Godefroy
Thodore,
1649, Crmonial franais, d. 1649, Paris, Sbastien Cramoisy
Guyot,
1784, Rpertoire universel de jurisprudence, tome 13
Hozier
(d'), 1738/68, Catalogue gnral de la noblesse
L'Estoile
Pierre
de, 1574-1611, Registres journaux de Pierre de l'Estoile sur le rgne de Henri iv, Ed. Petitot, 1825, Tome 4, Collection des mmoires relatifs l'histoire de France, Volume 48
La
Planche, 1576, La lgende du cardinal Charles de Lorraine et de ses frres de Guise, Reims, J Martin, (sous le nom de Franois de l'Isle)
Labbe
Philippe,
R. P. de la Compagnie de Jsus, 1652, Tableaux
gnalogiques de la Maison Royale de France, Paris, Gaspard Meturas
Lannel
(de), 1623, Recueil de Mmoires servant l'histoire de notre temps, Paris, Chevalier
Laroque
Gilles
Andr de, 1678 Trait de la noblesse et de ses diffrentes espces, Paris, Michallet
Le
Breton Guillaume, 1214 ca, Vie de Philippe Auguste, Ed. Guizot, 1825, Collection des mmoires relatifs l'histoire de France
Le
Laboureur,
1659, Mmoires de Castelnau, Ed. 1731, Bruxelles, ch. Lonard
Le
Laboureur,
1683, Tableaux gnalogiques ou les seize quartiers, Paris, ch. Coustelier
Lelong,
Pre Jacques, 1771, Bibliothque historique, nouvelle dition (Feuret de Fontette), Paris, Herissant
Lenglet
du Fresnoy, abb, 1735, Mthode pour tudier l'histoire, nouvelle
dition, Paris, Gandouin
Lenoble,
1697,
Mylord Courtenay ou histoire secrte des premires amours d'Elisabeth d'Angleterre, ch. Brunet
Levassor
Michel,
1709, Histoire de Louis XIII, d. 1757, Amsterdam, Tome 1
Limiers
Henri-Philippe
de, 1724, Annales de la Monarchie Franoise, ch. L'Honor & Chtelain
Loyseau
Charles,
1610, Trait des ordres et des simples dignits, in Les cinq livres du droit des offices, nouvelle dition 1701, Lyon, Cie des libraires
Marais
Mathieu,
Journal et Mmoires de Mathieu Marais avocat au Parlement de Paris sur la Rgence et le rgne de Louis XV (1715 - 1737), Ed. Lescure, 1863
Menestrier,
Pre,
1683, "A l'origine des quartiers et preuves de noblesse", in Le Laboureur, Tableaux gnalogiques, ch. Coustelier
Mzeray
Franois
Eudes de, 1685, Abrg de l'histoire de France, red. Amsterdam 1740, Mortier
Moreri
Louis,
1718, Le grand dictionaire historique, ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane, T2, Paris, ch. Mariette, ¤ Courtenai, 587 sq.
Morgues
Mathieu
de, 1644, Recueil de diverses pices pour servir l'histoire de France sous le rgne de Louis XIII, "Lettre de Mr le cardinal de Lyon Mr le Cardinal de Richelieu son frre, l'an 1631"
Palma-Cayet
Pierre
Victor, 1605 Chronologie novenaire, Ed. Buchon, 1836, Panthon
littraire
Perefixe
Hardouin
de, 1662, Histoire d'Henri le Grand, Paris, Jolly
Plessis-Mornay
Philippe
de, 1583, "Discours du droit prtendu pour ceux de la maison de Guise la couronne de France", In Goulart Simon, Mmoires de la Ligue, Tome 1
Pontchartrain,
Mmoires de Pontchartrain, T.2, Appendice Confrence de Loudun, In: Petitot, 1822, Collection des mmoires relatifs l'histoire de France, T17
Richelieu,
1626,
Mmoires, Tome VI, Ed. Petitot, 2nde srie, tome 26
Saint-Allais,
1817,
Nobiliaire universel
Saint-Allais, 1818, L'art de vrifier les dates (continuation)
Saint-Simon,
Mmoires, d. Chruel
Sainte-Marthe,
Louis
& Scevole de, 1619, Histoire gnalogique de la maison de France, Abraham Pacar
Sainte-Marthe,
Louis
& Scevole de, 1627, Histoire gnalogique de la maison de France, Nicolas Buon
Sainte-Marthe,
Louis
& Scevole de, 1647, Histoire gnalogique de la maison de France, Cramoisy
Sainte-Palaye,
Jean-Baptiste
La Curne de, 1759, Mmoires sur l'ancienne chevalerie, nouvelle dition, 1781, Vve Duchesne
Sauvigny,
Abb
de, 1787, Histoire de Henri III, Paris, Regnault
Thaumassire
Gaspard
Thaumas de la, 1679, Les anciennes et nouvelles coutumes de Berry et celles de Lorris
Thaumassire
Gaspard
Thaumas de la, 1689, Histoire de Berry, Bourges, Toubeau
Thou
Jacques-Auguste
de, 1604, Histoire universelle, d. 1740, Londres
Thou
Jacques-Auguste
de, 1616, Lettre Jean de Thumery, sieur de Boissise sur la confrence de Loudun, 6 mai, in Lettres historiques de de Thou, Histoire
universelle, TX, , La Haye, Scheurleer, 1740
Thou
Jacques-Auguste
de, 1659, Histoire de Mr de Thou des choses arrives de son temps, Traduction du Ryer, Paris, Courb
Varillas,
1693,
Histoire de Franois second, La Haye, Moetjens
Zurlauben
Bat
Fidle de La Tour-Chtillon de, 1766, "Observations critiques sur la notice des diplmes publie par l'abb de Foy", Mmoires de littrature tirs des registres de l'Acadmie des inscriptions et belles-lettres, tome 34,1770